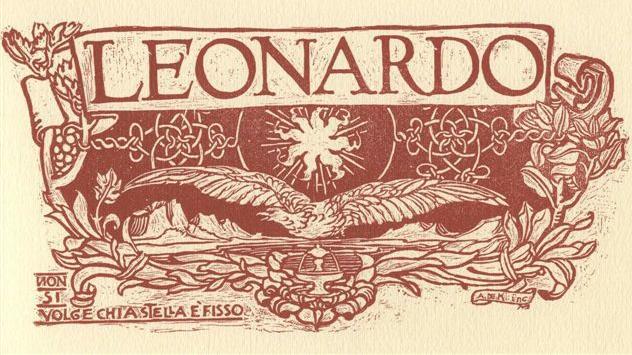-
Prezzolini
 Reconnu comme le plus grand penseur néoconservateur de l’Italie d’après-guerre, Giuseppe Prezzolini (1882-1982), cofondateur des revues florentines Il Leonardo [1903-1907] et La Voce [1908-1916], reste une figure intellectuelle remarquable et hélas quasi méconnue en France. Il nous est cher pour son Anthologie de la littérature italienne (1925) et pour son Machiavel (1929). Aussi le saluons-nous ici avec une rare étude en français. Après avoir occupé, à partir de 1929, la chaire de littérature italienne à l’université Columbia de New York — il y gagna le surnom de “Prezzy” —, Prezzolini rentra en Italie en 1951. Au cours de ces dernières années, il collabora régulièrement à l’hebdomadaire Il Borghese (Rome), ainsi qu’à plusieurs quotidiens : Il Resto del Carlino (Bologne), Roma (Naples) et La Nazione (Florence), preuve de sa vitalité intellectuelle inlassable. Évoluant vers la foi (Dieu est un risque, 1969), il apporte dans son autobiographie (L'Italien inutile, 1954 ; Manifeste des conservateurs, 1972) les principes d'une pensée moderne conservatrice. Pour prolonger : Giuseppe Prezzolini : l'anarchico conservatore (Gennaro Sangiuliano, 2007) [recension].
Reconnu comme le plus grand penseur néoconservateur de l’Italie d’après-guerre, Giuseppe Prezzolini (1882-1982), cofondateur des revues florentines Il Leonardo [1903-1907] et La Voce [1908-1916], reste une figure intellectuelle remarquable et hélas quasi méconnue en France. Il nous est cher pour son Anthologie de la littérature italienne (1925) et pour son Machiavel (1929). Aussi le saluons-nous ici avec une rare étude en français. Après avoir occupé, à partir de 1929, la chaire de littérature italienne à l’université Columbia de New York — il y gagna le surnom de “Prezzy” —, Prezzolini rentra en Italie en 1951. Au cours de ces dernières années, il collabora régulièrement à l’hebdomadaire Il Borghese (Rome), ainsi qu’à plusieurs quotidiens : Il Resto del Carlino (Bologne), Roma (Naples) et La Nazione (Florence), preuve de sa vitalité intellectuelle inlassable. Évoluant vers la foi (Dieu est un risque, 1969), il apporte dans son autobiographie (L'Italien inutile, 1954 ; Manifeste des conservateurs, 1972) les principes d'une pensée moderne conservatrice. Pour prolonger : Giuseppe Prezzolini : l'anarchico conservatore (Gennaro Sangiuliano, 2007) [recension].***
Giuseppe Prezzolini, un “machiavélien” néoconservateur
Il paraît qu’à sa naissance, Nicolas Machiavel avait un sourire aux lèvres, ce qui fut considéré comme un signe de bon augure et un indice de vivacité d’esprit par ses parents et leurs amis. Nous ne savons pas si Giuseppe Prezzolini — dont on fête cette année le 98ème anniversaire — sourit également à son entourage quand il vint au monde, à l’instar de son célèbre compatriote, mais, compte tenu des innombrables activités qui furent les siennes au cours de son existence, on peut au moins avancer cette hypothèse, qui pourrait bien être une certitude !
Retracer, en l’espace de quelques pages, l’itinéraire intellectuel et spirituel prezzolinien n’est certes pas chose aisée. Cette entreprise est même encore plus difficile lorsque qu’on s’adresse à des lecteurs non italiens, qui, par grâce nationale, ne sont pas tenus d’être informés complètement de ce qui se passe en Italie. Nous essaierons donc de tracer ici un panorama ample et informé sur ce globe-trotter des idées, véritable protagoniste de notre histoire culturelle, tout en évitant, dans la mesure du possible, une documentation analytique trop précise.
“Leonardo” : un vent nouveau
Giuseppe Prezzolini est né à Pérouse le 27 janvier 1882. Par l’esprit et le caractère, il apparaît toutefois dés le début comme un Toscan, et même, si l’on veut, comme un membre de cette catégorie particulière de Toscans que sont les Florentins. Pérouse fut un accident dû à la profession de son père, qui, fonctionnaire de l’État sous la monarchie, était souvent amené à changer de ville et de région. C’est grâce à ce père attentif et cultivé, ami de Giosue Carducci, d’Enrico Nencioni, de Francesco Crispi et de tant d’autres représentants, non pas de leur époque, mais d’une vie culturelle véritable, propriétaire par ailleurs d’une bibliothèque aussi riche que fournie, que le jeune Prezzolini dispose des moyens techniques et des outils de travail qui lui permettent de se constituer une solide culture, en vue de rentrer, lui aussi, dans la nouvelle bureaucratie qui se met alors en place. Toutefois, entre le père et le fils, les rapports ne seront jamais bons : à l’ordre bourgeois exigé par le premier, le second ne cessera d’opposer un “désordre” vaguement anarchique et contestataire.
Finalement, Prezzolini ne termine même pas ses études. Il ne songe pas non plus à se procurer un emploi stable. La grande passion de sa vie est la philosophie, et, à l’âge de 21 ans, nous le retrouvons à Florence en train d’étudier l’œuvre de Bergson. Nous sommes alors en 1903, date fondamentale dans la vie et l’histoire de Prezzolini : c’est en effet l’année où se crée la revue Leonardo, dont il est le fondateur avec son ami et mentor Giuseppe Papini. Publié, de façon assez irrégulière, pendant 4 ans, Leonardo fut réalisé et se développa grâce à quelques jeunes gens dont le bagage culturel était souvent le fruit de lectures hâtives et mal digérées, ou encore d’impressions et de suggestions. Ce fut pourtant une aventure intellectuelle qui, dans l’Italie du début du siècle, allait symboliser toute une époque. Dans le “programme synthétique” paru dans le premier numéro de la revue, ses fondateurs se présentaient comme “un groupe de jeunes” dont les traits caractéristiques étaient les suivants :
« Dans la vie (…) païens et individualistes — amateurs d’intelligence et de beauté, adorateurs de la nature profonde et de la vie bien remplie, ennemis de toute forme de conformisme nazaréen et de servitude plébéienne. En matière de pensée (…) personnalistes et idéalistes, c’est-à-dire au-dessus de tout système et de toute limite (…) négateurs de toute existence en dehors de la pensée (…) En art, ils aiment la transfiguration idéale de la vie et en combattent les formes inférieures, aspirant à la beauté en tant que figuration suggestive et révélation d’une vie sereine et profonde ».
On retrouve facilement ici un certain nombre d’influences : Nietzsche surtout, mais aussi Stirner et d’Annunzio, avec leur culte de l’individu, leur mépris de la masse et des “vertus” bourgeoises, le centrage de l’existence individuelle sur la pensée et la beauté.
Leonardo représenta un vent nouveau dans le climat culturel assez stagnant de ces premières années du XXe siècle, en même temps qu’une première — et violente — attaque contre la philosophie positiviste alors dominante et acceptée par tous, mais qui, sur le plan spéculatif, n’était plus qu’une triste caricature qu’une seule secousse aurait suffi à faire tomber en morceaux. Ce positivisme avait quasiment réduit l’homme à un automate, avili la pensée, sorti de ses gonds toute réalité philosophique ; il représentait alors assez bien une Italie boutiquière, sans prétentions, dépourvue d’idéaux, aspirant au confort, à l’intérêt facile et au gain. C’est contre cette philosophie que Prezzolini et Papini se lancent, dénonçant du même coup tout l’univers qui tournait autour d’elle :
« Positivisme, érudition, art vériste, méthode historique, matérialisme, variétés bourgeoises et collectivistes de la démocratie — toute cette puanteur d’acide phénique, de graisse et de fumée, de sueur populaire, ce grincement de machines, cet affairement commercial, ce bruit de réclame —, ces choses sont non seulement liées rationnellement, mais (…) unies par un lien sentimental qui nous les ferait dédaigner si elles étaient lointaines, mais qui nous les fait au contraire haïr parce qu’elles nous sont proches » (Alle sorgenti dello spirito, in : Leonardo n°8, 19 avril 1903).
Toute une philosophie de la vie
Nous avons écrit “contre le positivisme”, et ce n’est par hasard. Le programme développé par Leonardo repose en effet beaucoup plus sur l’opposition que sur des aspects positifs ; les haines communes sont alors plus importantes que les “amours”. Se remémorant cette époque, Papini écrira plus tard : « Nous n’avions pas d’idées précises sur ce qu’on devait faire, défendre et attaquer (…) Nous ne savions pas de quel côté commencer ». Papini et Prezzolini font donc flèche de tout bois : l’intuitionnisme de Bergson, le pragmatisme de James, les grands mystiques — allemands et autres : Eckhart, Silesius, saint Jean de la Croix —, et aussi Novalis, Kierkegaard, Dostoïevski… Et voilà les fugues de Prezzolini, son incapacité à rester longtemps sans bouger au même endroit, sa tentative (ratée) d’adhérer au catholicisme, etc. — toutes expériences et découvertes consommées les unes après les autres, dans la difficile mais constante recherche d’un point solide où s’appuyer, d’une idée à laquelle il aurait été possible de croire vraiment. Bref, les animateurs de Leonardo se trouvaient au cœur même de la crise que d’Annunzio, avec sa capacité d’intuition bien connue, avait déjà perçue plus de dix ans auparavant : « La science est incapable de repeupler le ciel déserté, de rendre le bonheur aux âmes dans lesquelles elle a détruit la paix ingénue (…) Nous ne voulons plus de vérité. Donnez-nous le rêve ! » Et aussi Nietzsche : « Dieu est mort, tous les dieux sont morts, et l’homme aussi est mort, et la nature avec ses lois et tout le monde connu. Au-delà, s’ouvrent des aurores jamais vues ».
Pour le Prezzolini “léonardien”, Bergson représenta toute une « philosophie de la vie (…) source merveilleuse d’une harmonie qu’en brisant la logique (…) et en méprisant la science comme incapable de nous donner le réel, nous pouvons rejoindre par l’action profonde et la recherche de nous-mêmes. Apologie de la vie intime, revendication pour l’individu de sa puissance sur le monde extérieur (…) telle est la nouvelle philosophie. Elle nous annonce la vraie vie (…) nous rend créateurs (…) Avec elle, tout au monde est possible » (Vita trionfante, in : Leonardo n°1, 4 janvier 1903). En fait, entre l’intuitionnisme, le pragmatisme, le “magisme”, l’oscillation de la revue signifiait clairement, au-delà de la recherche et de la spontanéité, même chaotique, de ses initiateurs, que la brèche positiviste allait désormais s’élargir de plus en plus jusqu’à faire s’écrouler définitivement l’édifice entier. C’est d’ailleurs presque au même moment qu’à Naples, Benedetto Croce fonde La Critica, revue située elle aussi dans la ligne “destructrice” de Leonardo (même si, bien entendu, l’idéalisme de Croce était d’une nature fort différente des diverses philosophies abritées par la revue florentine).
Prezzolini eut dans l’aventure “léonardienne” un rôle bien précis : c’est lui qui fournit aux “sorties” d’un Papini plus agile dans les controverses que ferme dans les études, l’essentiel de sa “couverture” philosophique. C’est ainsi qu’il découvrit peu à peu l’idéalisme de Berkeley et de Hume, la théorie de l’Unique de Stirner, ainsi que la “lumière” de Hölderlin (dont il fut le premier traducteur en Italie). Parallèlement à ces travaux à caractère philosophique, Prezzolini se préoccupa, sur le plan de la sociologie politique (pour parler en termes actuels), de donner aux revues italiennes qui faisaient de l’antisocialisme et du nationalisme leur drapeau, des références culturelles leur permettant de ne pas rester à la remorque d’idéologies étrangères ou empruntées. Tel fut le cas — retentissant — pour la revue Il Regno, le premier organe nationaliste italien, qui, à ses débuts, balançait entre Kipling et Barrès, et pour lequel Prezzolini revendiqua l’influence de Vilfredo Pareto et de Gaetano Mosca, en même temps qu’il y faisait connaître la théorie de la circulation des élites et développait une critique serrée de la démocratie et du libéralisme.
Ces brèves indications suffisent, à notre avis, à donner une idée des activités foudroyantes, multiformes et fébriles, que le jeune Prezzolini, à peine âgé de plus de 20 ans, déployait entre 1903 et 1907, tant en publiant des livres et des articles qu’en traduisant des ouvrages étrangers, en tenant des conférences, etc. Pour ne citer qu’un exemple, le nom de Kierkegaard paraît alors en Italie pour la première fois dans Leonardo, une revue qui tirait à peine à 500 exemplaires et n’avait aucun but politique ou commercial !
Tentative d’éducation personnelle, de libre recherche, entièrement articulée autour des intuitions et des goûts personnels, Leonardo cesse de paraître en août 1907, plus à la suite d’une crise intérieure que pour toute autre raison. C’est une sorte de “suicide médité” qu’accomplissent Papini et Prezzolini, tous deux insatisfaits, aspirant au changement, presque horrifiés du succès intellectuel et des “types” que leur revue a rencontrés et vu grandir. Pour Prezzolini, il s’agit en outre de constater un échec : celui de l’idée d’un “homme-dieu” créateur et seigneur de toutes choses. Non pas Dieu comme problème, mais comme idéal, comme but à atteindre : en l’atteignant, l’homme se serait vu chargé de pouvoirs immenses, surhumains, il aurait été en mesure de jouir d’une vie bien différente de celle du commun des mortels. Prezzolini connaît alors, en même temps qu’une extase mystique, une sorte de “cuite” individualiste : l’écrivain toscan découvre qu’il souffre de la solitude, qu’il n’est qu’une petite parcelle d’un univers gigantesque, qu’il est séparé de cet univers et du Tout initial. Il essaie la voie religieuse, en adhérant, non pas au christianisme, mais au catholicisme. Pratiques minutieusement exécutées, sacrements rigoureusement observés. Mais là encore, la tentative échoue, misérablement.
C’est pendant cette période de crise, où il part à la recherche de nouvelles valeurs, de nouvelles significations, que Prezzolini rencontre la philosophie de Benedetto Croce, et, avec elle, la foi dans le monde historique, la vie comprise comme une humble mission quotidienne, l’ordre des choses humaines, cette sorte d’“apostolat laïque” qui trouve sa raison d’être dans une philosophie qui répond à tout, qui élimine tous les problèmes, qui résout toutes les questions. L’adhésion à l’idéalisme de Croce déplace la perspective prezzolinienne, en élargit le champ d’action. Et c’est justement à l’enseigne de la pensée de Benedetto Croce que Prezzolini, le 20 décembre 1908, fonde la revue qui, encore aujourd’hui, reste en Italie la plus importante de ce siècle, La Voce.
L’aventure de “La Voce”
Si auparavant le “moi” était de mise, maintenant, ce sont les autres qui comptent. Si auparavant le protagoniste absolu était la problématique de l’existence individuelle, maintenant, c’est au tour de l’analyse des problèmes sociaux et politiques du moment. Prezzolini manifeste la volonté de s’insérer lui-même dans l’histoire, de s’en faire le protagoniste conscient, d’offrir ses propres capacités pour guider les âmes d’autrui. À l’universalisme de Leonardo, aux grands principes et aux débats, se substitue le concret — la volonté de se plonger dans le vif des problèmes nationaux.
Avec La Voce, Prezzolini tente une opération culturelle très claire : il s’agit de permettre aux intellectuels de s’insérer dans la vie nationale, de récupérer une fonction historique qu’en tant que “classe” ils avaient eue durant le Risorgimento, et qu’ils avaient ensuite progressivement perdue. Renouveau moral, changement intérieur, volonté de modifier le tissu relationnel de la nation : tout cela est à la base de l’aventure de La Voce. Une aventure qui va durer jusqu’en 1914, marquée par des scissions, des dispersions et des brouilles, mais aussi, entre découvertes et polémiques, par l’introduction de nouvelles philosophies, de nouvelles poésies, de conceptions artistiques et d’observations économiques originales. Les meilleurs talents italiens de l’époque collaborent à La Voce, de Giovanni Boine à Ardengo Soffici, de Mario Missiroli à G.A. Borgese, Riccardo Bachelli, Karl Vossler, Giovanni Amendola, Carlo Carrà, Giovanni Papini — et aussi Benedetto Croce, Pietro Jahier, Roberto Longhi, Clemente Rebora, Scipio Slataper, Renato Serra, Benito Mussolini (1), Luigi Einaudi, Gaetano Salvemini, Aldo Palazzeschi, Corrado Govoni, Giuseppe Ungaretti, etc. Parmi les collaborateurs étrangers, on trouve Romain Rolland, Knud Ferlov, Georges Sorel, Charles Péguy, Paul Claudel, Paul Fort, Daniel Halévy, etc. C’est La Voce qui, pour la première fois en Italie, ouvre un débat sur les problèmes sexuels ; c’est dans ses colonnes qu’éclate “l’affaire Medardo Rosso” (sculpteur italien bien connu, mais alors étranger à son propre pays) ; c’est sous son patronage que s’ouvre en Italie la première exposition impressionniste ; et c’est encore dans cette revue que prend forme la querelle philosophique entre Croce et Gentile, qui débouchera par la suite sur la profession de foi “actualiste” du second.
En parcourant ces noms, en survolant tout l’éventail des intérêts embrassés par la revue, on reste stupéfait — et l’on se demande comment une telle initiative a pu durer si longtemps ! C’est là précisément qu’apparaît la grande valeur de Prezzolini, sa capacité à maintenir l’unité dans la diversité, à faire collaborer ensemble les talents les plus différents, à repérer des énergies nouvelles et à les utiliser.
Bien entendu, La Voce ne fut nullement un organe politique ou un journal de parti : les valeurs supérieures à la politique, le “non” à la politique active, le “oui” à l’historicité, celle-ci étant comprise comme position au-dessus de tous les intérêts, faisaient partie d’un “patrimoine” intellectuel que le directeur de la revue parvint, tant bien que mal, à faire se maintenir jusqu’à la fin. Après l’enthousiasme du début, Prezzolini se rendit en effet bien vite compte que le rôle des intellectuels n’était pas de “faire de la politique” — que cela ne rentrait pas dans leur mentalité. Les intellectuels peuvent illuminer les mentalités, mais quant à la réalisation des idées elle-même, l’homme d’action est là pour cela. Et si celui-ci mutile ou estropie les idées, là n’est pas l’important ; la substance demeure, et ce qui compte, c’est que la pensée continue à germer.
De fait, l’expérience de La Voce prend fin avec le début de la Première Guerre mondiale. (Presque tout le groupe d’intellectuels gravitant autour de la revue est alors engagé dans les rangs interventionnistes). L’après-guerre, les deux “années rouges”, la naissance et la montée du fascisme trouvent Prezzolini dans une position assez curieuse. Adversaire des théories pacifistes et égalitaires, hostile au socialisme, ne croyant pas aux capacités révolutionnaires de la classe ouvrière, il a tout naturellement de l’estime et de l’admiration pour Mussolini, qu’il a d’ailleurs fait connaître dans La Voce et qu’il a soutenu activement lors de la fondation du quotidien Il Popolo d’Italia. L’importance de l’homme par rapport aux masses, il l’a également perçue dés 1904, alors qu’il dialoguait avec Pareto : Mussolini, pensait-il, représentait la “preuve pratique” des théories soutenues ; il représentait une “force”, et de beaucoup supérieure aux autres hommes politiques de son temps.
Pourtant, dans les troubles qui ensanglantent l’Italie aux lendemains de la Grande Guerre, Prezzolini ne choisit pas de camp précis : au choix politique, il oppose un choix intellectuel, seul adapté, selon lui, pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là dans le pays. Si, comme il l’a soutenu, l’intellectuel n’a pas pour rôle de faire de la politique, celui qui veut essayer de “comprendre” ce qui se passe ne doit appartenir à aucun parti, ni prendre position pour aucune faction. Au contraire de la politique, qui a comme moyen la propagande, c'est-à-dire la distorsion de la vérité à ses propres fins, la science historique, n’ayant pas d’autres buts que l’explication et l’évaluation de son objet, ou, mieux, ayant comme seul but le rétablissement d’une vérité si souvent violée, est seule en mesure d’éviter les racontars et les mensonges.
Une telle position conduisait néanmoins à une sorte d’impuissance dans la mesure où elle impliquait la suppression de toutes les conditions nécessaires à une éducation et à une formation au-dessus des partis. Parler, polémiquer, imprimer, publier, restaient en effet les conditions sine qua non pour qu’une œuvre pût avoir du succès. Prezzolini, qui était pourtant un intime de Mussolini, et qui aurait pu facilement recevoir de ce dernier des honneurs et des charges, se voit alors contraint de quitter l’Italie, d’abord pour la France, où il est appelé, à l’initiative de Bergson et de J. Luchaire, à l’Institut de coopération intellectuelle (dépendant de la Société des Nations) (2), puis pour les États-Unis.
Une découverte de Machiavel
C’est justement à Paris qu’en 1925, Prezzolini publie chez Bossard un essai sur Le fascisme, qui occupe une place très particulière dans les publications de cette période. Dans ce livre, Prezzolini, visant à une compréhension objective du nouveau mouvement parvenu au pouvoir en Italie, met en garde contre les généralisations hâtives produites aussi bien par les apologistes que par les adversaires. Il souligne aussi la nécessité de tenir compte du peu de signification des partis politiques pour la mentalité italienne ; de la nécessité et de l’importance des chefs politiques ; de l’inachèvement du processus d’unité nationale et, par suite, de la faiblesse du sentiment national dans un pays qui a vu, pendant des siècles, primer les factions, les luttes intestines, les communes et les seigneuries ; de l’absence de démocratie effective et de liberté comprise, non comme avantage personnel, mais comme intérêt public. À cela s’ajoute encore un retard socio-économique évident :
« L’Italie — écrit Prezzolini — n’est pas encore entrée dans l’ère capitaliste moderne (…) Il y manque (…) l’atmosphère bancaire et industrielle moderne (…) C’est à peine si le pays est au début de la politique économique (…) avec des ouvriers qui ne sont urbanisés que depuis une ou deux générations et qui gardent toujours quelque lien avec les campagnes » (Le fascisme, Bossard, 1925, pp. 20-21).
Pour Prezzolini, le fascisme doit être interprété comme « la révolte des classes moyennes, mues par des tendances nationalistes et conservatrices, se dressant contre les prétentions excessives des classes prolétariennes et les fortunes insolentes des éléments capitalistes, désillusionnées par une paix qui n’avait pas réalisé dans la politique intérieure les promesses messianiques auxquelles elles avaient cru, qui n’avait pas obtenu dans la politique extérieure les satisfactions qu’elles avaient estimées nécessaires et justes » (ibid., p. 72). D’un autre côté, l’écrivain toscan n’oublie pas que les premiers fascistes ont été des soldats des corps-francs (arditi) et des futuristes, c'est-à-dire des éléments qui, pendant la guerre, se sont révélés particulièrement actifs sur le plan physique et qui ont apporté dans la vie publique un style et un mode d’action militaires, à base d’ordre, de discipline et de manifestations de force ; qu’il y a donc aussi dans le fascisme une forte composante “anti-ploutocratique” (ibid., pp. 35-38) ; et que certains des promoteurs de ce mouvement visent à en faire une troisième force autonome, opposée au libéralisme et au capitalisme sans pour autant tomber dans le socialisme, et qui, au contraire, tente d’insérer la problématique sociale à l’intérieur de la réalité nationale.
S’employant, comme il l’avait déjà fait au temps de La Voce, à faire connaître autour de lui les idées et les expériences des autres, Giuseppe Prezzolini, à Paris, devient désormais l’interprète du monde qui l’environne. Au lieu d’expliquer, il juge ; au lieu de faire parler des tiers, il prononce son discours à la première personne. C’est à Paris aussi qu’il découvre Machiavel — et c’est avec Machiavel qu’il enterre ses vieilles espérances. Sa Vie de Nicolas Machiavel florentin, publiée chez Plon en 1929, coïncide, dans son édition italienne (parue deux ans plus tôt), avec le quatrième centenaire de la mort de l’auteur du Prince. Il ne s’agit pas d’une biographie au sens étroit du terme, mais plutôt d’une “fable” à la façon d’Ésope, où l’auteur n’hésite pas à se substituer parfois lui-même à son personnage, en lui attribuant répliques et bons mots, pensées et considérations.
En étudiant Machiavel, Prezzolini découvre la réalité par opposition à l’utopie, l’être par opposition au paraître. Machiavel lui offre un “sourire” — ce sourire qui monte aux lèvres de quiconque, désenchanté, regarde le déroulement des choses. Par une lecture attentive du grand philosophe florentin, Prezzolini fait donc l’apprentissage du réalisme politique ; il adhère à la réalité des choses telles qu’elles sont, non telles qu’elles devraient être : « Il m’a paru plus convenable — écrit Machiavel — de rechercher la vérité effective des choses plutôt que leur image. Et beaucoup ont imaginé des républiques et des principautés qu’on n’a jamais vues ni connues dans la réalité » (Le Prince, Sansoni, Firenze, 1971, p. 280). Ce réalisme politique signifie alors qu’on doit utiliser tous les moyens dont on dispose pour faire triompher le bien de l’État. La politique n’est en elle-même ni morale ni immorale — ou, mieux, la moralité en politique réside dans le succès, c’est-à-dire dans le bien de l’État. C’est la raison pour laquelle aucun État ne peut véritablement se baser sur les principes du christianisme, car, tandis que le premier « est fondé sur le principe de l’utile et de la nation, (le second) l’est sur le sentiment de l’amour et de l’universalité » (Cristo e/o Machiavelli, Rusconi, Milano, 1971, p. 27).
Le politique, affirme Prezzolini, doit « tenir compte des forces réelles de la majorité des hommes, qui sont l’ambition, la vanité, l’avarice, la cupidité, l’esprit de vengeance, la sottise, parfois le sacrifice et l’enthousiasme » (Manifesto dei conservalori, Rusconi, Milano, 1972, p. 105). À lire ces lignes, on pourrait presque imaginer Machiavel approuver en souriant — et ajouter : « Des hommes, on peut dire ceci en général : qu’ils sont ingrats, volubiles, simulateurs et dissimulateurs, fuyant les périls, amoureux du gain ; et aussi longtemps que tu fais leur bien, ils sont tous à toi, ils t’offrent leur sang, leurs biens, leur vie et leurs enfants (…) quand le besoin est éloigné ; mais quand le besoin s’approche de toi, ils se révoltent » (Le Prince, op. cit., p. 282).
Ce qui est commun à Prezzolini et à son illustre prédécesseur, c’est le pessimisme qu’ils expriment tous deux vis-à-vis de la nature humaine. Observant la vie quotidienne, l’écoulement des heures et du temps, le premier s’aperçoit qu’il ressent envers ses semblables le même sentiment que celui auquel avait abouti quelques siècles plus tôt, à partir d’une observation analogue, le célèbre secrétaire florentin : « Si les hommes ne tuaient pas, ne volaient pas, ne dissimulaient pas, on n’aurait pas besoin de tribunaux, de juges, de notaires, de lois, de police et de prisons. Si tous étaient bons, on n’aurait pas besoin d’État » (Cristo e/o Machiavelli, op. cit., p. 35). L’État est donc une nécessité ; c’est le fruit de la méchanceté humaine, en même temps — dans une certaine mesure — que son remède. Il constitue, non un bien positif, mais un bien négatif, quelque chose dont on ne saurait se passer, quand bien même on le voudrait.
C’est à partir de là que s’est formé le “conservatisme” de Giuseppe Prezzolini — et c’est sous cet angle que l’on peut éventuellement envisager l’insertion de Prezzolini dans la catégorie idéologique habituellement dénommée “droite”. Néanmoins, des précisions s’imposent. Le conservateur de Prezzolini n’est pas un homme qui regrette le passé, ou qui croit à un “âge d’or” où tout aurait été beau et l’humanité heureuse ; son attitude n’implique nullement un refus du présent, pas plus que le désir de se réfugier dans un passé qu’il n’a pas vécu et qu’il reconstruirait selon ses vœux. Ce “conservatisme” peut encore moins être confondu avec le traditionalisme d’un Evola ou d’un Guénon, fondé sur des principes éternels qui par eux-mêmes informeraient le monde. Tout cela n’a rien à voir. Pour Prezzolini, toutes les périodes, toutes les époques se valent : il n’existe pas d’univers paradisiaques, de temps divins, d’hommes angéliques. II ne s’agit donc pas d’être optimistes ou pessimistes, de préférer le passé au présent, de considérer qu’au fil des temps la catastrophe se précise. La “catastrophe” — c'est-à-dire le “mal” — est “permanente et éternelle”.
Voilà pourquoi, avant de rêver, de théoriser, de promettre sans être sûr de pouvoir tenir, il faut d’abord mettre les choses au point. L’idée de progrès n’est rien d’autre qu’une “erreur logique” : « On ne peut pas savoir si l’on progresse quand on ne sait pas dans quelle direction l’on va, ni où l’on veut s’arrêter » (Manifesto dei conservatori, op. cit.). La défense de certaines institutions, habitudes, usages, coutumes, ne tient pas à l’idée qu’en eux réside la perfection, la somme de toutes les réalisations humaines, mais bien au fait qu’on les considère comme « moins imparfaites, parce qu’elles existent, que celles qui n’existent pas encore et qui exigeraient, pour exister, un effort qu’il serait plus opportun d’appliquer à faire mieux fonctionner celles qui existent déjà » (ibid.). Enfin, à la base de cette vision conservatrice, Prezzolini place le principe de l’inégalité naturelle : « Les hommes sont inégaux par l’âge, le sexe, la force, le courage, l’honnêteté, la fortune et l’hérédité » (Intervista sulla destra, Il Borghese, Roma, 1978, p. 187).
Toute connaissance est personnelle
Il restait à savoir dans quelle perspective se situe la problématique religieuse de Prezzolini. La réponse, là aussi, ne saurait être des plus orthodoxes. Pour Prezzolini, la vie n’est pas un don : qui l’a jamais demandée ? Qui, au moment de naître, a jamais été appelé à décider à la première personne ? Nul homme. À peine né, l’individu se trouve submergé par une infinité de problèmes ; il est obligé de choisir à chaque instant, de parier en toute circonstance : la vie est comme un jeu de hasard. Si la vie était un don, ce serait d’ailleurs un don bien étrange. En mourant, nous sommes expulsés, catapultés hors du monde. La mort met fin à toute existence ; il n’y a pas d’“existence après la mort” (cette formule même est un contresens). Nous ne venons au monde que pour mourir, pour être éliminés. Et cependant, dans le même temps, nous avons en nous-mêmes une immense, une irrépressible envie de vivre — envie, désir qui nous amène, dans une certaine mesure, à réaliser que la vie, loin d’être un don, est en fait une condamnation (cf. G. Prezzolini, Dio é un rischio, Longanesi, Milano, 1969, p. 69). Or, comment peut-on aimer une chose dont le but ultime est la destruction de soi-même ? Nous naissons sans l’avoir voulu. Mais d’où venons-nous, et où irons-nous ? On dirait que cette vie n’est même pas faite pour nous. Elle nous apparaît comme quelque chose d’extérieur, d’impénétrable, voire d’hostile. Exister ou ne pas exister, c’est tout un. La danse des chromosomes décide de ce que nous serons ; blond ou brun, mâle ou femelle, intelligent ou stupide.
Ce monde, poursuit Prezzolini, n’a donc été créé ni par nous ni pour nous ; nous ne savons rien à son sujet. Toute connaissance véritable est personnelle, incommensurable avec celle des autres. Les hommes différent tellement les uns des autres qu’ils ne peuvent communiquer entre eux, sinon sur le plan extérieur ; ils ne peuvent mutuellement se découvrir, s’analyser, se pénétrer, se posséder (cf. Dio é un rischio, op. cit., pp. 41-64). Autour de chaque homme gravite un univers, et cet univers est le “sien” — c’est celui qu’il “ressent”. Mais jusqu’à quel point ce qu’il y a à l’intérieur de lui-même lui appartient-il vraiment ? Et d’où cela vient-il ? En réalité, rien n’est certain. Toute vision est insuffisante :
« L’art tout entier, les actions que nous entreprenons, en quoi cela nous appartient-il vraiment ? Les mots naissent à l’intérieur de nous, la pensée se présente spontanément comme pensée autonome, elle surgit elle aussi au fond de nous-mêmes (…) Qu’y a-t-il en nous auparavant ? Rien, le vide (…) Toutes les œuvres de la pensée sont initialement produites par la nuit profonde de l’esprit où elles semblent se trouver, et tout à coup elles montent en nous » (ibid., p. 48).
En d’autres termes, « le beau, le laid, le bien, le mal, la paix, la guerre, sont toutes des créations de même origine : inconnue. Il n’y a pas d’idée qui ne soit un don, parce qu’une minute avant, une seconde avant qu’elle ne se présente au cerveau, elle n’y était pas, elle n’était rien » (ibid., p. 33). Le langage, lui aussi, est gouverné par l’incertitude : le monde extérieur n’étant, pour Prezzolini, que « l’expérience que nous faisons de l’imagination des autres perçue à travers la nôtre » (ibid., p. 144), dès l’instant où nous tentons de communiquer, nous nous apercevons, le plus souvent, que nous sommes compris de travers, mal interprétés, appréciés de façon erronée ; nous prononçons une phrase et on en comprend une autre, nous lui donnons une signification et, tout de suite, elle arrive déformée aux oreilles d’autrui. « Chaque phrase (…) suscite une réaction chez les autres, et, par conséquent, elle est entendue par eux ; mais elle ne produit pas la même image, le même sentiment, la même volonté ; elle est toujours traduite, et donc comprise, selon les expériences et les capacités de l’interlocuteur, selon ce que l’interlocuteur attend et désire » (ibid., p. 156). Se fier à un message « est toujours une aventure ».
Même la science ne parvient pas à connaître la réalité dans toutes ses dimensions ; elle n’est pas capable de connaître tous les problèmes et tous les mystères de la vie. La raison se heurte sans cesse à l’inconnaissable : le monde est rationnellement inexplicable. Pis encore, si la science détruit froidement toute certitude, elle éteint aussi, au fur et à mesure qu’elle progresse, toute foi. Ce monde impénétrable devrait donc être mû par un principe supérieur, par un être suprême — par Dieu. Les mystères pourraient alors s’“expliquer” ; on comprendrait que le but de l’homme ne se situe pas en ce monde, que le monde tout entier s’inclut dans une “réalité” plus vaste. Oui mais, comme le remarque Prezzolini, avec la raison, on n’attrape pas Dieu ; on le détruit plutôt. Dieu est la perfection même — alors pourquoi a-t-il créé le monde ? « Quel besoin avait-il de le créer s’il était parfait ? À ce qui est parfait on ne peut rien ajouter que l’on ne dégrade (…) Le monde est une faille dans la perfection » (ibid., p. 20).
Et que dire des maux du monde, de la méchanceté humaine ? La religion répond que les premiers sont liés aux biens qui résulteront des desseins de Dieu. Mais c’est pur illogisme. En outre, pourquoi avoir fait l’homme méchant, capable d’accomplir le mal ?
« La réponse selon laquelle le mal provient (non de Dieu, mais) de l’homme (…) ne satisfait pas, car la responsabilité (de l’homme) renvoie nécessairement à celui qui l’a créé (…) capable de faire le mal (…) La création ne peut avoir été faite dans l’intention d’éprouver la force de l’homme, comme si Dieu pouvait s’amuser du spectacle que lui donnent des hommes soumis à la tentation » (ibid., p. 20).
Enfin, si Dieu est omniscient, il peut déjà voir le monde dans sa totalité ; il sait déjà que certains “succomberont” à la tentation, d’autres non, et que les premiers sont condamnés sans possibilité d’appel. Dès le départ, la Grâce est accordée. Et ce n’est pas un don mérité, car tous les hommes sont indignes ; c’est un don gratuit, comme le hasard, privé de toute logique.
Là où la raison n’arrive pas, il ne reste qu’à se confier à la foi, qui est, elle aussi, irrationnelle, étrangère à toute expérience — « acte entièrement gratuit, c’est-à-dire sans espoir de récompense ». Et cette foi est quelque chose qui vient d’en dehors de nous. Nous ne pouvons rien faire pour l’obtenir ; elle n’est qu’une “chance”, et, « parmi les récompenses de la vie (…) la plus grande ».
Toutes ces idées, que nous avons essayé de présenter de façon assez synthétique, Giuseppe Prezzolini les développe, après une longue période de méditation et de silence, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout spécialement à partir des années 60 au moment où, rentré en Italie — il s’installera par la suite en Suisse —, il reprend pleinement son rôle d’“aiguillon” intellectuel et recommence à collaborer à de nombreux journaux et revues.
Au cours de près d’un siècle d’existence, Giuseppe Prezzolini a été le témoin de deux guerres mondiales et de deux révolutions. Il a été professeur à l’université Columbia, aux États-Unis, sans avoir jamais obtenu de diplôme universitaire. Il a été capitaine d’infanterie sans avoir jamais fait son service militaire. Pendant plus de la moitié de sa vie, il a résidé à l’étranger, dernier représentant de ces intellectuels italiens, “aventuriers” au meilleur sens du terme, qui recherchaient en dehors de leur pays des sensations nouvelles. Chroniqueur infatigable, observateur attentif et désenchanté, son œuvre est surtout une œuvre de recherche, non de systématisation, d’intuitions, non de codification, de captation, non de catalogue. Tout au long de cette vie si intense, Prezzolini a toujours réussi à rester fidèle à ses principes d’indépendance, à conserver intacte sa liberté de jugement et d’interprétation. Cet auteur qui a animé deux des revues les plus intéressantes du siècle et écrit quelque chose comme une cinquantaine d’ouvrages, l’Italie d’aujourd’hui semble pourtant faire tout pour oublier l’existence. C’est le prix que doit payer un homme libre dans un pays où l’hypocrisie est devenue un produit national.
► Stenio Solinas, Nouvelle École n°35, 1979.
(traduction : Ursula Locchi)
◘ Notes :
(1) Mussolini envoie un article à Prezzolini le 4 janvier 1909. Dans sa lettre, il précise : « J’étais un lecteur assidu de Leonardo, et je cherche à diffuser La Voce ». Mussolini est alors âgé de 26 ans (cf. Lettere di Mussolini a Prezzolini, in : Intervento, nov.-déc. 1978).
(2) Prezzolini dirigea de 1925 à 1929 la section de l’Information puis la section de Littérature de l’Institut de coopération intellectuelle.
 Tags : droit, italie
Tags : droit, italie