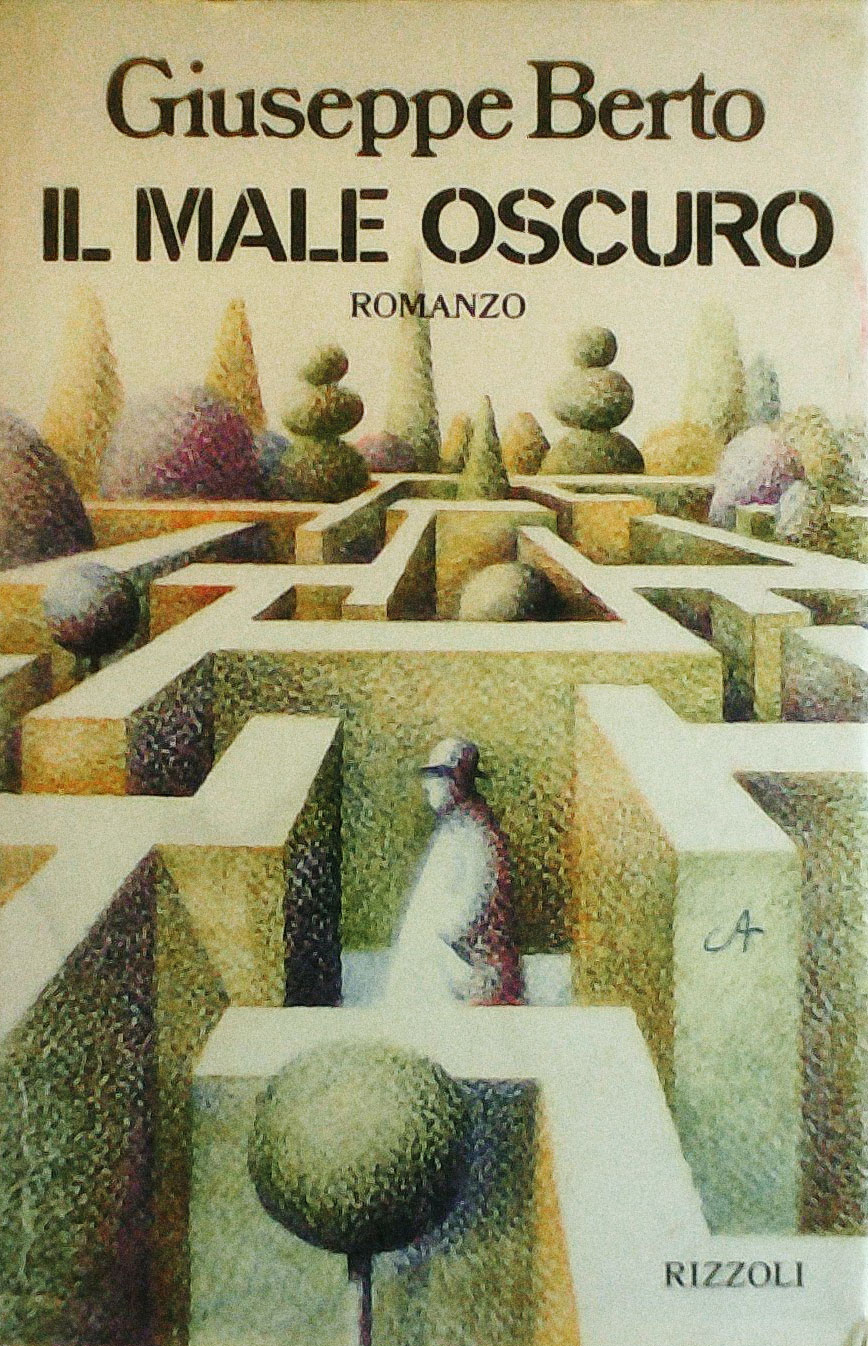-
 Giuseppe Berto, écrivain proscrit et oublié
Giuseppe Berto, écrivain proscrit et oubliéGiuseppe Berto (1914-1978) est un des écrivains italiens les plus doués de sa génération. Il s’est fait connaître après la guerre par des romans néo-réalistes (Le ciel est rouge, 1946 ; Le Brigand, 1951), puis par un grand roman d'inspiration psychanalytique (Le Mal obscur, 1964).
Malgré une biographie, remarquable de précision, publiée en 2000 et due à la plume de Dario Biagi, l’établissement culturel italien ne pardonne toujours pas à Giuseppe Berto d’avoir attaqué avec férocité le pouvoir énorme que le centre-gauche résistentialiste s’est arrogé en Italie. C’est donc la conspiration du silence contre cette “vie scandaleuse”.
***
Quand, en l’an 2000, l’éditeur Bollati Boringhieri a publié la belle biographie de Dario Biagi, La vita scandalosa di Giuseppe Berto, nous nous sommes profondément réjouis et avons espéré que le débat se réamorcerait autour de la figure et de l’œuvre du grand écrivain de Trévise et que d’autres maisons d’édition trouveraient le courage de proposer à nouveau au public les œuvres désormais introuvables de Berto, mais, hélas, après quelques recensions fugaces et embarrassées, dues à des journalistes, le silence est retombé sur notre auteur.
Du reste, ce n’est pas étonnant, car à la barre d’une bonne partie des maisons d’édition italiennes, nous retrouvons les disciples et les héritiers de cet établissement culturel de gauche que Berto avait combattu avec courage, quasiment seul, payant le prix très élevé de l’exclusion, de l’exclusion hors des salons reconnus de la littérature, et d’un ostracisme systématique qui se poursuit jusqu’à nos jours, plus de vingt ans après la mort de l’écrivain. La valeur littéraire et historique du travail biographique de Biagi réside toute entière dans le fait d’avoir braqué à nouveau les feux de la rampe sur la vie tumultueuse d’un personnage véritablement anti-conformiste, d’un audacieux trouble-fête. Biagi nous a raconté son histoire d’homme et d’écrivain non aligné, ses triomphes et ses chutes. Il nous en a croqué un portrait fidèle et affectueux : « Berto avait tout pour faire un vainqueur : le talent, la fascination, la sympathie ; mais il a voulu, et a voulu de toutes ses forces, s’inscrire au parti des perdants ».
Giuseppe Berto, natif de Mogliano près de Trévise, surnommé “Bepi” par ses amis, avait fait la guerre d’Abyssinie comme sous-lieutenant volontaire dans l’infanterie et, au cours des quatre années qu’a duré la campagne, il a surmonté d’abord une attaque de la malaria, où il a frôlé la mort, et ensuite a pris une balle dans le talon droit. L’intempérance et l’exubérance de son caractère firent qu’il ne se contenta pas de ses deux médailles d’argent et du poste de secrétaire du “Fascio”, obtenu à l’âge de 27 ans seulement… Il cherchait encore à faire la guerre et, au bout de quelques années, passant sous silence un ulcère qui le tenaillait, réussit à se faire enrôler une nouvelle fois pour l’Afrique où, pendant l’été 1942, l’attendait le IVe Bataillon des Chemises Noires. Avec l’aile radicale des idéalistes rangés derrière la figure de Berto Ricci, il espérait le déclenchement régénérateur d’une seconde révolution fasciste. Il disait : « Avoir participé avec honneur à cette guerre constituera, à mes yeux, un bon droit à faire la révolution ».
Mais la guerre finit mal pour Berto et, en mai 1943, il est pris prisonnier en Afrique par les troupes américaines et est envoyé dans un camp au Texas, le “Fascist Criminal Camp George E. Meade” à Hereford, où, à peine arrivé, il apprend la chute de Mussolini. Dans sa situation de prisonnier de guerre, il trouve, dit-il, « les conditions extrêmement favorables » pour écrire et pour penser. Il apprend comment trois cents appareils alliés ont bombardé et détruit Trévise le 7 avril 1944, laissant dans les ruines 1.100 morts et 30.000 sans abri. Aussitôt, il veut écrire l’histoire de ces “gens perdus”, en l’imaginant avec un réalisme incroyable. Il l’écrit d’un jet et, en huit mois, son livre est achevé. Juste à temps car les Américains changent d’attitude envers leurs prisonniers “non coopératifs”, les obligeant, par exemple, à déjeuner et à rester cinq ou six heures sous le soleil ardent de l’après-midi texan, pour briser leur résistance. Et Berto demeurera un “non coopératif”. Après de longs mois de tourments, il est autorisé à regagner sa mère-patrie.
 [Ci-contre : couverture de l’édition anglaise de Il cielo è rosso, Secker & Warburg, 1948. Il y aura adaptation cinématographique éponyme par Claudio Gora en 1950]
[Ci-contre : couverture de l’édition anglaise de Il cielo è rosso, Secker & Warburg, 1948. Il y aura adaptation cinématographique éponyme par Claudio Gora en 1950]L’éditeur Longanesi accepte de publier le livre de cet écrivain encore totalement inconnu et, après en avoir modifié le titre, Perduta gente (Gens perdus), considéré comme trop lugubre, le sort de presse, intitulé Il sole è rosso, vers Noël 1946. Berto a confiance en son talent mais sait aussi quelles sont les difficultés pratiques que recèle une carrière d’écrivain ; il commence par rédiger des scénarios de film, ce qu’il considère comme un “vil métier”, afin de lui permettre, à terme, de pratiquer le “noble métier” de la littérature. Il sole è rosso connaît un succès retentissant, les ventes battent tous les records en Italie et à l’étranger, en Espagne, en Suisse, en Scandinavie, aux États-Unis (20.000 copies en quelques mois) et en Angleterre (5.000 copies en un seul jour !). On définit le livre comme « le plus beau roman issu de la Seconde Guerre mondiale ». En 1948, c’est la consécration car Berto reçoit le prestigieux “Prix Littéraire de Florence”. En 1951, toutefois sa gloire décline en Italie. Son roman Il Brigante demeure ignoré de la critique, alors qu’aux États-Unis, il connaît un succès considérable (avec Il sole è rosso et Il Brigante, Berto vendra outre-Atlantique deux millions de livres) et le Time juge le roman « un chef-d’œuvre ». Les salons littéraires italiens, eux, ont décidé de mettre à la porte ce “parvenu”, en lui collant l’étiquette de “fasciste nostalgique” et en rappelant qu’il avait refusé de collaborer avec les alliés, même quand la guerre était perdue pour Mussolini et sa “République Sociale”. Biagi nous rappelle cette époque d’ostracisme : « Berto, homme orgueilleux et loyal, refuse de renier ses idéaux et contribue à alimenter les ragots ». Berto ne perd pas une occasion pour manifester son dédain pour ceux qui, subitement, ont cru bon de se convertir à l’antifascisme et qu’il qualifie de “padreterni letterari”, de “résignés de la littérature”. Il s’amuse à lancer des provocations goliardes : « Comment peut-on faire pour que le nombre des communistes diminue sans recourir à la prison ou à la décapitation ? ». Il prend des positions courageuses, à contre-courant, à une époque où « le brevet d’antifasciste était obligatoire pour être admis dans la bonne société littéraire » (Biagi).
En 1955, avec la publication de Guerra in camicia nera (La guerre en chemise noire), une recomposition de ses journaux de guerre, il amorce lui-même sa chute et provoque « sa mise à l’index par l’établissement littéraire ». Berto déclare alors la guerre au Palazzo et se mue en un véritable censeur qui ne cessait plus de fustiger les mauvaises habitudes littéraires. La critique le rejette, comme s’il n’était plus qu’une pièce hors d’usage, ignorant délibérément cet homme que l’on définira plus tard comme celui « qui a tenté, le plus honnêtement qui soit, d’expliquer ce qu’avait été la jeunesse fasciste ». Et la critique se mit ensuite à dénigrer ses autres livres. Étrange destin pour un écrivain qui, rejeté par la critique officielle, jouissait toutefois de l’estime de Hemingway ; celui-ci avait accordé un entretien l’année précédente à Venise à un certain Montale, qui fut bel et bien interloqué quand l’écrivain américain lui déclara qu’il appréciait grandement l’œuvre de Berto et qu’il souhaitait rencontrer cet écrivain de Trévise. Ses activités de scénariste marquent aussi le pas, alors que, dans les années antérieures, il était l’un des plus demandés de l’industrie cinématographique. Le succès s’en était allé et Berto retrouvait la précarité économique. Et cette misère finit par susciter en lui ce “mal obscur” qu’est la dépression. L’expérience de la dépression, il la traduira dans un livre célèbre qui lui redonne aussitôt une popularité bien méritée.
Mais il garde l’établissement culturel dans son collimateur et ne lâche jamais une occasion pour attaquer « l’illustre et omnipotent Moravia », grand prêtre de cette intelligentsia, notamment en 1962 lorsqu’est attribué le second Prix Formetor. Ce prix, qui consistait en une somme de six millions de lire, et permettait au lauréat d’être édité dans treize pays, avait été conféré cette fois-là à une jeune femme de vingt-cinq ans, Dacia Maraini, que Moravia lui-même avait appuyée dans le jury ; Moravia avait écrit la préface du livre et était amoureux fou de la jeune divorcée et vivait avec elle. Au cours de la conférence de presse, qui suivit l’attribution du Prix, Berto décide de mettre le feu aux poudres, prend la parole et démolit littéralement le livre primé, tout en dénonçant « le danger de corruption que court la société littéraire, si ceux qui jugent de la valeur des œuvres relèvent désormais d’une camarilla » ; sous les ovations du public, il crie à tue-tête « qu’il est temps d’en finir avec ces monopoles culturels protégés par les journaux de gauche ». Toute l’assemblée se range derrière Berto et applaudit, crie, entame des bagarres, forçant la jeune Dacia Maraini à fuir et Moravia à la suivre. Berto n’avait que mépris pour celui qu’il considérait comme « un chef mafieux dans l’orbite culturelle » (comme le rappelle Biagi), comme un « corrupteur », comme un « écrivain passé de l’érotisme à la mode au marxisme à la mode ». En privé, un grand nombre de critiques reconnaissaient la validité des jugements lapidaires posés par Berto, mais peu d’entre eux osèrent s’engager dans un combat contre la corruption de la littérature et Moravia, grâce à ces démissions, récupéra bien rapidement son prestige.
Entretemps, Berto avait surmonté sa crise existentielle et était retourné de toutes ses forces à l’activité littéraire, sans pour autant abandonner ses activités journalistiques où il jouait le rôle de père fouettard ou de martin-bâton, en rédigeant des articles littéraires et des pamphlets incisifs, décochés contre ses détracteurs. Il male oscuro a connu un succès inimaginable : en quelques mois, on en vend 100.000 copies dans la péninsule et son auteur reçoit le Prix Viareggio et le Prix Campiello. Berto a reconquis son public, ses lecteurs le plébiscitent mais, comme il fallait s’y attendre, « la critique radicale de gauche le tourne en dérision, minimise la valeur littéraire de ses livres et dénature ses propos ». Ainsi, Walter Pedullà met en doute « l’authenticité du conflit qui avait opposé Berto à son père » et la sincérité même de Il male oscuro alors que la prestigieuses revue américaine New York Review of Books avait défini ce livre comme l’unique ouvrage d’avant-garde dans l’Italie de l’époque. Il male oscuro, de plus, gagne deux prix en l’espace d’une semaine, le Prix Viareggio et le Prix Campiello.
Berto a retrouvé le succès mais, malgré cela, il ne renonce pas au ton agressif qui avait été le sien dans ses années noires, notamment dans les colonnes du Carlino et de la Nazione et, plus tard, du Settimanale de la maison Rusconi, tribune du haut de laquelle il s’attaque « aux hommes, aux institutions et aux mythes ». En 1971, Berto publie un pamphlet Modesta proposta per prevenire qui, malgré les recensions négatives de la critique, se vend à 40.000 copies en quelques mois. Si on relisait ce pamphlet aujourd’hui, du moins si un éditeur trouvait le courage de le republier, on pourrait constater la lucidité de Berto lorsqu’il donnait une lecture anticonformiste et réaliste de la société italienne de ces années-là. On découvrirait effectivement sa clairvoyance quand il repérait les mutations de la société italienne et énonçait les prospectives qu’elles rendaient possibles. Déjà à l’époque, il dénonçait notre démocratie comme une démocratie bloquée et disait qu’au fascisme, que tous dénonçaient, avait succédé un autre régime basé sur la malhonnêteté. Il stigmatisait aussi la « dégénérescence partitocratique et consociative de la vie politique italienne » et, toujours avec le sens du long terme, annonçait l’avènement du fédéralisme, du présidentialisme et du système électoral majoritaire. Il jugeait, et c’était alors un sacrilège, la résistance comme « un phénomène minoritaire, confus et limité dans le temps, … rendu possible seulement par la présence sur le sol italien des troupes alliées ». Pour Berto, c’était le fascisme, et non la résistance, « qui constituait l’unique phénomène de base national-populaire observable en Italie depuis le temps de César Auguste ».
Lors d’une intervention tenue pendant le “Congrès pour la Défense de la Culture” à Turin, sous les auspices du MSI, Berto se déclare “a-fasciste” tout en affirmant qu’il ne tolérait pas pour cela l’antifascisme car, « en tant que pratique des intellectuels italiens, il est terriblement proche du fascisme… l’antifascisme étant tout aussi violent, sinon plus violent, coercitif, rhétorique et stupide que le fascisme lui-même ». Berto désignait en même temps les coupables : « les groupes qui constituent le pouvoir intellectuel… tous liés les uns aux autres par des principes qu’on ne peut mettre en doute car, tous autant qu’ils sont, se déclarent démocratiques, antifascistes et issus de la résistance. En réalité, ce qui les unit, c’est une communauté d’intérêt, de type mafieux, et la RAI est entre leurs mains, de même que tous les périodiques et les plus grands quotidiens… Si un intellectuel ne rentre pas dans un de ces groupes ou en dénonce les manœuvres, concoctées par leurs chefs, il est banni, proscrit. De ses livres, on parlera le moins possible et toujours en termes méprisants… On lui collera évidemment l’étiquette de “fasciste”, à titre d’insulte ». Dans son intervention, Berto conclut en affirmant « qu’en Italie, il n’y a pas de liberté pour l’intellectuel ».
On se doute bien que la participation à un tel congrès et que de telles déclarations procurèrent à notre écrivain de solides inimitiés. Aujourd’hui, plus de vingt ans après sa mort, il continue à payer la note : son œuvre et sa personne subissent encore et toujours une conspiration du silence, qui ne connaît aucun précédent dans l’histoire de la littérature italienne.
► Roberto Alfatti Appetiti, Area n°49, été 2000.
[version originale] (tr. fr. : Robert Steuckers, nov. 2009)
***
◊ En français :
• Oh, Serafina ! (trad. de l’italien par Gérard Hug, Grasset, 1976)
• Le Mal obscur (trad. de l’italien par Louis Bonalumi, Seuil, 1968)
• L'Évangile selon Judas (trad. de l’italien par René de Ceccatty, Denoël, 1982)
• Le ciel est rouge (trad. de l’italien par Pierre de Montera, éd. Robert Marin, 1949)
◊ En italien
• Conférence filmée de Cesare de Michelis sur Giuseppe Berto

pièces-jointes :
[Ci-contre : Couverture italienne de L’Évangile selon Judas, publiée chez Mondadori en septembre 1978, peu avant la mort de son auteur. Cette nouvelle a valeur testamentaire : derrière la forme parodique qui voit Judas citer Reich ou Engels, Berto livre ses réflexions propres sur l’ambiguïté constitutive de la condition humaine]
Le meilleur des évangiles attribués à Judas est, à mon avis, L’Évangile selon Judas de Giuseppe Berto, publié, comme un testament, un mois avant la mort de l’écrivain vénète, survenue le 1er novembre 1978. Tout ce qui ne concerne pas au premier chef les relations entre Judas et Jésus est élagué. Les paysages de Judée sont substitués par le paysage intérieur de Judas ; les disciples sont à peine mentionnés ; les étapes de l’itinéraire christique ne sont jamais remises en question. Seule la figure du Baptiste est évoquée, avant que Jésus ne s’impose à l’attention de Judas.
Le héros de Berto est un homme seul, un homme qui se cherche tout en guettant un signe venant de l’extérieur. Il est issu d’un peuple qui lui-même s’interroge : « Jamais nous n’avions connu cet égarement, cette division ; jamais nos âmes ne s’étaient à ce point avilies dans la poussière, ni assombries de l’ombre de la mort » (p. 9). À défaut d’une identité fixe et d’un ancrage dans une société stable, Judas tâtonne et se livre à une espèce de sémiologie du divin : « Je parcourais les terres d’Israël, dans l’attente anxieuse d’un signe de l’Éternel Adonaï : qu’il manifestât sa puissance ou sa vanité ! » (p. 12). Et ce signe ne cesse d’être invoqué. La confusion de Judas atteint son paroxysme lorsque, l’espace d’une nuit, interprétant mal une allusion du Baptiste, il se persuade que lui-même est le Messie. La rencontre avec Jésus ne tire pas Judas de sa solitude, car il a tôt fait de comprendre que le nouveau venu lui-même est enfermé dans une solitude infinie, entretenue par une culpabilité qui plonge ses racines dans le massacre des Innocents (comme Camus le suppose dans La Chute, 1956, et Saramago dans le récent Évangile selon Jésus-Christ, 1991).
Mais Judas s’attache aux pas de Jésus, dont il devient le reflet spéculaire. L’effet de miroir, accru par la narration à la deuxième personne du singulier, rapproche et éloigne simultanément les deux personnages. Judas vit dans l’ombre de son maître, « à quelques pas en arrière : je n’étais peut-être pas un intime, mais obscurément j’étais nécessaire » (p. 56). Cette isotopie de l’ombre et de l’obscure nécessité ne cesse d’être cultivée : « Tu es la lumière et je suis les ténèbres » (p. 30). Et Judas finit par se résigner à chercher le signe dont il a besoin dans le noir et par comprendre que l’objet de sa quête n’est pas dans l’obscurité mais qu’il est cette obscurité. Lui seul s’efforce de comprendre un Jésus dont le destin est d’être incompris de ses auditeurs. Obsédé par le désir de déchiffrer l’ombre, il agit seul, en marge d’un groupe trop passif. Pendant très longtemps Judas souffre de cette insurmontable altérité. À l’écart des autres disciples, il ne parvient pas davantage à rejoindre Jésus. Mais, heureusement, durant un bref laps de temps, le fossé se comble. Judas opère la jonction avec Jésus par le biais de ce qu’il appelle « une communion de mort » (p. 63). La trahison lui échoit en partage. Et dans un nouveau réflexe spéculaire, il paraphrase Jésus : « Et pourtant je priais pour que, si cela était possible, ce calice fût éloigné de moi » (p. 151). S’il accepte, c’est par amour : « Ce fut mon dernier devoir d’amour […] et peu importait que je fusse destiné à le payer d’une damnation » (p. 161). Le signe lui est donné à l’instant même où il consent à être condamné à un isolement total par la société des hommes. En feignant de trahir Jésus, il trahit ce qu’il y a d’humain en lui au profit d’une solitude qui participe du divin.
► Bertrand Westphal, extrait de : « Les solitudes de Judas », in : Solitudes : écriture et représentation, A. Siganos (dir.), Ellug, 1995.
• Nota bene : pour une approche approfondie, on consultera du même auteur le chapitre « Giuseppe Berto : Judas ou l’obsession sémiotique », in : Roman et Évangile : Les transpositions de l'évangile dans le roman européen contemporain 1945-2000, Presses Universitaire Limoges et du Limousin, 2002.

[Ci-contre : couverture de l’édition italienne parue chez Rizzoli en 1974]
◊ Recension :
• Giuseppe Berto, Le mal obscur, trad. de l’italien par Louis Bonalumi, Seuil, 380 p.
• Italo Calvino, Cosmicomics, trad. de l’italien par Jean Thibaudeau, Seuil, 156 p. [nouvelles]
Entre le Mal obscur et Cosmicomics, rien apparemment de commun sinon que leurs auteurs sont Italiens et ont tous deux commencé à publier après la guerre. D’un côté, un énorme roman dont les phrases s’enroulent et glissent comme des spaghettis, un personnage qui se regarde, préoccupé par sa santé mentale, de l’autre, des nouvelles denses, brèves, un narrateur mythique, protéiforme, témoin farceur de l’histoire du monde. Voilà bien qui n’est pas comparable. Seul le hasard, dirait on, la coïncidence des publications, ce hasard que redoute le scénariste de Berto et que le Qfwfq de Calvino jetterait volontiers comme une boule dans les quilles du déterminisme, a pu nous les faire réunir. À moins que…
Le Mal obscur est l’histoire d’une névrose. Névrose réelle, névrose réinventée, Berto nous avertit au départ que, si tous les livres sont autobiographiques, lorsque l’auteur parle de lui-même : « d’une part le narcissisme et d’autre part le plaisir de conter ont chance alors de le conduire jusqu’à une déformation malicieuse des personnes et des faits ».
Le conflit qui est à l’origine du mal est classique ; la révolte avortée du fils contre le père aboutit à un sentiment de culpabilité, à une soumission absurde et paralysante aux idées du père, idées cependant jugées néfastes et périmées dans les moments de lucidité. La situation est singulière et ne manque pas de cocasserie : le Surmoi du narrateur, scénariste à la petite semaine, romancier raté, séducteur à l’occasion pour se prouver qu’il n’a pas peur du sexe avant de s’engluer dans le mariage avec une ravissante et envahissante fillette, s’est intégré un maréchal des logis tout entier. Qui pis est, un maréchal des logis de carabiniers encore royaux avant la retraite et la transformation du “vieux” en chapelier. Le mal qui couvait obscurément depuis longtemps se déclenche après la mort du père, le fils se reprochant d’être arrivé “naturellement trop tard” pour assister celui-ci dans ses derniers instants.
Le récit de Berto, en longues phrases faites d’enroulements autour d’un même thème, coupé par des décrochements brusques dans un constant jeu de ressassement maladif et de rupture ironique, nous conte en même temps le développement de la névrose et la quête de ses origines, les mésaventures du narrateur avec ses souffrances réelles et imaginaires, avec ses médecins, avec sa femme, surtout avec l’ombre colossale et dérisoire du père. Devant nous, non sans pleurer et rire avec nous de ses pleurs, il pèle sa névrose comme un oignon, mais un oignon diabolique dont les peaux, à peine enlevées, se reformeraient. À travers cette descente aux enfers personnels, tantôt poignante, tantôt comique grâce à la distance que le narrateur prend vis-à-vis de lui-même, c’est curieusement toute l’Italie des quarante dernières années qui se dessine, avec l’opposition brutale de ses structures anciennes incarnées par le père et du bouillonnement de la Rome moderne, capitale d’un cinéma souvent facile, lieu de rencontre d’intellectuels intransigeants, “les radicaux”, centre enfin d’un tourbillon où toutes les idées s’exaltent, mais aussi se dissolvent comme le narrateur dans sa névrose.
 [Ci-contre : Doodle par Sophia Foster-Dimino célébrant Calvino en 2011]
[Ci-contre : Doodle par Sophia Foster-Dimino célébrant Calvino en 2011]Avec Calvino, ce n’est pas le passé d’un individu qui est en cause, mais tout le passé et le présent de l’univers, tous les diagnostics qu’on a pu formuler sur son origine, sa constitution, son évolution. Qfwfq, le narrateur, sorte de témoin éternel depuis la nuée primordiale, de voix pure permanente, indépendante de ses incarnations successives en coquillage, en saurien, en dinosaure, en homme, illustre par ses aventures personnelles souvent cocasses les hypothèses et théories des préhistoriens, des géologues, des physiciens, des cybernéticiens, de Darwin ou d’Einstein. Ainsi le voit-on jouer aux billes avec les atomes d’hydrogène sur la courbure de l’espace, ou, prisonnier de la géométrie euclidienne, ne pouvoir rejoindre dans une effarante chute intergalactique la belle Ursula qui tombe à ses côtés, ou encore aller ramasser le lait lunaire à l’époque où selon Darwin la Lune était très proche de la Terre, en un point du moins de son orbite.
Calvino, ici, part toujours de théories bien connues qu’il résume en quelques mots au seuil de ses nouvelles. Mais ce qu’il nous propose, c’est une rêverie sur la science, rêverie où paradoxalement tout s’enchaîne avec une effarante logique. À partir du moment où Qfwfq est là, vertébré à peine sorti de l’eau (que sa petite amie plus évoluée abandonne pour retourner vivre auprès de l’oncle poisson, pourtant vieux et râleur comme un bourgeois ancien combattant) ou bien personnage mythique qui trace des signes au bord de la galaxie ou qui échange des messages tous les deux cents millions d’années avec des créatures d’une autre galaxie, tout devient possible. L’art subtil de Calvino consiste essentiellement à combiner un décor cosmologique, rigoureusement scientifique, et des aventures, des réflexions, des actes et des sentiments qui ont un air étrange de quotidienneté. Quand, à partir d’une nébuleuse fluide et informe, les planètes commencent à se solidifier par condensation, les membres de la famille de Qfwfq se trouvent séparés brusquement, s’éloignent les uns des autres. Les oncles et les tantes ont les cris qu’ils auraient sur un bateau venant de rompre ses amarres et qu’ils ne sauraient pas diriger.
Aussi, Calvino, merveilleusement poète et humoriste ne cesse-t-il à la fois de nous parler du monde et de nous, de l’apparition de la vie et de ses travers journaliers, de mouvement des planètes et de ceux du cœur, de la force d’inertie et de celle de l’habitude. La mésaventure du dernier dinosaure, dont personne ne reconnaît la nature alors que ses ancêtres sont chargés de tous les péchés de la terre, et qui ne peut être aimé comme il voudrait l’être, pour ce qu’il est, est plus qu’une tendre histoire, c’est une parabole du racisme. La femme du capitaine, demeurant prisonnière de la Lune quand celle-ci s’éloigne, à la fois illustre le mythe de l’amour impossible et symbolise la perversité féminine. Derrière le jeu, Calvino glisse toujours un sens. Et si par deux fois, dans Un signe dans L’espace et Les années-lumière, il nous montre Qfwfq traçant et raturant des signes, captant et envoyant des messages dans l’espace, c’est que le signe, le message, la communication sont à l’origine de l’écriture, de la culture, de notre savoir du monde. Les graffitis que Qfwfq dessine au bord de la galaxie sont comme le premier effort pour figer un sens, la première trace signifiante, la première expression d’une conscience. « Indépendamment des signes, l’espace n’existait pas, et peut-être même n’avait jamais existé ». Et c’est bien par l’écriture que Calvino donne corps à ses récits cosmiques.
Mais ce qui rapproche Calvino et Berto apparaît maintenant. Tous deux cherchent à briser le récit traditionnel au profit d'une écriture dont les méandres chez celui-ci, la logique poétique chez celui-là, font surgir, par delà l’anecdote, images et significations, une écriture qui est d’abord quête de sens et parfois, chez Calvino, de son propre sens. En même temps, ni l’un ni l’autre ne renoncent à raconter une histoire, sauf à prendre avec elle les distances qui s’imposent. Et à travers cette contestation de l’histoire, l’humour s’installe. Sans doute Calvino va-t-il beaucoup plus loin que Berto qui parfois s’enlise dans son narcissisme, et Cosmicomics est un chef-d’œuvre d’imagination lucide, de rêverie concertée. Mais leurs livres témoignent d’un art romanesque qui se renouvelle en profondeur sans rien perdre de son charme, d’une écriture qui porte, tout en s’interrogeant sur sa portée.
► Claude Bonnefoy, La Quinzaine Littéraire n°55, août 1968.
***
 ◘ nota bene : La Quinzaine littéraire fut, grâce à un travail collaboratif soucieux de probité intellectuelle, pendant près de 50 ans, de 1966 à 2013, un observatoire attentif et amoureux de la littérature mondiale. Son esprit continue à animer la maison d’édition lancée par un de ses fondateurs, l’honorable Maurice Nadeau (1911-2013), passeur qui ne perdit jamais de vue la finalité des lettres, à savoir ouvrir au public la mise en question du monde. Il a fait connaître de nombreux écrivains parmi lesquels Jorge Luis Borges, Coetzee, Malcolm Lowry, Georges Perec, Nathalie Sarraute… Conseillons la librairie Maurice Nadeau à l’atmosphère érudite dans le Quartier latin, ouverte du lundi au vendredi : 5 Rue Malebranche, 75005 Paris.
◘ nota bene : La Quinzaine littéraire fut, grâce à un travail collaboratif soucieux de probité intellectuelle, pendant près de 50 ans, de 1966 à 2013, un observatoire attentif et amoureux de la littérature mondiale. Son esprit continue à animer la maison d’édition lancée par un de ses fondateurs, l’honorable Maurice Nadeau (1911-2013), passeur qui ne perdit jamais de vue la finalité des lettres, à savoir ouvrir au public la mise en question du monde. Il a fait connaître de nombreux écrivains parmi lesquels Jorge Luis Borges, Coetzee, Malcolm Lowry, Georges Perec, Nathalie Sarraute… Conseillons la librairie Maurice Nadeau à l’atmosphère érudite dans le Quartier latin, ouverte du lundi au vendredi : 5 Rue Malebranche, 75005 Paris.
 Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires