-
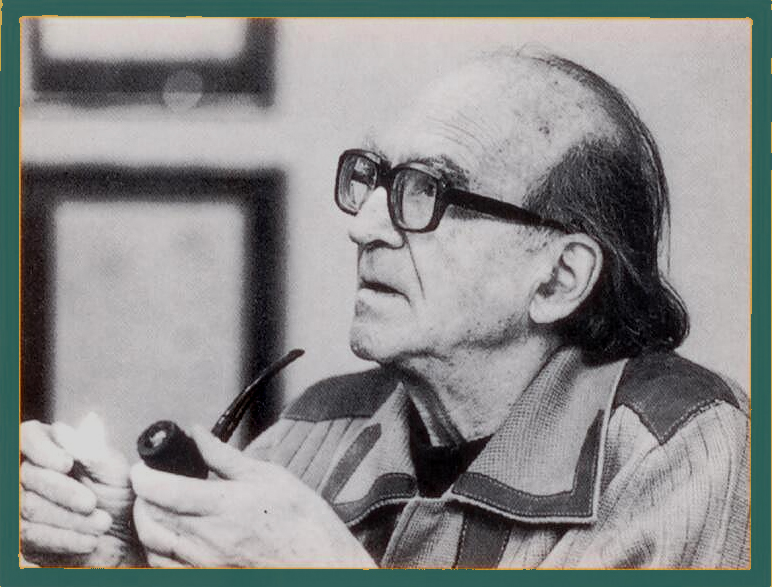 Hommage à Mircea Eliade (1907-1986)
Hommage à Mircea Eliade (1907-1986)Le 22 avril de cette année, Mircea Eliade est décédé à Chicago, à l’âge de 79 ans. Cet homme était un intemporel qui prétendait appartenir à « l’avant-garde de l’humanité de demain et d’après-demain ». C’était aussi un talent à facettes multiples, à l’aise aussi bien dans la sphère des belles lettres que dans le domaine rigoureux de la philosophie. Mais il était essentiellement un observateur scientifique des religions de l’humanité. Né à Bucarest en 1907 dans une famille d’officiers et de fonctionnaires, Mircea Eliade a servi pendant quelques temps son pays dans la diplomatie. S’il n’a pas suivi la tradition familiale, c’est partiellement à cause de la prise du pouvoir par les communistes en Roumanie et c’est surtout la conséquence de ses dons particuliers.
Parmi les impressions premières qui ont d’emblée déterminé la pensée de Mircea Eliade, il y a la profonde religiosité paysanne de sa patrie (1). Là, des traditions cultuelles immémoriales se mêlaient au christianisme, générant ainsi un syncrétisme créateur qui n’a jamais cessé de fasciner Eliade. À cette expérience existentielle première se superposèrent les souvenirs d’un voyage aux Indes, entrepris lors de sa ving-et-unième année. Eliade a étudié à l’Université de Calcutta puis s’est penché sur la spiritualité archaïque de cet immense pays, spiritualité richissime que lui ont communiqué très directement des maîtres de Yoga dans l’Himalaya. Le savoir qu’il emmagasine alors là-bas a servi de matériau pour sa thèse sur le Yoga, dont la version française de 1936 (2) a consacré sa renommée scientifique au-delà des frontières roumaines. Dès cet ouvrage, nous découvrons déjà toutes les méthodes d’investigation et les présupposés de la démarche éliadienne, qui seront exploités et systématisés dans les travaux ultérieurs (3). Eliade a toujours eu le souci d’éviter deux écueils qui guettent immanquablement la science qui prend les religions comme objets de ses recherches : soit s’essayer au déploiement d’une crypto-théologie soit ne pas prendre trop au sérieux les objets mêmes de l’investigation. Il a échappé à ces deux difficultés grâce à sa « saisie morphologique ». Eliade laisse à tout phénomène religieux sa dignité propre, car il considère chacun d’eux comme une “ hiérophanie” [manifestation du divin] originale, sans pour autant renoncer à un principe organisateur, qu’il appelait soit la « sur-historicité » soit la « non-historicité de la vie religieuse ». Il voyait, à l’instar de son prédécesseur Rudolf Otto, le “sacré” comme un “tout autre”, comme une catégorie indépendante, comme une grandeur non déductible d’une grandeur supérieure. Ainsi, Eliade pouvait considérer chaque manifestation du sacré comme égale en valeur et en dignité, que ce soit la vénération d’une “colonne du monde” ou les danses des Soufis musulmans, la parole extatique d’un chamane sibérien ou la scolastique de Thomas d’Aquin. Dans plusieurs travaux systématiques comme Les religions et le sacré (1949), Le sacré et le profane (1957) ou dans des études plus spécialisées comme, par ex., celle consacrée au chamanisme (1ère éd. 1951) [Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase, 1968, 2e éd.], Eliade a brossé les grandes lignes de cette interprétation globale des phénomènes religieux (4).
Il est par ailleurs ailleurs significatif que, dans cette quête, il soit entré en contact avec CG Jung et Ernst Jünger mais n'ait jamais pu trouver le moindre terrain d’entente avec une quelconque de ces théologies officielles occupées à détruire systématiquement les traditions spirituelles sur lesquelles, généralement, elles reposent. Avec cet échec de dialogue, Eliade a fini par comprendre qu’il existait une étroite relation entre le phénomène contemporain de sécularisation et l’incapacité des représentants attitrés des religions à conserver l’héritage qui leur a été confié. C’est la raison essentielle qui a motivé son désir de doter la science des religions d’une “fonction royale”, celle de rassembler le savoir religieux de l’humanité et de sauver ces acquis de l’emprise d’un monde sans foi. Et si Eliade, dans les dernières années de sa vie, a succombé progressivement au pessimisme, il n’a toutefois jamais abandonné son espoir en une “nouvelle humanité” (5). Sa vision était animée d’une conviction solidement enracinée : celle qui affirmait que la religiosité appartenait à la plénitude de l’être-homme et qu’après une ère de “voilement du sacré”, cette religiosité retrouverait sa dignité originelle.
L’image qu’Eliade se donnait de l’avenir montrait une profonde analogie avec les formes propres aux cultures traditionnelles et à leur mode de croyance. L’impression qui demeure en Eliade, après qu’il ait existentiellement approché le “christianisme cosmique” des paysans roumains et la spiritualité de l’Inde, c’est une solide et inébranlable confiance, une confiance qui sait que l’on peut réactiver le “mythe de l’éternel retour”. Cette confiance est aussi un rêve, celui qui voit un nouveau retour de l’homme dans le cycle que sempiternellement l’histoire détruit pour, ensuite et sans cesse, ré-inaugurer de nouveaux commencements, où la nature et le sacré se voient restaurés et réunis.
La part apportée par la Roumanie à l’histoire spirituelle européenne est encore largement méconnue. Mircea Eliade, qui a passé plus de la moitié de sa vie en exil en France ou aux États-Unis, doit être considéré pourtant comme un des représentants les plus originaux, les plus profonds et les plus féconds de ce paysage intellectuel roumain si peu exploré. En tant que professeur d’histoire des religions à l’Université de Chicago, il a marqué du sceau de son esprit des générations et des générations d’étudiants. Après sa mort, ses livres nous lèguent un colossal testament spirituel. Un testament, un héritage, pourtant encore incomplet quand on sait que son Opus Magnus, l’Histoire des Idées religieuses commencée en 1976, demeure inachevé. Souvenons-nous comment le journal Le Monde a annoncé la mort d’Eliade : en titrant « Le philosophe du sacré est mort ».
► Karlheinz Weißmann, Vouloir n°30, 1986.
♦ notes en sus :
1. Lire à ce sujet « La religiosité cosmique de la Roumanie » (B. Radulescu, 1997).
2. Il en donnera une version vulgarisée dans Techniques du Yoga (1948). Voir aussi ses deux études : « Le problème des origines du Yoga », « Chamanisme et technique yogiques indiennes », in : Yoga, science de l'homme intégral, Jacques Masui (dir.), Les Cahiers du Sud, 1953.
3. Cf. La nostalgie des origines : Méthodologie et histoire des religions (1971) : Les travaux de Mircea Eliade sont le produit d’une monumentale digestion d’ouvrages d’ethnologie, d’histoire, de philologie et de phénoménologie. Ici, il se penche sur ce substrat de sa pensée et, pour une fois, fait œuvre critique, tout en s’adressant à l’honnête homme plus qu’au spécialiste (p. 14). L’histoire des religions est l’objet principal de la suite d'essais qui constituent cet ouvrage. Une clé (sans doute pas la plus grande) de l’étrangeté de la conception de l’histoire des religions chez Eliade nous est donnée ici lorsque nous comprenons qu’en anglais comme en français, Eliade désigne par “histoire des religions” ce que recouvre le terme de Religionswissenschaft (p. 17) : histoire comparée des religions, mais aussi ethnologie, phénoménologie et sociologie, comme en témoigne le chapitre “L’histoire des religions de 1912 à nos jours” (p. 37-84). Ce survol qui embrasse les principaux auteurs de sciences humaines des religions en arrive à tirer de “l’histoire des religions” un enseignement essentiellement relativiste et universaliste : relativiste, parce que toute expression religieuse est conditionnée par son époque ; universaliste à cause du débordement qu’il suppose au-delà des religions connues. Mais le temps a, en définitive, peu de rapports avec cette historicité culturaliste ou phénoménologique, selon les perspectives : en tous cas, il revient à l’historien des religions, non de rassembler des faits selon une certaine chronologie, mais de les interpréter dans une perspective transhistorique (p. 147-48). Des autres essais, on retiendra surtout “mythe cosmogonique et histoire sainte”, où l’auteur confronte sa pensée à quelques auteurs dont Lévi-Strauss, auxquels il reproche un comparatisme trop étroit. Par ailleurs, M. Eliade s'intéresse au mythe non dans sa structure, mais dans la manière dont il renvoie à la « totalité primordiale » (p. 165). Mais où situer cette “totalité” ? Aux origines, certes, mais aussi à une eschatologie religieuse ou sécularisée. D’où les développements sur le mythe paradisiaque dans l’« American Dream », futur prodigieux et aussi paradis perdu. Mentionnant seulement le chapitre sur « l’initiation et le monde moderne » (p. 222-48), on remarquera à nouveau l’impact lévi-straussien sur le dernier chapitre : « Remarques sur le dualisme religieux : dyades et polarité » (p. 249-336). Mais chez M. Eliade le caractère opératoire de la dualité fait place à une typologie des rapports dualistes. (François-A. Isambert, Archives de sociologie des religions n°33, 1972).
4. Cf. L'“Homo religiosus” et son expérience du sacré : Introduction à une nouvelle anthropologie religieuse, Julien Ries. Cerf, 2009.
5. Cf. David Cave, Mircea Eliade's Vision for a New Humanism, Oxford University Press, 1993.

Mircea Eliade et la Redécouverte du Sacré (documentaire de Paul Barba Negra pour France Régions 3, 1987)

Mircea Eliade et la Garde de Fer
• Analyse : Claudio Mutti, Mircea Eliade e la Guardia di Ferro, Ed. All'Insegna del Veltro, Parma, 1989, 57 p.
[◘ Trad. fr. : • Mircea Eliade et la Garde de Fer, chez Ars Magna, Nantes, 2005 ; cf. aussi Les Plumes de l'archange, Quatre intellectuels roumains face à la Garde de Fer : Nae Ionescu - Mircea Eliade - Emil Cioran - Constantin Noica, éd. Hérode, coll. Les Deux Etendards, 1993, 144 p.] [Ci-dessous : Claudio Mutti]
 Au-delà des mythes de signes contraires qui circulent sur la Garde de Fer, au-delà des apologies ou des démonisations, on peut affirmer que le mouvement de Codreanu était profondément lié à la culture et à l'âme de la Roumanie ; tentant de se mettre au diapason de cette culture et de cette âme, d'en épouser toute la complexité, cherchant à s'identifier à elles, le mouvement de Codreanu luttait pour faire sortir la nation roumaine de son état de décadence, de ces conditions d'existence jugées inférieures et propres aux pays balkaniques marqués par l'esprit levantin. La Roumanie était sujette aux influences extérieures les plus disparates, qui aliénaient ses racines les plus anciennes, niées purement et simplement par une certaine culture de tendance “illuministe” qui s'incrustait dans une société roumaine aux réflexes largement ruraux et intacts. L'action de la Garde de Fer, dans cette perspective, apparaît comme une entreprise titanesque, parfois velléitaire, vu la disproportion entre les forces en présence (les ennemis de la Garde de Fer détenaient le pouvoir absolu en Roumanie). Les légionnaires voulaient faire renaître leur peuple en très peu de temps, par le biais d'un activisme radical, portant sur de multiples niveaux : existentiel, éthique, spirituel, où la politique n'était, finalement, qu'un instrument de surface, utilisé par une stratégie d'une ampleur et d'une épaisseur bien plus vastes et profondes.
Au-delà des mythes de signes contraires qui circulent sur la Garde de Fer, au-delà des apologies ou des démonisations, on peut affirmer que le mouvement de Codreanu était profondément lié à la culture et à l'âme de la Roumanie ; tentant de se mettre au diapason de cette culture et de cette âme, d'en épouser toute la complexité, cherchant à s'identifier à elles, le mouvement de Codreanu luttait pour faire sortir la nation roumaine de son état de décadence, de ces conditions d'existence jugées inférieures et propres aux pays balkaniques marqués par l'esprit levantin. La Roumanie était sujette aux influences extérieures les plus disparates, qui aliénaient ses racines les plus anciennes, niées purement et simplement par une certaine culture de tendance “illuministe” qui s'incrustait dans une société roumaine aux réflexes largement ruraux et intacts. L'action de la Garde de Fer, dans cette perspective, apparaît comme une entreprise titanesque, parfois velléitaire, vu la disproportion entre les forces en présence (les ennemis de la Garde de Fer détenaient le pouvoir absolu en Roumanie). Les légionnaires voulaient faire renaître leur peuple en très peu de temps, par le biais d'un activisme radical, portant sur de multiples niveaux : existentiel, éthique, spirituel, où la politique n'était, finalement, qu'un instrument de surface, utilisé par une stratégie d'une ampleur et d'une épaisseur bien plus vastes et profondes.Dans les faits, la plupart des militants du mouvement s'exprimaient dans un style volontariste, entendaient témoigner de leur foi, faisaient montre d'un activisme fébrile, parfois aveuglément agressif : lumières et ombres se superposent inévitablement dans le phénomène légionnaire. Cependant, la force de ces militants profondément sincères a attiré la sympathie des intellectuels attachés à la patrie roumaine, à sa culture nationale et populaire, à sa substance ethnique ; parmi ces intellectuels : Mircea Eliade, un jeune chercheur, spécialisé dans l'histoire des religions et du folklore.
Stefan Viziru, est-il Mircea Eliade ?
Récemment, la publication posthume en français et en anglais d'une partie des journaux d'Eliade a jeté une lumière nouvelle sur cette période et sur l'attitude du grand historien des religions. Claudio Mutti a analysé ces journaux, offrant à ses lecteurs, condensées en peu de pages, de nombreuses informations inédites en Italie. Ce travail était nécessaire parce qu'en effet nous avons toujours été confrontés à une sorte de “trou noir” dans la vie d'Eliade, sciemment occulté par l'auteur du Traité d'histoire des religions. Mutti, pour sa part, croit discerner les indices d'un engagement dans l'un des romans d'Eliade, La forêt interdite, aux accents largement autobiographiques, qui se limite toutefois aux années 1936-1948.
Le protagoniste principal de l'intrigue du roman, Stefan Viziru, pourrait, d'après Mutti, dissimuler Eliade lui-même, mais sous un aspect qui, au premier abord, n'est pas du tout crédible. Viziru, en effet, se manifeste dans le roman comme un antifasciste démocratique, bien éloigné des positions de la Garde de Fer, mais qui est néanmoins arrêté pendant la répression anti-gardiste de 1938, parce qu'il a donné l'hospitalité à un légionnaire. Dans un tel contexte, Mutti estime très significatif le jugement exprimé par Viziru quand il s'adresse à un autre prisonnier de son camp d'internement : « Vous et votre mouvement accordez une trop grande importance à l'histoire, aux événements qui se passent autour de nous. La vie ne mériterait pas d'être vécue si, pour nous, hommes modernes, elle ne se réduisait exclusivement qu'à l'histoire que nous faisons nous-mêmes. L'histoire se déroule exclusivement dans le Temps, et, avec tout ce qu'il a de meilleur en lui, l'homme cherche à s'opposer au Temps […]. C'est pour cette raison que je préfère la démocratie, parce qu'elle est anti-historique, je veux dire par là qu'elle propose un idéal qui, dans une certaine mesure, est abstrait, qui s'oppose au moment de l'histoire ». Sous bien des aspects, nous retrouvons, dans ce jugement de Viziru, tout Eliade, avec son refus d'un devenir linéaire, absolu, quantitatif, totalisant.
Justement, Mutti nie que l'identification Viziru-Eliade puisse être poussée au-delà d'une certaine limite. Pour appréhender la position réelle d'Eliade vis-à-vis de la Garde de Fer — on a affirmé qu'il lui avait été totalement étranger — il faut lire le volume posthume de ses mémoires, concernant les années 1937-1960, où Eliade dément effectivement que le héros central de La forêt interdite est son alter ego, tout en donnant d'intéressantes précisions pour comprendre quelles furent ses positions politiques et idéologiques à l'époque. Eliade nous livre en outre d'intéressantes informations sur le climat qui régnait en Roumanie à la fin des années 30, au moment où le mouvement légionnaire connaissait un véritable triomphe. L'historien des religions nous décrit le sombre tableau des répressions gouvernementales contre la Garde de Fer : le roi et l'élite libérale-conservatrice au pouvoir cherchaient, par tous les moyens, à arrêter les progrès du mouvement légionnaire. Pour éviter toute provocation, Codreanu avait choisi la voie de la non-violence, mais le gouvernement, vu l'insuccès électoral des listes qui le soutenaient et vu l'augmentation continue du prestige légionnaire — comme l'écrit Eliade — opte pour le recours à la force : des milliers de membres de la Garde de Fer furent emprisonnés, à la suite de procédures d'une brutalité inouïe, qui semblent propres aux gouvernants roumains de toutes tendances, comme l'a prouvé encore l'histoire récente.
Mircea Eliade, assistant de Nae Ionescu
 Pendant la répression de 1938, plusieurs intellectuels qui avaient adhéré au mouvement de Codreanu furent arrêtés, tandis que le Capitaine était assassiné, la même année, par des sicaires du régime. Parmi les intellectuels embastillés, il y avait Nae Ionescu, un professeur d'université célèbre, dont Eliade était l'assistant. À propos de cette arrestation, il écrit : « De manière directe ou indirecte, nous étions tous, nous ses disciples et collaborateurs, solidaires avec les conceptions et les choix politiques du professeur ». Cette « syntonie » a duré — même si Mario Bussagli a dissimulé une divergence de vue précoce entre les deux hommes — car Eliade a prononcé le discours funèbre aux obsèques de son maître en 1940.
Pendant la répression de 1938, plusieurs intellectuels qui avaient adhéré au mouvement de Codreanu furent arrêtés, tandis que le Capitaine était assassiné, la même année, par des sicaires du régime. Parmi les intellectuels embastillés, il y avait Nae Ionescu, un professeur d'université célèbre, dont Eliade était l'assistant. À propos de cette arrestation, il écrit : « De manière directe ou indirecte, nous étions tous, nous ses disciples et collaborateurs, solidaires avec les conceptions et les choix politiques du professeur ». Cette « syntonie » a duré — même si Mario Bussagli a dissimulé une divergence de vue précoce entre les deux hommes — car Eliade a prononcé le discours funèbre aux obsèques de son maître en 1940.Au cours de la répression anti-gardiste, Eliade lui-même a été interné dans un camp de concentration, mais pour une période assez brève. Il refusa de signer une abjuration pré-rédigée du mouvement légionnaire, malgré les fortes pressions qui étaient exercées sur les prisonniers (et face auxquelles un certain nombre d'entre eux cédaient). Eliade affirme dans ses mémoires : « Je jugeai qu'il était inconcevable de me dissocier de ma génération en plein milieu de la terreur, quand on poursuivait et persécutait des innocents ». Une année auparavant, répondant à une question posée par le journal légionnaire Buna Vestire, Eliade avait déclaré : « Le monde entier se trouve aujourd'hui sous le signe de la révolution, mais, tandis que d'autres peuples vivent cette révolution au nom de la lutte des classes et du primat de l'économie (communisme) ou de l'État (fascisme) ou de la race (hitlérisme), le mouvement légionnaire est né sous le signe de l'Archange Michel et vaincra par la grâce divine […]. La révolution légionnaire a pour fin suprême la rédemption du peuple ». Dans cette phrase, transparait une adhésion au projet global de la Garde de Fer, qui n'est pas purement épidermique, de même qu'une mentalité bien différente de celle du personnage Stefan Viziru.
Après avoir consulté d'autres sources, Mutti soutient qu'Eliade a été candidat sur les listes électorales du parti de Codreanu et aurait été élu député peu avant la répression de 1938. Cette affirmation nous apparaît étrange, parce que si tel avait été le cas, si, effectivement, Eliade avait occupé un poste officiel et public, on l'aurait su depuis longtemps, sans même avoir eu besoin de recourir aux informations parues dans des publications jusqu'ici méconnues et rédigées par des légionnaires en exil, publications auxquelles Mutti pouvait accéder. Parmi les diverses mises au point présentées dans ce petit volume, signalons la partie visant à démontrer qu'Eliade était antisémite, ce qui est un mensonge et ne peut servir qu'aux détracteurs fanatiques de sa pensée. Toutes choses prises en considération, le travail de Mutti est équilibré quant au fond, en dépit de certains extraits qui idéalisent outrancièrement la Garde de Fer. Nous pouvons considérer que ce livre est une première contribution — qu'il s'agira d'approfondir — à l'étude d'un segment de la vie d'Eliade, tenue par lui-même dans l'ombre, pour des raisons somme toute bien compréhensibles. D'un segment de vie étroitement lié à l'une des plus tragiques périodes de l'histoire roumaine.
► Giovanni Monastra, Orientations n°13, 1991. (tr. fr. : RS)
♦ Sur ce sujet, on pourra aussi consulter : la 3ème partie de Mythologies du XXe siècle : Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade Septentrion, 2008 de D. Dubuisson comme exemple de déni d'apport d'Eliade à l'histoire des religions (alors que c'est pour sauvegarder les différents sens du sacré des peuples, patrimoine de plus en plus menacé, que celui-ci a investi cette discipline comme collecte descriptive exhaustive, à la manière des Frères Grimm avec la culture orale des contes). Lire la recension de Marc Cels plus bas. Signalons son précédent réquisitoire paru en 2005 : Impostures et pseudo-science : L'œuvre de M. Eliade.
Voir aussi : « Un mythe moderne, Mircea Eliade », P. Borgeaud in Exercices de mythologie, Labor & Fides, 2004 ; 4 lettres d'Eliade à Evola dans Dossiers H - Evola (L'Âge d'Homme). Voir aussi cet article en anglais de Guido Stucco, Eliade and Evola, et de C. Mutti traduit en roumain : "Capitanul si Italia".

pièces-jointes :
Un mythe moderne, Mircea Eliade
L’œuvre d’Eliade, on peut s’en rendre compte, est considérable. Et tout autant sa réception dans le domaine des sciences humaines. Même si ses travaux sur le Yoga ont fait date, je ne crois pas que les indianistes le reconnaissent comme un des leurs. Pas plus que les anthropologues spécialisés dans l’étude des religions australiennes. Quand au chamanisme, l’autre domaine où l’on cite souvent Eliade comme une autorité, il s’agit d’un chamanisme décrit de manière comparatiste, et tout entier construit autour de la notion, transculturelle et a-historique, d’extase (à savoir, pour Eliade, une expérience humaine primordiale et universelle). Alors même qu’elle semble évoluer sur le tard en direction d’une enquête de plus en plus respectueuse des contextes, l’œuvre d’Eliade demeure celle d’un philosophe qui interroge, en s’appuyant sur les données d’un comparatisme encyclopédique, ce qu’il nomme l’homo religiosus, un curieux bipède écartelé entre le sacré et le profane. Pour essayer de saisir le noyau conceptuel du système, je propose de m’arrêter un instant sur l’état le mieux connu de sa pensée, en dirigeant mon attention sur ses travaux de l’époque française, que je lis à travers le commentaire que représente, pour moi, l’enseignement que j’ai eu l’occasion de suivre à Chicago.
Un des meilleurs accès à cette pensée demeure Le mythe de l’éternel retour, son livre le plus programmatique. Eliade y situe d’emblée le lecteur au niveau de ce qu’il appelle l’ontologie archaïque. À savoir un univers de pensée traditionnel, celui de la pré-modernité, dont les témoins sont recherchés d’abord dans les sociétés anciennes (vieilles civilisations du Proche-Orient et de l’Asie, monde grec présocratique), mais aussi dans les cultures connues par les ethnologues, et dans les strates conservatrices des cultures modernes : christianisme des campagnes, ou spiritualités mystiques et hermétiques. Il y rencontre ce qu’il nomme l’homme archaïque. Ni un fossile, ni un survivant d’un autre âge, mais bel et bien une part de nous-même, la part essentielle.
“Archaïque” semble signifier ici “principiel”, qui relève des archaï (à la fois débuts, et principes arrachés au temps). Tout se joue en effet dans la distinction entre l’être et le réel, entre le sens et la contingence, entre le sacré et le profane. L’homme archaïque ne se satisfait pas de l’absurde contingence du monde où il évolue. Pour lui l’évènement, la chose, n’acquiert du sens que dans la mesure où elle est référée à un modèle exemplaire, sacré. Il vit dans un univers où le symbole, l’image mythique, revêt plus d’importance, plus d’être, que l’évènement ou la chose. Cela vient du fait qu’il est redevable d’une expérience fondamentale, de nature religieuse, qui lui rend évident que derrière le flux chaotique et dangereux des choses, derrière leurs apparitions fortuites et vides de sens, se cache un univers riche et puissant, réel et significatif. Cette expérience, de l’ordre du mystère, lui révèle que le sacré (où se situe le sens) peut se manifester à travers des images, des symboles.
Quand Mircea Eliade parle d’ontologie archaïque, on est invité à reconnaître, dans les religions dites “primitives” ou celles qui sont très anciennes, quelque chose qui ressemble à ce que Lévi-Strauss appelle la pensée sauvage (à savoir une manière concrète d’organiser de l’abstrait) :
« Il est inutile de chercher, dans les langues archaïques, les termes si laborieusement créés par les grandes traditions philosophiques : il y a toutes les chances que des mots comme “être”, “non-être”, “réel”, “irréel”, “devenir”, “illusoire”, et d’autres encore, ne se trouvent pas dans le langage des Australiens ou celui des anciens Mésopotamiens. Mais si le mot fait défaut, la chose est là : seulement, elle est “dite” – c’est-à-dire révélée d’une manière cohérente – par des symboles et des mythes » (Mythe de l’éternel retour).
Tandis que la pensée sauvage, chez Lévi-Strauss, « bricole » de l’abstrait avec du concret, élaborant ainsi, à l’aide des éléments du monde, un langage dans lequel une pluralité de sens pourra être investie (au gré des contextes culturels et sociaux), chez Eliade le langage du mythe n’est pas un simple outil de communication, une matrice logique en soi dépourvue de sens. Une “chose” d’emblée y est dite, « révélée de manière cohérente ». L’image, le symbole, sont définis par un contenu, qu’il appartient à l’analyste (à l’historien des religions) de formuler en termes abstraits. Du sens est présent, perçu d’emblée, dans chaque énoncé mythique. Mais ce sens, pour être pleinement compris, demande à être ramené à une forme essentielle, exemplaire, archétypique. Le contexte où du sens apparaît constitue, autant qu’une condition d’énonciation, un obstacle à la pleine compréhension.
En effet, « les formes historico-religieuses ne sont que les expressions, infiniment variées, de quelques expériences religieuses fondamentales… Si l’on analyse toutes ces expressions, on commence à voir les structures de l’univers religieux : on devine les “archétypes”, les modèles de ces Figures divines qui essaient de se “réaliser” et de “communiquer” entièrement et ne réussissent, cependant, qu’une nouvelle “expression”. Car tout ce qui se “réalise”, c’est-à-dire est exprimé concrètement, est inévitablement conditionné par l’Histoire. Toute expression religieuse n’est donc qu’une mutilation de l’expérience plénière » (Fragments d’un journal, I).
Au fond, les religions archaïques, toutes les religions archaïques, n’auraient qu’une seule théologie idéale, à l’expression de laquelle chacune œuvrerait de manière fatalement inadéquate. Seul l’historien des religions, en définitive, serait capable d’en formuler l’expression adéquate, sous la forme d’une « morphologie du sacré ». Loin d’être le simple produit des diverses expériences religieuses incarnées dans l’histoire, cette théologie idéale serait l’énoncé de ce qui fonde et motive ces diverses expériences, leur origine archétypique :
« Il n’existe pas une forme religieuse qui ne tende à se rapprocher le plus possible de son archétype propre, c’est-à-dire à se purifier de ses alluvions et de ses sédiments “historiques”. Toute déesse tend à devenir une Grande Déesse en incorporant tous les attributs et fonctions que comporte l’archétype de la Grande Déesse. De sorte que nous pouvons enregistrer déjà un double processus dans l’histoire des faits religieux : d’un côté, une apparition continue et fulgurante d’hiérophanies et, par suite, une fragmentation excessive de la manifestation du sacré dans le Cosmos ; de l’autre, une unification de ces hiérophanies par l’effet de leur tendance innée à incarner le plus parfaitement possible les archétypes et à réaliser ainsi pleinement leur structure propre » (Images et symboles).
Tandis que chez Lévi-Strauss le mythe se parle à travers des hommes bien réels, comme une musique qui les dépasse mais à laquelle il appartient à chaque auditeur de donner un sens, un sens pluriel dont cette musique, précisément, constitue la condition de production, chez Eliade le mythe devient l’expression fragmentaire, éclatée, d’un sens (un seul, totalitaire) qui n’appartient pleinement qu’à un homme idéal, arraché à tout contexte, à toute histoire. Dans la mesure où la démarche d’Eliade se veut transhistorique et vise à mettre au jour des structures universelles, elle pourrait se définir comme une théologie de toutes les religions ou, peut-être, une théologie sans religion, puisque le chercheur pour sa part occupe irrémédiablement le lieu de l’exil. Théologie d’une religion arrachée à l’histoire, l’histoire des religions devient, avec Eliade, une quête marquée par la nostalgie de l’origine perdue. Cette quête se fait contre l’histoire, contre le temps considéré comme procès de dévalorisation des archétypes, des images fondamentales dont le chercheur tentera de reconstituer la morphologie idéale.
Transhistorique et transculturel, le projet d’Eliade vise à reconstituer à l’aide du comparatisme (un comparatisme mobilisant une très remarquable érudition), un système de pensée qui n’est au fond celui de personne. Tel est du moins un des versants de cette approche décidément dialectique. L’autre versant, auquel Eliade attache de plus en plus d’importance, c’est celui qui redescend de l’archétype vers l’histoire : partant du même, on va pouvoir appréhender ce que devient l’archétype, une fois déchu, une fois incarné dans tel ou tel contexte, dans telle ou telle circonstance mutilante. De ce point de vue, chaque religion, chaque spiritualité inscrite dans l’histoire pourra faire l’objet d’une monographie, en tant qu’elle représente un effort particulier, spécifique et pathétique, visant à exprimer ce que serait l’expérience plénière, a-historique. C’est cette deuxième perspective, étroitement solidaire de la première, qui oriente l’écriture des trois volumes de l’Histoire des idées et des croyances religieuses. Chaque civilisation y apparaît dotée d’un style particulier, d’une manière propre de s’arracher à l’histoire en visant ce qu’aucune, abandonnée à elle-même, n’aurait le privilège de pouvoir exprimer totalement. Quand il se tourne vers l’histoire, Eliade le fait pour analyser, en fait, des styles particuliers de procès intentés à l’histoire.
C’est ainsi qu’il ne sait trop que faire de la Grèce. Le mot mythe, et la chose aussi, sont grecs. Mais les Grecs, à qui nous devons ce mot et cette chose, ont inventé l’individu, la raison et la littérature (en d’autres termes l’histoire, dans laquelle ils se plaisent). Eliade, par conséquent, quand il interroge la notion de mythe, considère que le meilleur terrain d’observation n’est pas la littérature grecque. L’écriture, pour lui, est une forme de trahison, par rapport à ce qui serait une véritable tradition. Privilégiant l’oralité (ou plutôt : un rêve d’oralité), il préfère se tourner vers ce qu’il appelle l’« archaïque ». Mot fétiche, mais qui désigne à sa manière un fantasme étonnamment partagé, fût-ce sous d’autres appellations : peuples sans écriture, sociétés d’avant l’État, sans histoire ou contre l’histoire, bons sauvages. Le postulat sous-jacent à cette vision des choses s’exprime chez Eliade en une fameuse formule : la nostalgie des origines. Il y a l’avant histoire (in illo tempore), et il y a “nous”. Entre deux, peut-être, à côté du judaïsme dont les prophètes inscrivent Dieu dans l’histoire, le “miracle grec”, marqueur de la séparation, du manque, de la perte.
L’histoire, comme par définition, serait malheureuse. Règne de la contingence et du « jeté-là », elle interviendrait comme une instance de non-sens, de privation de sens. Eliade parle de la terreur de l’histoire, en se référant particulièrement à sa situation d’exilé, par rapport à une Roumanie emblématique, paysanne et conservatrice des traditions, la Roumanie de la Mioritza. […]
« Ce n’est pas autrement, ajoute Eliade, que les Roumains, comme d’autres peuples de l’Europe orientale, ont réagi devant les invasions et les catastrophes historiques. Ce que j’ai appelé ailleurs “la terreur de l’histoire”, c’est justement la prise de conscience de ce fait : que, nonobstant tout ce qu’on était prêt à accomplir, malgré tous les sacrifices et toute espèce d’héroïsme, on est condamné par l’histoire, puisqu’on se trouve au carrefour des invasions… » La référence est faite ici au 4e chapitre du Mythe de l’éternel retour, précisément intitulé « La terreur de l’histoire ». Eliade, dans ce chapitre, oppose l’« homme historique » (celui de la modernité), « qui se sait et se veut créateur d’histoire », avec l’homme des civilisations traditionnelles « qui avait à l’égard de l’histoire une attitude négative », qui savait abolir périodiquement l’histoire grâce à la répétition de la cosmogonie et à la régénération ritualisée du temps ; ou bien, pour le dire d’une autre manière : qui savait donner une signification métahistorique aux événements historiques, afin de leur conférer du sens.
Le mythe, dans une telle vision des choses, devient une défense contre l’histoire. Il tendra ainsi à transformer un personnage historique en héros exemplaire, ou un évènement en catégorie (archétype). Le christianisme, comme religion de l’homme moderne, s’avère religion de l’homme déchu : « L’histoire et le progrès sont une chute impliquant l’un et l’autre l’abandon définitif du paradis des archétypes et de la répétition » 34. Il faut reconnaître que le combat du mythe contre l’histoire, chez Eliade (toute manifestation historique du sacré tendant désespérément à rejoindre la forme pure d’un archétype, toutes les déesses s’efforçant de se confondre avec la Grande Déesse) relève d’une rhétorique très largement partagée à son époque, une rhétorique à laquelle même un Lévi-Strauss, pourtant aux antipodes de l’éliadisme, n’est pas étranger. Lévi-Strauss, pour qui le mythe se définit comme une machine à vaincre le temps. D’abord la temporalité du récit lui-même, mais aussi l’histoire tout court. Les peuples sans écriture, qui constituent la matière de son enseignement, sont des peuples qu’il aimerait imaginer sans histoire. Chez Eliade, toutefois, on ne peut s’empêcher d’avoir le sentiment que l’histoire à laquelle il veut échapper devient, via l’exemple de la Roumanie, une histoire personnelle.
On assiste en effet, chez lui, à une tentative obstinée de ramener sa propre vie à une œuvre, à la fois scientifique et littéraire. Une tentative de fondre en un seul tout l’histoire personnelle, l’enseignement du professeur et l’écriture du romancier. L’autobiographie, de ce point de vue, fait partie intégrante du projet de recherche. Et comme celui-ci, elle semble revenir sur elle-même régulièrement, à la manière d’une spirale, ou mieux encore d’un labyrinthe dont on finit par soupçonner qu’il désire cacher un centre. […]
► Philippe Borgeaud, in : Exercices de mythologie, 2004.

Mal connu du grand public et pourtant célèbre, le roumain naturalisé français Mircea Eliade, qui vient de mourir à l’âge de 79 ans à Chicago, restera comme un des pionniers de l’histoire et de la philosophie des religions.
Né le 9 mars 1907 à Bucarest, il fut pris très tôt par le démon de l’écriture : c’est en effet à 14 ans qu’il publia son premier article, et son œuvre purement littéraire aurait suffi à le rendre fameux puisqu’il ne cessera d’écrire, sa vie durant, un nombre impressionnant de nouvelles et de romans. Étudiant à la faculté des lettres et de philosophie de Bucarest, Mircea Eliade obtient en 1928 son diplôme avec un mémoire sur La philosophie italienne de Ficino à Giordano Bruno. Disciple de Nae lonescu, il s’intéresse très tôt au monde indien : ayant obtenu une bourse du Maharadjah de Calcutta, il choisit de faire sa thèse de doctorat sur l’histoire comparée des techniques de Yoga et s’inscrit à l’université de cette ville. Il restera finalement cinq ans en Inde, effectuant notamment un séjour dans un ashram himalayen, et ajoutant à sa connaissance de l’italien, de l’anglais, de l’hébreu et du persan celle du sanskrit.
De retour en Roumanie en 1932, il enseigne l’histoire des religions et des philosophies indiennes et continue de publier de nombreux articles, des romans (Isabelle, La nuit bengali, Maitreyi), ainsi que des récits d’inspiration fantastique, où la sensibilité de l’âme roumaine a toujours trouvé son climat d’élection, et qui font assez rapidement de lui un auteur à succès.
Il ressort de témoignages concordants *, lui-même ayant été très peu prolixe sur cet épisode de sa vie (on chercherait en vain dans les deux tomes de ses Fragments d’un Journal au titre évocateur, la moindre confirmation de ceci), qu’il fut membre actif de la Garde de Fer, au point d’avoir dirigé le cuib “Axa” de Bucarest, lequel avait pour objectif de rassembler des personnalités du monde culturel et universitaire roumain. Cela lui valut notamment, en 1938, d’être incarcéré au camp de concentration de Miercurea Ciuc où se trouvait déjà, en compagnie d’autres légionnaires, son turbulent maître Nae lonescu. C’est d’ailleurs dans le cadre de ses activités au sein de la Légion de l’Archange Saint Michel qu’il fit la connaissance de Julius Evola, venu à Bucarest pour rencontrer Corneliu Zelea Codreanu (et qui traduisit plus tard en italien, sous le pseudonyme de Carlo d’Altavilla, son ouvrage intitulé Le Chamanisme et les techniques archaïques de l’extase).
Attaché culturel à Londres (1940) puis à Lisbonne jusqu’en 1945, Mircea Eliade s’installe à la fin de la guerre à Paris, où il enseigne comme professeur étranger à l’École des Hautes Études de la Sorbonne, et c’est en français qu’il écrit Techniques du Yoga (1948), Traité d’histoire des religions (1949) auxquels succéderont Le Mythe de l’éternel retour (1951), Images et Symboles (1953), Le Yoga : Immortalité et Liberté (1954), Forgerons et Alchimistes (1956), Mythes, rêves et mystères (1957) et Naissances mystiques (1959).
Il n’en continue pas moins d’écrire, en roumain cette fois, des nouvelles et des romans — et notamment La forêt interdite (1955), qu’il considère comme son chef-d’œuvre — en conservant toujours volontairement une distance avec ses activités d’historien des religions (« L’écrivain en moi, confia-t-il un jour, tint à tout prix à rester libre de choisir ce qui lui plaisait et de refuser les symboles et les interprétations que lui servait, sur un plateau, l’érudit-philosophe »).
C’est en 1958 que, nommé chairman du département d’histoire des religions à l’Université de Chicago, il quitte définitivement l’Europe pour s’installer aux États-Unis où il est mort des suites d’une longue maladie, le 23 avril 1986.
Publié par de respectables maisons d’édition comme Payot et Gallimard — chez qui le grand public commença de le découvrir au travers de courts mais denses ouvrages de vulgarisation comme Aspects du mythe ou Le Sacré et le profane, dans les années soixante —, Mircea Eliade fut assez rapidement “récupéré”par la culture académique, ce qui lui valut d’être fait successivement docteur honoris causa des universités de Yale, La Plata, Ripon College, Loyola (Chicago), Lancaster et Paris.
Dans cette récupération, dont il aurait été la victime consentante, certains ont vu, compte tenu de son engagement passé dans la “Garde de Fer”, un reniement pour ne pas dire une trahison. C’est une vieille querelle que celle consistant à reprocher à des gens célèbres de ne pas avoir mis au départ cartes sur table — oubliant que, trop souvent, c’est justement parce qu’ils ne l’ont pas fait qu’ils sont célèbres !
Dans le cas de Mircea Eliade, plutôt que d’habileté, il vaudrait mieux parler de prudence : qui ne se souvient des mésaventures de !’écrivain, roumain lui aussi, Virgil Georgiu ? Auteur du “best seller”La Vingt-Cinquième Heure, notamment, une critique conformiste et lâche le fit passer du pinacle aux gémonies sur la foi d’une fiche de basse police dévoilant son passé de légionnaire… Par-delà la personne de Mircea Eliade, du point de vue de la Vérité, à quoi aurait servi de dire certaines choses à visage découvert, sinon à déclencher immédiatement un tir de barrage de tout ce que le monde universitaire compte de mafias et d’académies à l’enseigne du confort intellectuel et de la vigilance anti-fasciste ? Avec comme conséquence de disqualifier et de rejeter dans l’ombre une approche du sacré qui n’est sans doute pas sans défauts, d’un point de vue traditionnel, mais qui a amené un certain nombre d’Occidentaux à considérer avec des yeux neufs les “primitifs”et, par contrecoup, le monde moderne et ses “conquêtes”.
Le terrorisme intellectuel est tel que certaines idées doivent parfois être énoncées visière baissée — selon une technique que l’on pourrait assimiler à celle consistant à “chevaucher le tigre” : ne pas s’opposer de front à l’animal déchaîné (en l’espèce, la culture dominante) mais l’utiliser — à la limite, quasiment comme un moyen de transport — en attendant son heure pour le maîtriser…
Quand bien même d’aucuns pourraient se demander si le succès que Mircea Eliade n’a cessé de rencontrer auprès de l’establishment culturel n’est pas dû davantage à ce qu’il n’a pas dit qu’à ce qu’il a dit, on ne saurait minimiser le rôle fondamental joué par le philosophe roumain dans le défrichement de voies où ne s’était jusque-là avent urée qu’une poignée de chercheurs. Parmi les nombreux mérites d’une œuvre qui demeure magistrale, on pourrait notamment citer sa redéfinition du mythe en tant que manifestation du Sacré, que “hiérophanie” ; sa description, ouvrage après ouvrage, de l’homo religiosus, dont les constantes échappent à la fois aux catégories de l’espace et du temps, et font de chacun d’entre nous le contemporain d’un chamane ou d’un chasseur du néolithique ; sa mise en évidence, dans les sociétés traditionnelles, du caractère religieux de toutes les activités humaines — qu’il s’agisse de l’alimentation, de la vie sexuelle ou du travail — en conformité avec des conduites archétypales qui “chargent” celles-ci d’un sens métaphysique ; sa dénonciation, enfin, de l’ethnocentrisme occidental, du préjugé évolutionniste, dont un J.O. Frazer fut le représentant typique — pour ne pas parler des présomptueux décryptages socio-économiques — au nom desquels, dans les mythes, on n’a voulu voir pendant longtemps que les balbutiements d’une pensée “préscientifique”, les tentatives maladroites et attendrissantes d’une explication du monde qu’il convenait de “démystifier”.
Comme le rappelait ici-même Philippe Baillet (cf. Totalité n°8, juillet-août 1979) à l’occasion d’une recension de l’ouvrage de Mircea Eliade L’épreuve du Labyrinthe, il revient également à cet auteur d’avoir permis « aux disciplines dites “traditionnelles” d’obtenir une place à part entière dans d’assez nombreuses universités ».
De cela aussi, quiconque ne nourrit pas systématiquement des préjugés d’autodidacte contre la Faculté ne peut que se réjouir sincèrement.
► Gérard Boulanger, Totalité n°25, 1986.
(*) Cf. notamment l’introduction de I. Marii à l’ouvrage de Ion Moua, L’uomo nuovo, Padoue, 1978, p. 11, et Radu Gyr, AI passo con l’Arcangelo, Edizioni all’Insegna del Veltro, Parme, 1982, p. 61. (Ces citations proviennent d’un article, « Eliade “Nobel” ? », de Claudio Mutti).

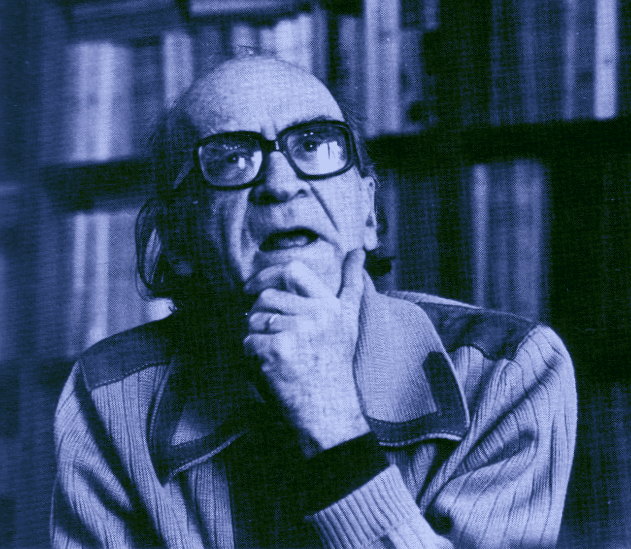 Un entretien avec Mircea Eliade
Un entretien avec Mircea EliadeLa disparition de Mircea Eliade, au printemps dernier [1986], a été curieusement passée sous silence dans la presse française. Né à Bucarest en 1907, auteur de romans où une inspiration à la fois mythologique et fantastique se mêle à une intense spiritualité personnelle, Eliade a surtout complètement renouvelé l’approche du fait religieux avec des essais tels que Aspects du mythe ou le Traité d’histoire des religions. En 1979, il avait accordé à Alain de Benoist un entretien qui était demeuré inédit. En voici le texte intégral, présenté par Jean Varenne.
***
Rares ont été les journaux qui donnèrent à la nouvelle de la disparition de Mircea Eliade, au printemps dernier, la place qui lui convenait. Peut-être était-ce dû aux circonstances (les élections !), peut-être aussi à l’éloignement (il vivait à Chicago), peut-être aussi au fait que son œuvre est maintenant acceptée, reçue et si l’on peut dire banalisée. C’est à la fois beaucoup d’honneur et d’injustice. N’oublions pas qu’Eliade, chassé de son pays en 1945, a tenté pendant quinze ans de s’insérer dans le monde universitaire français et que celui-ci, dominé alors par les marxistes, l’a rejeté au grand profit des “colleges” américains qui, eux, ne commirent pas la même erreur…
Eliade fut pourtant celui qui donna, définitivement, une assise scientifique à l’histoire des religions, discipline qui, avant lui, était restée inconsistance et fantaisiste. Tirée à hue et à dia, livrée sans défense aux rêveurs de tous bords, elle servait de caution à n’importe quelle entreprise. Bergson, Frazer, Freud, Weber, etc. : chacun y allait de sa petite théorie sur “les religions”, entretenant le public dans l’idée que l’on pouvait sur ce sujet dire tout et n’importe quoi. Les théologiens romains ne s’en plaignaient pas car cela suggérait que, seule, la religion (chrétienne) échappait à ces fantaisies.
En consacrant cinquante années d’un labeur acharné à “mettre de l’ordre dans la maison”, Eliade a travaillé d’une façon comparable à celle de Georges Dumézil à qui le liait d’ailleurs une solide amitié. Pendant que l’un montrait que nos ancêtres organisaient consciemment leur univers culturel selon les normes d’une idéologie fort complexe, l’autre s’attachait à mettre en évidence le fait que tout phénomène religieux témoigne d’une conception particulière du sacré. Préfaçant le Traité d’histoire des religions d’Eliade, Dumézil disait justement que le mérite de ce livre était de montrer que les religions relèvent du logos (c’est-à-dire de la pensée) et non du mana (cette “force” obscure et aveugle que l’on croyait déceler dans toute religion ― à seule fin, il faut le dire, de la dévaloriser).
C’est ce que disait Eliade à Alain de Benoist dans un entretien qu’il lui avait accordé le 24 février 1979 et qui était resté inédit. Nous avons pensé que le moment était venu de le publier, en hommage au maître disparu. (Jean Varenne)

 [En montrant la permanence de certains mythes fondamentaux dans des religions différentes, Mircea Eliade ne visait nullement à minimiser ou à effacer les spécificités culturelles. C’est ainsi que la présence du mythe du “tueur de dragons” dans le légendaire chrétien, tel que le personnifie saint Georges, constitue une “récupération” d’une figure essentielle de la mythologie indo-européenne. Ci-dessous : le “tueur de dragons” vu par Moebius (feu Jean Giraud, 1938-2012), vignette tirée de Ballade (1977), nouvelle graphique inspirée du poème "Fleur" de Rimbaud, parue dans le magazineMétal hurlant]
[En montrant la permanence de certains mythes fondamentaux dans des religions différentes, Mircea Eliade ne visait nullement à minimiser ou à effacer les spécificités culturelles. C’est ainsi que la présence du mythe du “tueur de dragons” dans le légendaire chrétien, tel que le personnifie saint Georges, constitue une “récupération” d’une figure essentielle de la mythologie indo-européenne. Ci-dessous : le “tueur de dragons” vu par Moebius (feu Jean Giraud, 1938-2012), vignette tirée de Ballade (1977), nouvelle graphique inspirée du poème "Fleur" de Rimbaud, parue dans le magazineMétal hurlant]◊ Depuis un quart de siècle, l’étude des religions a fortement évolué. Dans cette discipline, qu y a-t-il essentiellement de nouveau ?
Mircea Eliade : La première modification, c’est que les historiens des religions prennent plus au sérieux le phénomène religieux. On ne se contente plus des explications anciennes, qui faisaient appel à “l’animisme”, au “totémisme”, au mana. On s’intéresse au contraire à l’herméneutique, c’est-à-dire à l’interprétation des croyances et des mythes comme éléments symboliques d’une culture. Par ailleurs, on commence à se rendre compte que l’histoire des religions est une discipline totale, qui a des prolongements du côté de la psychologie, de la sociologie, de l’ethnologie. Cela implique (si l’on ne veut pas laisser ce travail à des chercheurs moins préparés) d’intégrer systématiquement les acquis particuliers dans une vision globale. C’est ce que j’ai tenté de faire en esquissant une histoire générale des religions.
◊ D’un autre côté, il est très difficile de synthétiser toutes les données nécessaires. Heureusement, vous êtes l’un des rares encyclopédistes de ce temps…
Peut-être parce que j’ai une conception plus “hégélienne”, plus “XIXe siècle”, de l’historiographie. Je crois que l’historien, même lorsqu’il ne peut ni tout savoir ni tout lire, doit chercher à acquérir une vue générale.
◊ Georges Dumézil dit qu’il faut “veiller aux carrefours”…
C’est une excellente formule.
◊ À ce propos, que pensez-vous de l’œuvre de Dumézil, sur les religions indo-européennes ? En France, c’est lui qui vous a introduit à l’École des hautes études. Il a également préfacé votre Traité d’histoire des religions, et, à votre tour, vous lui avez permis d’enseigner à Chicago…
L’œuvre de Georges Dumézil est inestimable. En premier lieu, il a réhabilité définitivement la mythologie comparée indo-européenne, qui avait été compromise par les disciples de Max Müller. D’autre part, sa théorie de la tripartition fonctionnelle s’est révélée extrêmement fructueuse. Enfin, sa préparation linguistique est unique : il manie couramment une vingtaine de langues ! Et il faut ajouter à cela l’éclat de sa prose scientifique, qui est digne de Renan.
◊ Votre méthode de travail diffère néanmoins assez fortement de la sienne. Dumézil est ce que l’on pourrait appeler un “généalogiste” : il cherche à établir en même temps l’évolution et la structure spécifique d’un ensemble de croyances. Vous êtes plutôt un “typologiste”, c’est-à-dire que vous faites des comparaisons sur une échelle plus vaste. Quelle est, à votre avis, la méthode la plus appropriée pour une première approche des faits religieux ?
Je pense que c’est la méthode “typologique” (ou “morphologique”). Mais les deux sont évidemment appelées à se compléter.
◊ N y a-t-il pas un risque, avec la méthode “typologique”, d’évacuer ce qui fait la spécificité de certaines croyances ? En comparant des mythes ou des éléments de croyances sortis de la structure organisatrice qui leur donne un sens, on peut en effet aboutir à des conclusions très trompeuses. Quelle est exactement la portée de l’interprétation universelle des mythes ?
Quand on cherche à dégager des points de contact ou de ressemblance, ce n’est pas du tout pour effacer les différences ! C’est même un peu le contraire, car on voit en même temps comment, à partir d’un thème commun, apparaissent toujours de nouvelles valeurs et de nouveaux symbolismes. Prenons l’exemple de l’Arbre cosmique, qui est un mythe que l’on retrouve dans des cultures très différentes. Au Proche-Orient, notamment chez les Babyloniens, on trouve un Arbre cosmique à sept branches, identifiées aux sept cieux planétaires. Mais dans le christianisme, cet Arbre cosmique devaient la Croix, véritable “arbre de vie planté au Calvaire”, par lequel s’opère la communication avec le ciel et le salut du monde. Cette notion de salut reprend et complète celles de fécondité universelle et de régénération cosmique, mais dans un contexte tout à fait différent. De même, dans les rites d’initiation. il y a toujours simulacre d’une mort et d’une résurrection. Mais cela peu prendre mille variantes, depuis les rites de la végétation jusqu’au baptême chrétien. Voyez également comme la notion de sacrifice a évolué dans la tradition indienne. On se trouve donc en présence de deux dimensions différentes. qu’il faut chercher à appréhender simultanément, en cherchant à la fois les points de ressemblance et les points de divergence.
◊ Quelle est la véritable valeur du folklore comme élément auxiliaire de l’étude des religions ?
C’est un domaine passionnant, encore mal exploré. Ce qui a été fait, c’est l’inventaire systématique du contenu des traditionnel des légendes. Mais on attend encore l’historien des religions qui classera cette documentation folklorique selon les acquis de sa propre discipline. À mon avis, ce sera l’œuvre de la prochaine génération.
Quand saint Démétrios prend la place de Déméter…
Au fil des siècles, des croyances remontant aux époques les plus différentes ont été intégrées dans le folklore. Certaines remontent au paléolithique, d’autres au néolithique ! D’autres sont des éléments de religions antérieures au christianisme que l’arrivée de la foi nouvelle a refoulé dans le domaine. mineur, des coutumes populaires. D’autres enfin renvoient à des hérésies, comme le gnosticisme ou le manichéisme. Tout cela correspond à des luttes d’influence, qui ont parfois duré des millénaires. La religiosité cosmique, refoulée par le judaïsme, est toujours là. De son côté, le christianisme a aussi repris à son compte de nombreuses croyances antérieures. Il s’agissait de rendre homologues des univers religieux différents, afin d’unifier culturellement l’œcumène. C’est ainsi que les innombrables héros et dieux tueurs de dragons de la tradition indo-européenne ont été identifiés à saint Georges. De même, en Grèce, après l’incendie du sanctuaire d’Éleusis, en 396, événement qui symbolise la fin du paganisme, un “saint Démétrios”, sacré patron de l’agriculture, prit tout naturellement la place de la déesse Déméter…
◊ Vous écrivez que « le mythe raconte une histoire sacrée, un événement qui a eu lieu dans le temps primordial » (Aspects du mythe, 1963). Vous dites d’autre part que seul peut constituer un mythe ce qui se rattache à des “archétypes” (le mot étant pris au sens de modèle exemplaire, paradigmatique). Y a-t-il des structures mythiques modernes ?
Le seul exemple moderne que l’on puisse citer est, à mon avis, le mythe marxiste-communiste de la fin des temps. La philosophie marxiste de l’histoire transpose ici-bas, de façon assez rigoureuse, la conception judéo-chrétienne d’un début et d’une fin absolus de l’histoire. On y retrouve l’idée une grande “bataille finale” eschatologique, qui sera suivie d’un état paradisiaque (la “société sans classes”), censé restituer l’Éden originel. Ici, c’est le prolétariat qui assume le rôle messianique du Juste soufrant. L’idée qu’il faut tout anéantir pour qu’un monde nouveau apparaisse n’est évidemment pas nouvelle. Le “mythe” du communisme peut ainsi être interprété comme une sorte de parodie profane du mythe de l’âge d’or. Et la raison de l’attraction qu’il exerce tient sans doute au fait qu’il a pris le relais d’un prophétisme millénariste judéo-chrétien.
◊ Dans vos entretiens avec Claude-Henri Rocquet, vous racontez comment vous avez découvert, en Inde, “l’homme néolithique”, c’est-à-dire l’importance du plus lointain passé, et la façon dont il peut s’inscrire dans le présent, par le biais des mythes et des symboles. Cela met en lumière l’importance de la mémoire collective ― cette mémoire à laquelle Platon et Cicéron attribuaient une valeur spirituelle. Aujourd’hui, les sociétés modernes ne sont-elles pas en train de perdre cette mémoire ?
Dans une certaine mesure, oui. Il y a encore un siècle, un paysan roumain, chinois, portugais ou indien, savait que la nature, à sa manière, exprime le sacré. Mais c’est peut-être ici que le chercheur prend le relais. Il y a une fonction cathartique de l’histoire des religions : elle nous aide à surmonter les inhibitions qui nous empêcheraient d’aimer notre histoire et tout ce qui l’a précédée.
◊ Dans votre journal, vous évoquez l’idée d’une fin prochaine de la civilisation occidentale. Mais en même temps, vous affirmez avoir une « confiance illimitée dans le pouvoir créateur de l’esprit ». Qu’en est-il exactement ?
Je ne suis pas pessimiste, car je ne crois pas à un déterminisme absolu. La culture occidentale se transforme aujourd’hui considérablement. Les Européens ont perdu leur complexe de supériorité. J’espère que ce n’est pas pour tomber, à l’inverse, dans un complexe d’infériorité. À certains égards, leur culture a aujourd’hui plus de chances qu’elle n’en a jamais eu de se renouveler. Et puis, on ne sort jamais de l’histoire. On ne s’en évade que par l’esprit.
◊ Enfin de compte, c’est “l’homme éternel” qui triomphe ?
C’est cela. Je crois qu’il y a des étapes, mais aussi une recréation, une éternelle recréation.
► Propos recueillis par Alain de Benoist, éléments n°60, 1986.

◘ Une œuvre encyclopédique
 Né à Bucarest en 1907, mort à Chicago en 1986, Mircea Eliade a publié de très nombreux ouvrages (dont beaucoup rassemblent des articles parus dans toutes sortes de revues, accessibles aux seuls spécialistes). Ses maîtres-livres restent le Traité d’histoire des religions (Payot, 1949), Le Yoga (Payot, 1954) et, surtout, l’Histoire des croyances et des idées religieuses (trois tomes parus, chez Payot, sur les cinq prévus). Signalons aussi Le Chamanisme (Payot, 1951) et des recueils d’articles tels que Le Mythe de l’éternel retour (1949), Le Sacré et le profane (1956), Aspects du mythe (1962), etc., tous parus chez Gallimard. On doit penser que plusieurs recueils posthumes pourront paraître dans un futur que l’on espère pas trop éloigné. Eliade était aussi romancier (La Nuit Bengalie, Forêt interdite, etc., tous chez Gallimard), auteur de nouvelles (par ex. Les Bohémiennes, aux éditions de l’Herne, 1978). Il tenait un journal (deux tomes parus, chez Gallimard) et, dit-on, écrivait des poèmes. Là encore on espère des publications posthumes. Signalons enfin qu’un Cahier de l’Herne lui a été consacré (1978), désormais accessible en édition de poche (1985).
Né à Bucarest en 1907, mort à Chicago en 1986, Mircea Eliade a publié de très nombreux ouvrages (dont beaucoup rassemblent des articles parus dans toutes sortes de revues, accessibles aux seuls spécialistes). Ses maîtres-livres restent le Traité d’histoire des religions (Payot, 1949), Le Yoga (Payot, 1954) et, surtout, l’Histoire des croyances et des idées religieuses (trois tomes parus, chez Payot, sur les cinq prévus). Signalons aussi Le Chamanisme (Payot, 1951) et des recueils d’articles tels que Le Mythe de l’éternel retour (1949), Le Sacré et le profane (1956), Aspects du mythe (1962), etc., tous parus chez Gallimard. On doit penser que plusieurs recueils posthumes pourront paraître dans un futur que l’on espère pas trop éloigné. Eliade était aussi romancier (La Nuit Bengalie, Forêt interdite, etc., tous chez Gallimard), auteur de nouvelles (par ex. Les Bohémiennes, aux éditions de l’Herne, 1978). Il tenait un journal (deux tomes parus, chez Gallimard) et, dit-on, écrivait des poèmes. Là encore on espère des publications posthumes. Signalons enfin qu’un Cahier de l’Herne lui a été consacré (1978), désormais accessible en édition de poche (1985).***
De puissants liens d’estime et d’amitié unissaient Mircea Eliade et Georges Dumézil. Fondés sur une méthode différente (généalogique chez Dumézil et typologique chez Eliade), leurs travaux n’étaient pas pour autant contradictoires. Ils étaient en fait appelés à se compléter. Sur ces deux auteurs, lire : Deux explorateurs de la pensée humaine : Georges Dumézil et Mircea Eliade, ouvrage collectif, Brepols, Turnhout (Belgique), 2003.

Julius Evola et Mircea Eliade : une amitié oubliée
Les rapports entre Mircea Eliade et Julius Evola sont encore, pour ainsi dire, peu connus. Extérieurement, ils se limitent à des citations réciproques et sans excès, mais il est évident qu’il y a beaucoup plus entre eux, même s’il me semble que personne n’a encore essayé d’analyser complètement leurs rapports personnels et les éventuelles influences réciproques du point de vue intellectuel. Ce dernier problème a été affronté par bien peu d’auteurs, et je pense à Ioan Culianu, Furio Jesi et Crescenzo Fiore, qui l’ont d’ailleurs fait à travers le filtre d’un préjugé que l’on pourrait bien qualifier d’idéologique, puisqu’ils considèrent presque comme une "faute" le fait qu’Eliade ait entretenu des rapports avec ceux que l’on définit ironiquement comme "les maîtres de la Tradition" (c’est-à-dire Guénon et Evola) et qui par conséquent acceptent chaque fois ce fait acquis comme un élément pour l’excuser ou bien au contraire, ils s’en servent pour lui reprocher certains choix méthodologiques et philosophiques.
Nous tenterons ici un début d’approche à cette question complexe en tenant compte du fait que deux points concrets limiteront notre recherche : le premier est qu’Evola n’a rien gardé de sa correspondance avec Eliade, correspondance échangée entre 1930 et la moitié des années 60 (tout comme d’ailleurs il ne gardera aucune lettre reçue, sauf quelques-unes de Guénon) ; le deuxième consiste dans le fait que l’on devrait savoir ce qu’il existe d’Evola dans les archives américaines d’Eliade. Pour cette reconstruction, nous nous basons d’une part sur ce que les deux protagonistes écrivirent dans leurs mémoires, sur ce que d’autres — surtout Claudio Mutti — ont découvert, et sur un ensemble de lettres d’Evola à Eliade qui proviennent des archives de Mircea Handoca à Bucarest : seize lettres en tout, dont cinq publiées par Handoca lui-même dans le premier tome de la correspondance d’Eliade, qu’il a édité (1). Quatre de ces cinq lettres ont été traduites dans le volume Mircea Eliade e lltalia (2), tandis que le contenu des onze autres lettres, inédites aussi bien en Roumanie qu’en Italie, est dû à la courtoisie et à la disponibilité du Prof. Roberto Scagno.
Mon point de départ est l’annotation que fit Eliade dans son journal, entre le 12 et le 18 juillet 1974, au moment où il apprend le décès d’Evola, survenu le 11 juin (3). Le point de départ suivant est le second volume, posthume, des mémoires éliadiennes, où certains de ces souvenirs sont confirmés et d’autres démentis. À propos de son voyage d’un mois en Italie, à partir du 23 mars 1951, Eliade affirme être allé à Rome, à Naples, à Taormina, à Catania, à Palerme, puis de nouveau à Naples et à Rome, et il évoque une fois encore sa visite chez Evola (4). Il y aurait beaucoup de considérations à faire sur ces deux extraits, mais une surtout. Les mots d’Eliade évoquent une attitude très noble de la part d’Evola, qui, malgré son handicap physique, accueille debout son hôte roumain qu’il n’avait pas vu depuis au moins quatre ans, il lui serre chaleureusement les mains, l’invite au toast habituel (lui marque le plaisir de le revoir à nouveau : donc il l’estimait, il le considérait — doit-on en déduire — comme un ami ; peut-être même comme un "homme au milieu des ruines" ; je dirais même — en me rappelant ses goûts de jeunesse — comme un représentant, un témoin justement de cette "Tradition primordiale" qu’Eliade jugeait "fictive". Evola se trompait, en partie ou tout à fait ; mais cette attitude lui fait honneur. Et il est surprenant qu’un spécialiste des rites n’ait pas compris le sens de ce toast, c’est-à-dire d’annihiler le temps parcouru et de renouveler ce qui avait existé dans une période lointaine.
Mais revenons à ce qu’écrit le savant roumain. Il y a avant tout une discordance entre son journal et ses mémoires en ce qui concerne la date de la rencontre avec Evola à Rome : est-ce qu’il y eut une seule rencontre, en 1949 ou en 1951 ? Ou bien y en eut-il deux, la première en 1949 et la deuxième en 1952-53 ? Je crois qu’Eliade a superposé les deux événements, parce qu’il a dû les reconstruire des années après en se fiant seulement à sa mémoire. En tout cas il y eut une seule rencontre certaine, à Rome, et elle eut lieu après le 11 mai 1952. Celle de 1949 peut être exclue absolument, puisque à l’époque Evola était encore en clinique à Bologne. De plus, si Evola écrivait à Eliade de Rome, cela ne put avoir lieu qu’à partir de mars 1950. Par contre, ce qu’Eliade écrivit dans la première partie du premier extrait de son journal de juillet 1974 (« … ses lettres que je recevais à Calcutta, dans lesquelles il me priait chaudement de ne pas parler de yoga ni de `pouvoirs magiques’, mais seulement de lui raconter des faits précis dont j’aurais été témoin »), correspond exactement à ce qui est dit dans une lettre qu’Evola envoie le 28 mai 1930 au jeune chercheur, au moment où celui-ci se trouvait à Calcutta, sur du papier à lettres portant l’en-tête de La Torre. Inédite en Italie, cette lettre a été publiée dans le premier volume de la correspondance éliadienne, éditée par Mircea Handoca en 1993. En voici le texte intégral :
« Cher monsieur, j’ai bien reçu votre lettre. Je me souviens parfaitement bien de vous. Un de vos amis ici en Roumanie m’avait déjà dit que vous étiez parti en Inde. Je serais très curieux de savoir ce que vous avez trouvé là-bas dans l’ordre des choses qui nous intéressent : celui de la pratique, plus celui de la doctrine et de la métaphysique. Je pensais et je pense encore (vu que je suis sur le point de conclure ce que j’étais tenu de faire en Occident) me rendre en Inde pour y rester. Un de mes correspondants m’a convaincu que cela n’en vaut pas la peine, sauf si l’on va vers le Cachemire ou le Tibet et que l’on a la possibilité de se faire introduire dans quelques-uns des très rares centres qui pratiquent encore la Tradition et qui sont extrêmement méfiants à l’égard des étrangers. C’est pourquoi je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m’informer sur ce que vous avez trouvé. Bien entendu : pas du point de vue culturel ou métaphysique. Veuillez trouver ci-joint : un des derniers exemplaires existants de la collection complète de Ur 1928, la collection complète de Krur 1929, mon livre sur les Tantra. Depuis ce dernier livre, j’ai publié : Imperialismo pagano (il s’agit d’une révolte contre la civilisation moderne), Teoria dell'individuo assoluto, Fenomenologia dell'individuo assoluto. Ces deux derniers livres consistent en l’exposition systématique et définitive de ma doctrine. Je dirige actuellement La Torre, dont je vous joins deux exemplaires. Je n’avais dirigé aucune revue avant Ur. En plus de ce que vous recevrez, il ne reste que la collection de Ur 1927, qui est épuisée. Si vous voulez, je peux m’informer si quelqu’un est disposé à vendre ses exemplaires et à quel prix. Je vous remercie de vous être souvenu de moi. Avec mes meilleurs vœux » (5).
Inconnue jusqu’aujourd’hui en Italie, cette lettre, que je n’hésite pas à qualifier d’une extrême importance, d’un point de vue strictement évolien également, est fondamentale parce que c’est à partir de celle-ci seulement que l’on apprend l’intention du penseur de se rendre en Inde, et même sa conviction d"’être sur le point de conclure ce qu’il était tenu de faire en Occident". Il se réfère peut-être à la publication de ses livres philosophiques et en même temps à ses difficultés à mettre ses idées en pratique, comme en témoignait son expérience de La Torre, qui aurait dû prendre fin en juin, soit le mois qui suit la date de cette lettre, parce qu’aucun typographe n’était plus disposé à l’imprimer. Mais cette lettre, à ce qu’il semble l’unique à notre disposition non seulement de toute la correspondance avec Eliade pendant son séjour en Inde, mais de toute la période jusqu’à la fin de la guerre, nous offre des informations significatives et soulève quelques questions. Les informations sont : 1) c’est Eliade qui écrit à Evola de Calcutta ; 2) ils se connaissaient déjà ; 3) ils avaient des amis communs à Rome ; 4) Eliade doit avoir demandé à Evola, qui la lui envoie, la collection de Ur 1928 et de Krur 1929, tout comme de L’Uomo come Potenza qui date de 1926, et des informations que Evola lui donne. Il est très probable que par la suite Eliade a reçu en Inde également les autres livres cités dans la lettre ; ensuite, après son retour en Roumanie, aussi les autres œuvres d’Evola, jusqu’à Rivolta contro il mondo moderno (1934), dont le titre dissimule déjà la définition de Imperialismo pagano que Evola donne dans sa lettre. D’autre part Eliade lut Rivolta et en fit une recension positive dans le numéro de Vremea du 31 mars 1935. Nous pouvons supposer que Evola lui a envoyé également son Mistero del Graal qui sortit en 1937. Se posent alors différentes questions qui ne sont guère faciles à résoudre. Par exemple, comment doit-on comprendre "je me rappelle parfaitement bien de vous" avec lequel il commence la lettre ? Il serait important d’y donner une réponse précise pour comprendre le genre de contacts qu’ils avaient et leur intensité. Eliade affirme qu’il a rencontré personnellement Evola seulement au "printemps 1937" à Bucarest ; d’autre part dans son journal personnel italien, c’est-à-dire dans les articles sur ses voyages en Italie publiés à l’époque sur des quotidiens roumains, et dans les souvenirs écrits par la suite, il ne cite jamais Evola parmi les nombreuses personnalités qu’il a rencontrées à Rome pendant ses séjours depuis avril 1927 à avril-juin 1928. Evola quant à lui, en reconstruisant la rencontre de Bucarest dans des textes écrits après la guerre, ne se le rappelle pas toujours bien la date ; quelques fois il la situe en 1936 (6), mais ensuite il se corrige et indique 1938 (7) . C’est 1938 la date exacte comme on le déduit des articles qu’Evola a publiés en Italie à l’époque et des références directes et indirectes qui y sont contenues, suivant la reconstruction irréfutable de Claudio Mutti (8). Cette rencontre eut lieu exactement en 1938, mais nous en reparlerons plus loin.
Alors, quel contact y eut-il auparavant, et avec quelle intensité ? Il semble que Mircea Eliade reçût et lût Bilychnis, la revue d’études religieuses éditée entre 1922 et 1931 par l’École Théologique Baptiste de Rome (ou bien, autre hypothèse, il a acheté plusieurs exemplaires d’anciens numéros de la revue à Rome an avril 1927). Il connaissait donc la signature d’Evola grâce aux essais que celui-ci y publia entre 1925 et 1926. Et de fait Eliade, à vingt ans, publia sur le numéro de Cuvântul de décembre 1927 un long commentaire sur Il valore dell occultismo nella cultura contemporanea. Peut-on penser qu’il en ait envoyé un exemplaire à Evola ? Qui sait, peut-être y eut-il un premier contact en cette occasion ?
C’est un fait acquis que durant le séjour romain d’avril-juin 1928 Eliade rassembla à la bibliothèque de l’Université de Rome également "une documentation supplémentaire sur l’herméneutique et l’occultisme, sur l’alchimie et les relations avec l’Orient" (9) : leurs sujets sont tous extrêmement proches non seulement d’Evola, mais de tout le "Groupe d’Ur" qui depuis un an déjà publiait ses propres fascicules. Eliade eut peut-être entre les mains certains de ces textes, ou bien a-t-il réussi à entrer en contact avec un des auteurs ? Ou peut-être est-il entré en contact avec des milieux néo-spiritualistes ou théosophiques qui lui donnèrent l’adresse d’Evola ? Il nous reste cependant toujours à résoudre le mystère de la phrase : « Je me rappelle parfaitement bien de vous ». Quand et comment ?
Eliade retourna à Bucarest en juin 1928 et repartit pour l’Inde en novembre. Il est possible qu’il ait écrit à Evola durant cette période de cinq mois et qu’ensuite il s’en soit allé sans rien dire à son correspondant italien ? Ceci peut être une attire solution et alors la phrase d’Evola peut faire référence à ce premier contact qu’il eut un an et demi auparavant. Il y a cependant ce : « Un de vos amis ici m’avait déjà dit que vous étiez allé en Inde ». Un ami roumain ? Italien ? Qui cela peut-il être ? Il est peu probable que cela soit un des grands noms qu’Eliade ait connus (par ex. Buonaiuti ou Gentile) (10) ; il s’agit là sans doute de quelque personnage des milieux magico-herméneutiques qui l’intéressaient et qu’Evola connaissait également. En somme, la lettre qu’Evola reçut de Calcutta n’était pas du tout signée par un nom inconnu. Et cette "étude restée au stade de manuscrit" consacrée à la pensée évolienne et commencée en 1928 (dont parle Eliade dans sa recension de Rivolta), quand a-t-elle été écrite ? Quoi qu’il en soit, cette nouvelle révèle titi intérêt pas seulement superficiel du jeune chercheur de 20 ans pour son collègue italien de 30 ans. Je dirais que cela présuppose l’existence d’une estime personnelle. Preuve en est la recension citée de Rivolta, où Evola est décrit comme « un des esprits les plus intéressants de la génération de la guerre » et où l’on donne cette image précise et générale de son œuvre : « Tout contribue à l’isolement d’Evola dans le cadre de la pensée et de la culture modernes : la rigueur de ses analyses philosophiques, son esprit critique et son courage à soutenir malgré tout une science `traditionnelle’, qu’il oppose à la science laïque, fragmentée, atomisée. Evola est ignoré des spécialistes, parce qu’il dépasse leur cadre de recherches. Il est inaccessible aux dilettantes, parce qu’il fait appel à une érudition vraiment prodigieuse, et en même temps il ne fait aucune concession lorsqu’il expose ses idées (c’est une façon de parler, parce qu’Evola n’a pas d’idées qui lui soient `propres’) ». Eliade explique en outre : « La position d’Evola est simple : selon cette idée qu’aucun idéologue n’a adoptée, il affirme et réaffirme les valeurs `traditionnelles’. Par ce terme cependant, il parle de chaque valeur créée par une civilisation qui ne fait pas de la vie un but en soi, mais qui considère que l’existence humaine est uniquement un moyen pour arriver à une réalité spirituelle, transcendante ». Eliade avait aussi des positions particulières d’interprétation : tout en disant que dans Rivolta il y a « une explication du monde et de l’histoire d’une grandeur fascinante », il le considérait un livre « à la fois anti-chrétien et anti-politique, et aussi adversaire des communistes et des fascistes » (11), ce qu’il n’est pas, si on le compare aux œuvres de Spengler, Rosenberg, Gobineau et Chamberlain ; ce qui est erroné, sauf si l’on ne considère pas ces auteurs — avec Massis, Huizinga, Keyserling, Guénon — dans le cadre de la "littérature de crise" (12) , comme on l’a définie.
Alors que dans le cadre de "certains voyages en Europe" (13) Evola décida de se rendre à Bucarest en mars 1938 pour y rencontrer Corneliu Codreanu, on comprend alors pourquoi il fit référence à ceux qu’il définit une fois les "amis roumains" (14) et une autre fois "un Roumain avec lequel il était déjà en relation, parce qu’il s’intéressait aux études traditionnelles" (15) — et que Claudio Mutti, après une série de recherches et de croisements entre différentes sources, identifie avec Vasile Lovinescu alias "Geticus" et avec Mircea Eliade (16). Eliade aurait été présent à la rencontre entre Evola et Codreanu (17). Mais ce dernier détail n’est pas si important que cela en réalité. Est important par contre le fait qu’il y eut une connaissance et une estime propres à pousser Evola à faire référence justement à Lovinescu et à Eliade. Estime et considération qu’Evola a conservées intactes pendant longtemps, à tel point qu’il souhaita reprendre les contacts avec le chercheur roumain après la guerre ; estime dont il fit preuve par la manière dont il accueillit Eliade à Rome, même si celui-ci ne semble pas en comprendre le sens profond. Evola devrait avoir écrit à l’Hôtel de Suède, où Eliade résidait, mais cela, pas avant mars 1950 ; il semble cependant que leur rencontre ne puisse pas s’être déroulée auparavant : comme on l’apprend des lettres qu’il a envoyées au poète Girolamo Comi à cette période(18), Evola rentra en Italie vers la mi-août 1948 ; son retour définitif à Rome eut lieu probablement en avril 1950. Evola écrit à Comi ni le 30 mars 1950, du "Centro Putti" de l’Ospedale n. 46 di Bologne : « Il y a dix jours environ, j’ai fait un saut à Rome après tant d’années d’absence ; j’y ai renoué un tas de contacts et j’y ai vu un tas de gens (…). Ensuite je suis reparti de nouveau pour Bologne ». Si Evola écrit qu’il est revenu à Rome seulement à ce moment-là, « après tant d’années d’absence », il est évident qu’avant cela il était à Bologne, et que Mircea Eliade ne peut pas l’avoir rencontré en 1949, sauf s’il s’est rendu à l’Ospedale n. 46, ce qui ne ressort pas de la première lettre écrite après la guerre par Evola au chercheur roumain et connue en Italie, celle du 15 décembre 1951, qui en tout cas ne doit pas être la toute première après la reprise de leurs contacts. Evola en effet la commence ainsi : « Cher Monsieur, il s’est écoulé un certain temps depuis que j’ai reçu votre dernière lettre, et notre relation s’est rétablie après la guerre » (19).
En raison de la perte de ses cahiers, Eliade se rappelle mal et confond donc les années, ou bien il superpose deux visites rapprochées. Je crois pourtant qu’il s’agit d’une seule visite, parce que, aussi bien dans son journal personnel que dans ses mémoires, il ne s’en souvient que d’une et il en donne une description similaire. Donc, d’après les lettres inédites d’Evola dont les originaux se trouvent dans les Archives de Handoca, cette rencontre peut être située de manière très précise : d’après les dates et les lieux de provenance des lettres, le penseur italien se déplaçait encore à l’époque avec une certaine facilité, grâce à différents amis, pour aller passer des périodes de repos dans diverses localités ou peut-être aussi pour des visites de contrôle au "Centro Putti". C’est ainsi, qu’ayant su qu’Eliade serait arrivé à Rome le 5 mai 1952 pour une conférence, il lui écrit de Bologne le 6 avril : « J’espère vous voir à l’occasion de votre passage à Rome, si vous restez quelques jours après la date de votre conférence (le 5 mai) ; du fait que je crains de ne pas être de retour à Rome avant le 11 mai ». Il lui écrit encore le 19 avril, toujours de Bologne : « Quand vous serez à Rome, écrivez-moi un petit mot, je vous en prie, à mon adresse — Corso Vittorio Emanuele 197 — pour me communiquer votre numéro de téléphone. Je vous avertirai tout de suite dès mon retour. Mon numéro de téléphone à Rome est le 562123 ».
On peut tout de suite remarquer que, si Evola écrivait à Eliade, ce dernier ne pouvait pas être en voyage pour l’Italie, mais devait avoir un domicile fixe à Paris. Donc, le souvenir du chercheur roumain d’une rencontre avec Evola en avril 1951 à la fin de son voyage en Italie est un souvenir erroné. Est correct par contre celui de l’avoir averti à l’avance de sa visite par un coup de téléphone, visite qui eut lieu donc après le 11 mai, vu que Eliade avait décidé, à ce qu’il semble, d’attendre le retour de Evola à Rome ; et il s’agissait probablement d’un mois de mai particulièrement lourd vu que, autre souvenir erroné, dans son journal Eliade considère qu’il s’agit même du mois d’août. Et c’est ainsi que le 25 mai Evola put écrire : « J’ai été très content de vous avoir revu après tant de temps ci et je souhaite que vos activités vous ramènent bien vite à Rome ». Ce fut donc la première visite. Est-ce possible qu’il y en ait eu une autre par la suite ? D’après les lettres en notre possession, dont la dernière est datée de mars 1954, il semble que non. Par la suite — jusqu’environ la mi-1960 — nous ne savons pas ce qu’il en est et nous ne pouvons pas donner une réponse certaine à cette question, même si en 1974 Eliade affirme avoir rencontré Evola pour la dernière fois "une dizaine d’années auparavant". Peut-être en relation avec la collaboration de Evola à la revue Antaios ?
Le principal sujet autour duquel tournent presque toutes les lettres que nous connaissons, est l’aide réciproque dans l’espoir de faire publier Eliade en Italie et Evola en France. Evola y est parvenu, Eliade non. On trouve encore une fois indirectement la confirmation de l’ostracisme de l’intelligentsia marxiste envers le chercheur roumain : avec l’autorisation de Cesare Pavese, Einaudi publia Tecniche dello Yoga en 1952 et Trattato di storia delle religioni en 1954, avec préfaces réductrices, presque exorcisantes, de Ernesto De Martino. Cette hostilité était parvenue aux oreilles de Evola : « On me dit qu’il y eut des problèmes pour l’édition Einaudi de vos traductions à cause d’un ridicule veto communiste. Est-ce vrai ? Si cela est vrai, il faut peut-être placer ces traductions de nouveau ? (Il s’agit, je crois, du Manuale et des Tecniche) »- écrit-il le 15 décembre 1951 (20).
Par ces lettres on découvre en outre combien Evola, sur le conseil d’Eliade, avait pris en considération certains textes de Georges Dumézil et de Heinrich Zimmer en vue d’une éventuelle traduction chez Bocca. Cela n’eut pas lieu ; le seul résultat positif fut la publication du Sciamanesimo d’Eliade, qui parut en 1953 traduit par Evola sous le pseudonyme de "Carlo d’Altavilla" (ce dont, curieusement, il n’informe pas l’auteur). Aucun résultat par contre pour le penseur italien, puisque ses livres, c’est-à-dire Rivolta et La dottrina del risveglio, envoyés à Payot, Denoël et Laffont, ne furent pas acceptés.
Les intéressés disent explicitement que leurs contacts se sont prolongés jusqu’aux années soixante. On ne sait pas quand et pourquoi ils se sont interrompus. Nous sommes sûrs qu’Eliade avait une opinion positive à l’époque sur Evola en tant que chercheur, c’est tellement vrai que dans son livre Lo Yoga, immortalità e libertà de 1954, il définit La dottrina del risveglio « une excellente analyse » (21), critiquée par contre par pas mal de spécialistes. De telle sorte que l’on doit constater avec un peu d’amertume la façon dont Eliade, en se souvenant, vingt ans après dans son journal, de son vieil ami italien disparu, le fait sans évoquer ce à quoi Evola s’est consacré — tout en étant « immobilisé pour le restant de ses jours » — dans la tentative de faire connaître son œuvre en Italie. Attitude qu’Evola continua d’avoir en dépit de différentes réserves, après l’interruption des contacts directs également, et cela est tellement vrai que, une fois qu’il obtint en 1968 la direction de la collection "Orizzonti dello spirito" aux Edizioni Méditerranée, il y fit traduite Mefistotele e l'androgine en 1971 et il y fit réimprimer dans une traduction revue Lo sciamanesimo en 1974.
Quel est le motif de cette sorte de “rémotion” ? Je crois qu’encore un fois la réponse se trouve dans la correspondance, à savoir les deux lettres de décembre 1951. Le 15 décembre Evola écrit :
« Est sortie récemment une nouvelle version revue et intégrée de ma Rivolta contro il mondo moderno et je pense que j’ai cité également votre Trattato. Mais à ce propos — je le dis un peu en riant — on devrait vous appliquer des Vergeltungen (22). Je suis frappé par le fait que vous ayez un souci constant de ne pas citer dans vos œuvres d’auteur qui n’appartienne étroitement à la littérature universitaire plus officieuse ; de telle sorte que l’on trouve amplement cité par ex. ce bonhomme si aimable qu’est Pettazzoni, tandis qu’on ne trouve pas un mot, non seulement sur Guénon, mais pas non plus sur d’autres auteurs dont les idées sont relativement plus proches à celles qui vous permettent de vous orienter avec certitude dans la matière que vous traitez. Il est évident qu’il s’agit d’une chose qui vous regarde vous personnellement ; néanmoins, cela vaudrait la peine de se demander, en fin de compte, si le jeu en vaut la chandelle, c’est-à-dire si cela vaut la peine que vous vous imposiez ces limites “académiques”… J’espère que vous ne m’en voulez pas pour ces observations amicales » (23)
Dans la lettre suivante, datée du 31, Evola répond à Eliade en faisant quelques affirmations qui permettent de comprendre l’attitude du chercheur roumain. Il écrit en effet ceci :
« En ce qui concerne vos explications à propos de vos rapports avec la “maçonnerie” académique, ils me semblent assez satisfaisants. Il s’agirait moins de méthodologie que de pure tactique, et contre la tentative d’introduire quelque cheval de Troie dans la citadelle universitaire, l’on ne pourrait rien faire. L’important serait de ne pas se laisser prendre dans un jeu d’alouettes, vu qu’au milieu académique correspond une sorte de “courant psychique”, avec la possibilité d’une subtile influence déformante et contaminatrice. Mais moi je crois que, aussi bien pour le fondement intérieur que pour vos probables relations avec des milieux différents du point de vue des qualifications, vous pourrez bien vous défendre de ce danger. En ce qui concerne la “méthodologie”, vous savez bien que je cherche à suivre une voie intermédiaire parce que, contrairement à la majeure partie des “exorcistes”, je me préoccupe aussi de produire une documentation assez satisfaisante du point de vue “scientifique” » (24).
Tout d’abord ces deux lettres nous révèlent peut-être d’autres souvenirs confus et une orientation erronée dans le temps : c’est probablement celle-ci la lettre « assez amère » dans laquelle, comme dit Eliade dans son journal personnel, Evola lui aurait reproché de ne jamais citer ni lui ni Guénon. S’il s’agit effectivement de cette lettre-là, comme on le voit bien, il n’y a aucune “amertume”, mais bien des “considérations amicales” comme en confirme le ton de la lettre. En outre Evola ne fait pas du tout allusion à lui-même. La réponse d’Eliade, comme on le déduit de la prochaine lettre d’Evola, est rappelée dans son journal seulement en partie — on ne peut pas dire si c’est par amnésie ou volontairement. En effet, Eliade doit avoir fait allusion au fait que ses livres sont différents de ceux des occultistes et qu’ils ne sont pas adressés aux `initiés’ ; mais ce que dit le penseur italien ne fait en rien le jeu d’Eliade : il suit « une voie intermédiaire » qui n’est pas la voie tout à fait “ésotérique” de Guénon, ni celle complètement “scientifique” d’Eliade. Du reste, comme le note Philippe Baillet, l’explication du Roumain n’est pas une explication des plus simples, mais elle est au contraire “simpliste” : « D’autre part nous aimerions beaucoup savoir où et quand Guénon et Evola ont écrit que leurs livres sont adressés seulement aux “initiés” »(25). Mais il y a d’autres éléments qui sont portés à notre connaissance. Face aux critiques "amicales" — et non “amères” — d’Evola, Eliade en 1951 dit des choses bien différentes de celles dites en 1974 : il justifie le fait de ne pas avoir cité des auteurs traditionnels et de n’avoir pas cité explicitement leurs œuvres comme une “tactique”, comme un “cheval de Troie” pour faire accepter dans le monde académique certaines idées et certains points de vue. Un "éclaircissement", celui-ci, qui apparaît à Evola « assez satisfaisant » pour autant que cela à la fin ne mène pas à une implication dans le “courant psychique” du “milieu académique”, qui produit « une influence subtile déformante et contaminatrice ». Evola cependant croit que cela ne se passera pas, parce qu’il considère que son ami roumain a un « fondement intérieur » bien sain. On comprend alors pourquoi Evola accueillit Eliade de cette manière chez lui : presque comme un frère de l’esprit qu’il retrouve après tant de temps ! Il se trompait, parce que Eliade continuera à ne pas citer les auteurs traditionnels dans ses œuvres destinées « au public d’aujourd’hui » (comme le dit Eliade). Il nous reste le doute que le “cheval de Troie” soit une justification de mauvaise foi pour ne pas faire de polémiques avec Evola, ou bien qu’en 1951 Eliade y ait cru vraiment, mais qu’ensuite il ait été tout à fait absorbé et transformé par son fameux "courant psychique" qui, selon Evola, se trouve dans les universités du monde entier.
Si le chercheur universitaire peut avoir été “déformé” et “contaminé”, si le chercheur Eliade a éloigné le chercheur Evola de sa propre production scientifique, tout en ayant accueilli ses propositions, suggestions et hypothèses, il n’en fut pas ainsi par contre pour Eliade narrateur. La narration est une activité qu’il plaçait avant celle d’historien des religions et pour laquelle spécifiquement il aurait voulu qu’on se souvienne de lui et qu’on l’apprécie, se gagnant une telle réputation de pouvoir aspirer au Prix Nobel — comme me le dit dans les années septante Mircea Popescu (le premier traducteur de Cioran en italien). Je suis en effet parfaitement d’accord avec l’analyse que Claudio Mutti fait du dernier roman publié par Eliade avant sa mort, Diciannove rose (27), et avec les conclusions auxquelles il arrive. Un des personnages ne peut que dissimuler Evola : il y a trop de coïncidences pour que cela soit un simple hasard. En effet Ieronim Thanase est un philosophe et ésotériste suivi par de nombreux jeunes et qui est “paralysé sur son siège” à cause d’une infection mystérieuse liée à une “erreur” — on ne comprend pas laquelle — commise dans le passé. Les raisons du comment, du pourquoi et d’un possible solution de son énigme physique rappellent les mots qu’Evola écrivit à propos de lui-même dans Cammino del cinabro. Les idées de Thanase à propos de la philosophie, de la tradition, du mythe et du symbole, rappellent celles exprimées dans Teoria, dans Fenomenologia et dans Rivolta, livres dont Evola eut connaissance tout comme il eut probablement aussi connaissance de Il cammino del cinabro. En 1963, à la sortie de ce dernier livre, les deux chercheurs étaient encore en contact ; ceci est tellement vrai que Evola a collaboré à Antaios, la revue dirigée par Eliade et Jünger, en y publiant trois essais. Pour ceux qui donc connaissent Evola, il n’y a pas de doute : l’étrange personnage de Ieronim Thanase en est une représentation romancée. Un hommage tardif alors du grand chercheur, de l’illustre chercheur de la Sorbonne et de Chicago, à l’ami italien, moins célèbre et toujours boycotté, dont pourtant il « admirait l’intelligence et surtout la densité et la clarté de la prose » ; il s’agit presque — interprété ainsi — d’une réparation post mortem pour l’avoir oublié (ou ignoré) dans ses innombrables publications "scientifiques". Et ici les mots de Evola semblent retentir : ces "observations amicales", mais également la demande de "réparations", de Vergeltungen, même si c’était "un peu en riant".
En tout cas, l’influence de Guénon et de Evola sur le jeune Eliade est d’habitude admise par certains exégètes de ce dernier. Ioan Culianu, par ex., considère « un devoir de compter aussi Guénon et Evola » parmi les auteurs qui ont « contribué de manière décisive à la formation de la théorie historico-religieuse de Eliade » (29) ; et Crescenzo Fiore, pour qui les « concordances entre la pensée éliadienne et celle de maîtres connus de la Tradition, comme Julius Evola et René Guénon, (ne sont) ni fortuites ni marginales » (30). De ces deux "maîtres de la Tradition", le jeune Eliade a tiré — à mon avis — les bases sur lesquelles il a élaboré sa construction théorique, qu’il "étaya" de références académico-scientifiques. Il y a quelques références possibles : le thème du folklore comme “récipient” d’une sagesse presque perdue ; la décadence du sacré dans le monde moderne ; le passage — disons même la censure — du temps cyclique et mythique des origines au temps linéaire et "historique" qui s’est produit avec l’avènement du christianisme ; le rapport entre mythe et histoire ; l’idée — typiquement évolienne — de la “rupture de niveau” et d’ouverture à un statut spirituel supérieur ; l’alchimie comprise dans le sens éminemment spirituel, à distinguer de l’art métallurgique ; la valeur intrinsèque du symbole ; évidemment l’an anti-historicisme de fond. Ce fut justement cette position idéale et "idéologique" qui a provoqué à Eliade tant d’ostracisme après la guerre, bien que Ernesto De Martino considère que la position d’Eliade « est fondée en substance sur un malentendu » (31) et que le directeur de la “collection violette” de Einaudi définisse « des réserves stupides extra-scientifiques » (32) le boycottage dont était l’objet le chercheur roumain. Ces “réserves” étaient tellement lourdes que la culture italienne la plus importante a ignoré Eliade pendant des décennies, en confiant cette traduction à des maisons d’édition "mineures" à partir de la seconde moitié des années 60, jusqu’à en parler de manière partiale à l’occasion de sa mort (33). À présent, les références de base auxquelles nous avons fait allusion ne sont rien d’autre que les « idées presque les plus proches de celles qui vous permettent de vous orienter avec certitude dans la matière que vous traitez », dont Evola fait un rappel explicite dans sa lettre du 14 décembre (34). Des idées qui resteront toujours le fil conducteur d’Eliade jusqu’à la fin de sa vie. De tout ceci, il ne faut guère s’étonner et encore moins s’indigner, en considérant ces idées comme une sorte d’“espion” de Dieu sait quelle perversion idéologique, comme cela fut fait en son temps. Furio Jesi, par ex., essaie de mettre en évidence « manipulations et technicisation, donc opérations avec des fins précises », d’habitude "politiques", dans le rapport avec le passé et avec le mythe (35), parce qu’elle est exactement ainsi — politique — son interprétation du mythe, qui résulte encore plus « manipulé et technicisé » de ce qu’elle aurait pu apparaître dans la pensée d’Eliade. La même chose est valable pour Crescenzo Fiore qui, tout en ayant compris exactement l’anti-historicisme comme architrave sur laquelle Eliade base toute sa construction théorique, il le présente comme quelque chose de négatif, puisque, à son avis, ce qui dans son « essai doit être considéré prioritaire est (…) de montrer les implications idéologiques qui servent d’échafaudage à tout l’œuvre éliadienne. En d’autres mots, il s’agit de faire ressortir cette “philosophie de l’histoire”, qui marque toute l’œuvre du chercheur et qui, qu’on le veuille ou non, le fait ressembler aux “Maîtres” connus de la droite traditionnelle » (36). En somme, une vraie dénonciation et pas une étude “scientifique”, justement parce que faite par quelqu’un qui a une forma mentis essentiellement “politique” et qui voit et interprète tout par cette clé exclusive, en pardonnant ou en condamnant.
Est plus serein, plus “scientifique” et acceptable par contre le point de vue de celui qui évalue ces références aux "maîtres de la Tradition" — ainsi définis sans sarcasme — pour ce qu’ils valent et donc examine le développement de la pensée d’Eliade non pas comme un élément a priori négatif et à dénoncer, mais comme un fait acquis à juger par rapport à ses inspirateurs, pour en évaluer la cohérence et l’incohérence, la conformité ou la difformité, l’évolution ou l’involution. C’est ce que fait Piero Di Vona, dans une longue et profonde analyse, en mettant en évidence les contradictions et les approximations d’Eliade justement par rapport à cette pensée “traditionnelle” dont ce dernier s’est nourri. Les conclusions de Di Vona peuvent donc se résumer ainsi : « La conception qu’Eliade a de l’histoire finit par rentrer elle aussi parmi les doctrines d’inspiration traditionaliste de notre siècle. Mais il s’agit d’un traditionalisme de valeur inférieure qui déteste les jugements définitifs sur le statut de l’homme contemporain, et qui est trop soucieux de s’accorder à la tendance historiciste, phénoménologique et religieuse dominante en Occident. De cela proviennent les incertitudes et les oscillations auxquelles s’expose Eliade, et dont la première est le fait de ne pas savoir définir avec certitude les limites entre l’homme traditionnel et l’homme moderne » (37).
En substance, résume Di Vona, « ne sont pas remis en question le sens et l’usage des noms, mais le rapport entre la tradition intemporelle et l’histoire, et le concept même de tradition chez Eliade. C’est cela qui est mal défini et variable. Sujet aux concessions les plus diverses de la culture contemporaine » (38). Avec les mots de Verona, nous sommes donc retournés au point de départ : à la formation, disons-le ainsi, "traditionnelle" d’Eliade et à la superposition progressive d’une culture "scientifique", "académique", "professorale", avec des affaiblissements successifs, des compromis, des incertitudes, des approximations et des changements. « L’Eliade académique résume bien Giovanni Monastra, de plus en plus inséré dans le monde de la culture officielle, après les discriminations et les censures, nous ne savons pas si par conviction ou par stratégie, modéra certaines de ses idées de départ et il sembla accepter, dans certains cas, des apports théoriques discutables » (39).
En conclusion de notre recherche, il reste justement cette contradiction de fond. Et pas seulement. Pour un de ces recours historiques qu’Eliade lui-même aurait jugés significatifs, à l’attitude qu’il eut avec le temps envers Evola, on peut reprendre les mêmes mots de la recension eliadienne de Rivolta contro il mondo moderno : « Evola est ignoré par les spécialistes, parce qu’il dépasse leurs cadres de recherche » (40). On pourrait parler d’une prophétie qui le concernerait à son tour.
► Gianfranco de Turris, Antaios n°16, 2001.
Texte paru dans Origini XIII, 1997. Traduction : Blanche Bauchau. Une version considérablement amplifiée de cet essai a été publiée dans AA.VV, Delle rovine e oltre : Saggi su Julius Evola, Antonio Pellicani Editore, Rome 1995. Pour se procurer le numéro spécial d’Origini consacré à Eliade : écrire à La Bottega del Fantastico, Via Plinio 32,1- 20129 Milan.
Notes :
- 1) Mircea Eliade, Si corrispondentii sai, édité par Mircea Handoca, Ed. Minerva, Bucarest, 1993, vol. I (A-E), pp. 275-280.
- 2) Mircea Eliade e l’Italia, édité par Marin Mincu et Roberto Scagno, Jaca Book, Milan, 1982, pp. 252-257.
- 3) Mircea Eliade, Fragments d’un journal II : 1979-1978, Gallimard, 1981, pp. 192-194. La traduction est de Gianfranco De Turris. Cf : « Il rapporto Eliade-Evola », édité par Giovanni Monastra, dans Diorama Letterario n°120, Florence, nov. 1988, pp. 17-20 ; et Claudio Mutti, Mircea Eliade e la Guardia di Ferro, Edizioni all’insegna del Veltro, Parme, 1989, p. 42.
- 4) Mircea Eliade, Mémoires II 1937-1960 : Les moissons du Solstice, Gallimard, Paris, 1988, pp. 152-155. La traduction est de Gianfranco De Turris.
- 5) Mircea Eliade, Si corrispondentii sai, cit., pp. 275-6. La traduction est de Gianfranco De Turris.
- 6) Julius Evola, Il Cammino del cinabro, Scheiwiller, Milan, 1963, pp. 151 ; idem, Il fascismo, Volpe, Rome, 1964, p. 32.
- 7) Julius Evola, Il fascismo, Volpe, Rome, 1974, p. 35 note 1. Cf. également la réimpression de cette troisième édition chez Settimo Sigillo, Rome, 1989, p. 35, note 1.
- 8) Claudio Mutti, Mircea Eliade e la Guardia di Ferro, cit., pp. 39-45 et plus largement dans son Introduzione a La tragedia della Guardia di Ferro, Fondazione Julius Evola, Rome, en cours d’impression.
- 9) Mircea Eliade, Le promesse dell’equinozio, Jaca Book, Milan, 1995, p. 156.
- 10) Mircea Eliade e l’Italia, cit., pp. 25-70.
- 11) Toutes les citations dans Rivolta contro il mondo moderno, in : « Il rapporto Eliade-Evola », cit., pp. 17-18.
- 12) Cf. Michela Nacci, Tecnica e cultura della crisi, Lœscher, Turin, 1986.
- 13) Julius Evola, Il cammino del cinabro, cit., p.151.
- 14) Julius Evola, « Nella tormenta romena : voce d’oltretomba » dans Quadrivio, Rome, 11 déc. 1938.
- 15) Julius Evola, « Il mio incontro con Codreanu », dans Civiltà n°2, Rome, sept-oct. 1973.
- 16) Claudio Mutti, « Introduzione à Julius Evola », La tragedia della Guardia di Ferro, cit.
- 17) Vasile Posteuca, Desgroparea Capitanului, Madrid, 1977, pp. 35-6. Cit. dans Claudio Mutti, Mircea Eliade e la Guardia di ferro, cit., pp. 42-43.
- 18) Lettere de Julius Evola à Girolamo Comi (1934-1962), éditées par Gianfranco de Turris, Fondazione J. Evola, Rome, 1987.
- 19) Mircea Eliade e l’Italia, cit., p. 252.
- 20) Mircea Eliade e l’Italia, cit., p. 252.
- 21) Mircea Eliade, Lo Yoga, Immortalità e libertà, Rizzoli, Milan, 1973, p. 167, note 9.
- 22) Ce terme allemand se réfère au droit médiéval du talion et suppose que l’on a subi un tort. On peut le traduire par «réparation».
- 23) Mircea Eliade e l’Italia, cit., p. 252.
- 24) Ivi, pp. 253-4. La traduction a été corrigée en certains points.
- 25) Philippe Baillet, « Julius Evola et Mircea Eliade (1927-1974) : une amitié manquée », dans Les deux étendards n°1, sept-déc. 1988, p. 48. Traduction italienne Jaca Book, Milan, 1987.
- 26) loan P. Culianu, Mircea Eliade, Cittadella, Assise, 1978, p. 146.
- 27) Crescenzo More, Storia sacra e storia profana, in : Mircea Eliade, Bulzoni, Roma, 1986, p. 14.
- 28) Mircea Eliade e l’Italia, cit., p. 250.
- 29) Ivi, p. 251.
- 30) Cf. G. Monastra, « In ascolto del sacro », in : Diorama letterario n°109, Firenze, nov. 1987, pp. 2-3.
- 31) Mircea Eliade e l’Italia, cit., p. 252.
- 32) Furio Jesi, Cultura di destra, Garzanti, Milano, 1979, p. 5.
- 33) Crescenzo More, Storia sacre e storia profana, cit., p. 17.
- 34) Piero Di Voua, « Storia e Tradizione in Eliade », in : Diorama letterario n°109, cit., p.
- 35) Ivi, pp. 13-14.
- 36) G. Monastra, « Il rapporto Eliade-Evola, une pagina della cultura del Novecento », in : Diorama letterario n°120, cit., p. 17.

Mircea Eliade et René Guénon
Dans les années 40 de ce siècle, eut lieu en Roumanie un extraordinaire changement de tendance culturelle, dû à l’influence exercée d’un côté par un courant traditionnel très fort qui se manifesta après la Première Guerre mondiale (Vasile Pârvan, Nae Ionescu), et de l’autre par un courant européen de renouveau de l’étude comparée des religions (G. Dumézil, R. Pettazzoni), ainsi que par une reprise de cette Philosophia perennis dont le représentant le plus influent fut René Guénon. De la pléiade d’écrivains et de penseurs roumains qui participèrent à ce changement de tendance, nous nous limiterons ici à en analyser deux : Mircea Eliade et Vasile Lovinescu, influencés tous deux initialement par la pensée de René Guénon, mais qui, ensuite, empruntèrent des voies différentes.
Pendant sa jeunesse, Mircea Eliade fut un admirateur du fameux historien traditionnel roumain du XIXe siècle Bogdan P. Hasdeu (dont il édita aussi les œuvres), mais aussi de l’historien des religions Georges Dumézil ; en outre il subit l’influence d’un courant oriental hindou. C’est ainsi qu’en 1929 il partit avec une bourse d’études en Inde, d’où il rentra non pas initié — comme on aurait pu s’y attendre — mais enrichi d’un matériel documentaire qui donna lieu à la première version de son étude sur le Yoga (1). L’écrivain Ieronim Serbu (2) atteste avoir eu dans sa bibliothèque un exemplaire du livre de Guénon L’Homme et son devenir selon le Vedanta, signé par Eliade et daté « 19 juin 1929, Calcutta ». Il est évident que le jeune Eliade connaissait certaines œuvres de Guénon ; cependant il ne le cite même pas dans les notes de son volume sur le Yoga. Néanmoins, dans la Roumanie des années trente, Eliade connaissait bien Vasile Lovinescu et Marcel Avramescu, qui étaient en relation avec René Guénon depuis 1934. Eliade collabora également, sous un pseudonyme (3), à Memra, la revue publiée par Marcel Avramescu sous l’influence de René Guénon. Son intérêt pour le courant traditionnel se manifesta à l’occasion de la visite en Roumanie de Julius Evola, que Eliade rencontra et avec lequel il eut une brève discussion (4). Cette visite est aussi évoquée brièvement dans les lettres de Guénon à Lovinescu (5). D’autre part, dans un article publié dans la Revista Fundatiilor Regale et publié à nouveau dans le volume Insula lui Euthanasius, Eliade dit : « Grâce aux œuvres de R. Guénon, de AK Coomaraswamy, d’Evola et de certains autres auteurs, s’est affirmée l’idée que l’Orient, loin de se solidariser avec le pathétisme et l’anti-traditionalisme modernes, trouve son pendant en Europe seulement chez Aristote, chez Saint Thomas, chez Meister Eckhart ou chez Dante » (6). Malgré cela, Eliade ne cite pas René Guénon dans ses études sur le symbolisme, bien qu’il s’agisse de thèmes analogues et qu’il en donne des interprétations similaires. L’attitude d’Eliade envers Guénon reste donc, dans sa période roumaine, ambiguë et contradictoire. Après son arrivée en Occident, Eliade ignorera presque complètement Guénon.
Alors qu’il semble qu’Eliade n’ait rien écrit à propos des livres de René Guénon, ce dernier, sensibilisé par ce que lui en disaient Vasile Lovinescu et surtout Michel Vâlsan, qui se trouvait à Paris, publia une recension du livre d’Eliade Techniques du Yoga (Gallimard), reprise ensuite dans le volume et où, tout en reconnaissant les mérites de fauteur, il se demandait : « Quelle nécessité y avait-il de s’arrêter ainsi à mi-chemin, à cause d’une sorte de peur de trop s’éloigner de la terminologie généralement admise ?… Malgré tout, il y a des points qui demanderaient certaines réserves, comme par ex. une conception, manifestement insuffisante du point de vue traditionnel, de l’orthodoxie hindoue et de la manière selon laquelle elle a pu incorporer des doctrines et des pratiques qui au départ lui seraient restées étrangères ; tout cela reste trop extérieur et donnerait davantage l’idée d’un syncrétisme plutôt que d’une synthèse, ce qui est certainement assez éloigné de la vérité ; et il en sera toujours ainsi, inévitablement, tant qu’on n’osera pas affirmer, de manière claire et inéquivoque, tout ce que la Tradition comporte d’essentiellement `non humain’ » (7). Le diagnostic de Guénon nous semble correct, particulièrement en ce qui concerne le refus de la part d’Eliade à reconnaître l’origine non humaine de toute Tradition authentique.
En Occident, donc, Eliade ne fait aucune mention de Guénon, jusqu’à la sortie du premier volume des Fragments d’un journal, où l’on trouve un bref jugement négatif, que nous citons en partie : « Ce que disent Guénon et les autres ’hermétistes’ de la `tradition’ ne doit pas être compris sur le plan de la réalité historique (comme ils le prétendent). Ces spéculations constituent un univers de significations articulées entre elles ; elles doivent être comparées à un long poème ou à un roman. Il en va de même pour les `explications’ marxistes ou freudiennes : celles-ci sont vraies si on les considère comme des univers imaginaires. Les `preuves’ sont peu nombreuses et incertaines et correspondent aux `réalités’ historiques, sociales, psychologiques d’un roman ou d’un poème. Toutes ces interprétations globales ci systématiques constituent, en réalité, des créations mythologiques assez utiles pour la compréhension du monde ; mais ce ne sont pas, comme pensent d’autres auteurs. des `explications scientifiques’ » (8). Dans ces quelques lignes, Eliade refuse donc toute réalité objective aux données traditionnelles, en les considérant comme des créations fictives au même titre que n’importe quelle œuvre littéraire et en les invitant sur le même plan que les explications marxistes et freudiennes, ce qui nous semble tout à fait aberrant et malveillant.
Eliade exprime une idée analogue également à propos de certains écrits de Vasile Lovinescu, dans une lettre qu’il lui adresse : « J’avais entendu parler de l’œuvre sur Creanga (manuscrite à cette époque-là, n.d.a.) et ce que vous me dites est passionnant. J’ai lu l’article paru dans România Literara. J’ai du mal à accepter l’interprétation symbolique de Craii de Curtea Veche que vous proposez, mais la lecture de votre texte est fascinante » (9). L’appréciation des interprétations symboliques traditionnelles est toujours la même : « fascinantes » comme des textes littéraires, mais sans « valeur scientifique ».
Un autre jugement d’Eliade sur Guénon paraît dans le second volume des Fragments d’un journal, où, en parlant d’une lettre d’Evola, il écrit : « Un jour, je reçus de lui une lettre quelque peu amère, dans laquelle il me reprochait de ne jamais citer ni lui ni Guénon. Je lui répondis du mieux que je pus, mais un jour je devrai tout de même donner les motifs et les explications que cette question exige. Mon argumentation est des plus simples : les livres que j’écris sont destinés au public d’aujourd’hui et pas aux initiés. Contrairement à Guénon et à ses émules, je pense que je n’ai rien à écrire qui leur soit destiné personnellement » (10). Il est évident qu’Eliade n’a pas écrit pour des initiés qui n’avaient pas (n’ont pas) besoin de ses textes ; mais les initiés ont écrit assez de choses qui ont été traitées également dans les œuvres de l’historien des religions, sans que ceux-ci l’aient mentionné — et ceci est une chose complètement différente.
En ce qui concerne les raisons qui ont conduit Eliade à éviter de citer les penseurs traditionnels, exception faite pour Coomaraswamy, on trouve des appréciations très édifiantes dans une lettre de Michel Vâlsan à Vasile Lovinescu, dont nous reportons ce passage :
« Il (M. Eliade, N.d.a.) se sert pas mal de Guénon, sans jamais le citer. En 1948, je l’ai rencontré et nous avons bavardé chez moi de ses convictions et de ses recherches. Il m’a affirmé qu’il était d’accord avec Guénon en tout point, mais que sa position et ses projets universitaires l’empêchaient de le reconnaître ouvertement. J’ai communiqué cela à Guénon qui, dans les comptes-rendus sur ses premiers livres, tint compte de ce que je lui avais dit. Eliade me disait qu’il pensait se servir de la politique du `cheval de Troie’ : une fois bien installé dans le monde scientifique et après avoir recueilli les preuves `scientifiques’ des doctrines traditionnelles, il aurait finalement exposé à la lumière du jour la vérité traditionnelle. Je crois qu’il se vantait : il est ou craintif ou trop prudent. Il a malheureusement rencontré des catholiques hostiles à Guénon et depuis lors il est beaucoup moins enthousiaste, à supposer qu’il le fût jamais. Il y a deux ans, je l’ai rencontré dans la rue et lui ai dit que ses projets allaient plus lentement, alors il m’annonça qu’il allait publier quelque chose ; en tout cas, il n’a jamais cité le nom de Guénon, ni en bien ni en mal, mais certaines de ces accusations envers les traditionalistes m’ont fait une pénible impression » (11).
Il semble qu’Eliade fasse de plus amples concessions envers Guénon dans son volume de conversations avec Claude Henri Rocquet, L’Épreuve du Labyrinthe, où il dit ceci :
« J’ai lu René Guénon assez tard et certains de ses livres m’ont beaucoup intéressé, particulièrement L’Homme et son Devenir selon le Vedanta, que j’ai trouvé très beau, intelligent et profond. Mais il y avait tout un aspect de Guénon qui m’irritait : ce côté polémique à outrance ; et son refus brutal de toute la culture occidentale moderne : comme s’il suffisait d’enseigner à la Sorbonne pour perdre toute possibilité de comprendre quelque chose. Je n’aimais pas non plus ce sombre mépris pour certaines œuvres d’art et de littérature modernes. Tout comme ce complexe de supériorité qui le poussait à croire, par ex., que l’on peut comprendre Dante seulement dans la perspective de la “Tradition”, plus exactement dans celle de René Guénon. (…) En d’autres mots, de nos jours, le terme `Tradition’ désigne assez souvent l’ésotérisme, l’enseignement secret. Par conséquent, qui se déclare adepte de la “Tradition” laisse supposer qu’il est “initié”, qu’il est détenteur d’un `enseignement secret’. Ce qui, dans le meilleur des cas, est une illusion » (12).
Comment un non initié peut-il savoir que l’initiation réelle de Guénon est une illusion ?
Finalement, revenant à de meilleurs sentiments dans le volume Occultisme, sorcellerie et modes culturelles, Eliade reconnaît en partie l’importance de l’œuvre de Guénon, mais en particulier à cause de la critique qu’il formule à l’égard du néo-spiritualisme moderne :
« Le représentant le plus important et significatif cependant de l’ésotérisme contemporain — René Guénon — s’oppose énergiquement aux pratiques ainsi dites occultes… La critique la plus savante et la plus acerbe dont tous ces groupes ainsi dits occultistes ont été l’objet, ne provenait pas d’un observateur rationaliste, “en dehors” d’eux, mais d’un auteur qui appartenait à leur propre cercle, initié comme il se doit à un ordre secret et bien informé de leurs doctrines ; une critique donc qui n’était pas seulement d’orientation sceptique ou positiviste, mais qui rappelait même ce qui pour son auteur était l’ésotérisme traditionnel… De son vivant René Guénon fut un auteur plutôt impopulaire. Il avait des admirateurs fanatiques, mais leur nombre était plutôt restreint. C’est seulement après sa mort, et spécialement ces dix ou douze dernières années, que ses livres ont été réimprimés et traduits et que ses idées ont eu une plus ample diffusion. Le phénomène est plutôt curieux, du fait que, comme je l’ai déjà dit, Guénon a une vision du monde pessimiste : il en annonce en effet la fin imminente et catastrophique » (13).
Dans ses jugements qui ont probablement été les derniers à être publiés, Eliade reconnaît les grandes qualités et l’importance de Guénon, même s’il ne revient pas sur les réserves qu’il a exprimées précédemment.
D’après ce que nous savons, ce devraient être les idées les plus importantes exprimées par Eliade, par écrit ou dans des conversations rendues publiques, sur son rapport avec Guénon. En résumé, on peut dire que cette relation est passée par trois phases : une première phase coïncide avec ses années de jeunesse passées en Roumanie, quand, après avoir lu quelques livres de Guénon, Eliade s’y intéressa et manifesta par écrit ou verbalement sa propre admiration, limitée toutefois, envers Guénon et sa pensée. Une seconde phase commence après l’émigration de l’écrivain des religions en Occident, quand il s’impose un silence quasi total, qui durera plus de vingt ans, sur Guénon et sur ses textes. Finalement, nous avons une troisième phase, celle de la reconnaissance de l’importance du métaphysicien français, avec toutefois certaines réserves sur sa doctrine.
Sans vouloir insister davantage, puisque chaque lecteur peut tirer les conclusions des textes ci-inclus, nous pensons que le rapport inégal et souvent contradictoire entre Eliade et Guénon est dû en premier lieu à l’évolution de la pensée de l’écrivain roumain, qui passe de l’homme de foi et à la recherche d’une réalisation initiatique à l’historien des religions agnostique préoccupé par des recherches scientifiques et de reconnaissance internationale.
Alors qu’il était au départ proche des idées de Guénon, Eliade s’en est éloigné tout comme il s’est éloigné du métaphysicien traditionnel, jusqu’à s’y opposer sous bien des angles. Ensuite, l’arrivée d’Eliade en Occident dans des milieux universitaires et scientistes qui ne comprenaient pas Guénon et ne l’appréciaient pas, au point de lui être hostiles, fa amené à s’intégrer dans ces milieux et à s’adapter à leur position pleine de réserves. Plus âgé, après avoir reçu la reconnaissance des milieux scientifiques du monde entier, Eliade a en partie modifié ses propres jugements sur Guénon en appréciant sa valeur même si toujours partiellement, et sur un autre plan que scientifique. Une adhésion complète à l’œuvre de Guénon et aux doctrines traditionnelles se manifeste par contre chez deux autres Roumains, Vasile Lovinescu et Mihai Vâlsan, qui, tout en restant éloignés de la pensée positiviste occidentale, se sont intégrés dans une mentalité et dans une pratique de vie spirituelle au caractère ésotérique et initiatique, très éloignées des possibilités de compréhension de l’histoire des religions.
Même si à des niveaux différents, Guénon et Eliade restent deux figures importantes de la pensée contemporaine en lutte contre l’indifférence de notre époque envers l’esprit. En ce sens, leur œuvre est un témoignage de la crise d’identité de l’époque moderne : celle de Guénon parce qu’elle ouvre un voie de réalisation intérieure, et celle d’Eliade parce qu’elle indique des voies de recherche.
► Florin Mihaescu, Antaios n°16, 2001.
(Texte publié dans Origini XIII, Milan 1997 et traduit de l’italien par Blanche Bauchau)
Notes :
- (1) M. Eliade, Yoga : Essai sur les origines de la mystique indienne, Paris 1936.
- (2) I. Serbu, Vitrina cu amintri, Bucuresti 1973.
- (3) C. Ungureanu, JX Uranus, Revista de Istorie si Teorie literara, 1-2, Bucuresti 1989.
- (4) C. Mutti, Mircea Eliade e la Guardia di Ferro, Parma, 1989, pp. 42-43.
- (5) R. Guénon, Lettera a V. Lovinescu, Le Caire 30 mars 1938 (manuscrite et inédite).
- (6) M. Eliade, Ananda Coomaraswamy, dans lnsula lui Euthanasius, Bucuresti, 1943.
- (7) R. Guénon, Études sur l’Hindouisme, 2e éd., Paris, 1976, pp. 210-211.
- (8) M. Eliade, Fragments d’un journal, Paris, 1973, éd. it., Milan 1976, p. 402.
- (9) M. Eliade, Lettera a V. Lovinescu, Chicago 9 nov. 1970 (manuscrite).
- (10) M. Eliade, Fragments d’un journal IL 1970-1978, Paris, 1981, p. 194.
- (11) M. Vâlsan, Lettera a V. Lovinescu, Paris, 12 mai 1957 (manuscrite et inédite).
- (12) M. Eliade, L’épreuve du Labyrinthe, Paris, 1970, p. 170.
- (13) M. Eliade, Occultisme, sorcellerie et modes culturelles, Paris, 1978, éd. it. Florence, 1982, p. 53, 56, 74.

LE MYTHE COMME ENJEU : LA REVUE “ANTAIOS” DE JÜNGER ET ELIADE
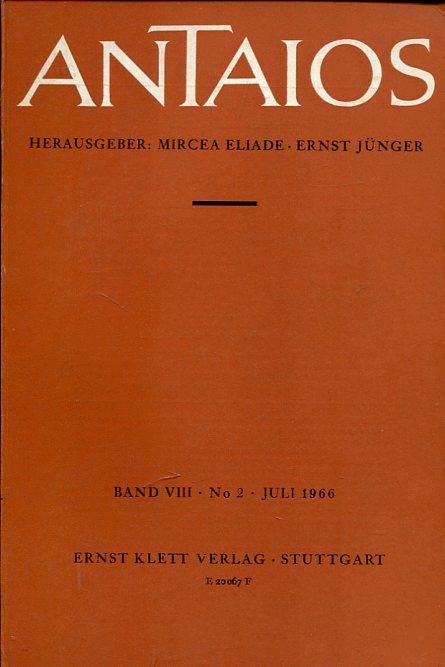 La publication Antaios [1959-1971] scelle la fructueuse rencontre de deux hommes : l’un, Ernst Jünger, auteur allemand à la réputation que l’on voudrait outre-Rhin sulfureuse, l’autre, Mircea Eliade, roumain de l’exil, comparatiste et brillant historien des religions. En commun, les deux hommes se sont interrogés sur la nature du Sacré. sur la place que l’homme occupe dans l’histoire. Il ne nous revient pas ici, dans le cadre exigeant mais forcément restrictif d’un article. de retracer ce que furent les siècles qui précédèrent un tel questionnement. Cependant, nous ne saurions oublier que l’histoire, telle que nous la percevons aujourd'hui, est mouvementée, viciée, source d’éternelles inquiétudes, et qu’elle ne cesse de nous rappeler nos limites, la présomption de nos œuvres. L’homme, au sortir des embrasements européens, pris dans les rets de l’histoire au sein d’un monde nihiliste, respire la mort, celle des autres tout en étant obsédé par la sienne propre, car ce que nous appelons l’histoire est somme toute l’histoire de la mort. Or, Antaios, moyen d’expression dirigé vers un public, marque la volonté de se libérer des contraintes visibles de l’histoire et de retrouver la puissance d’un monde riche de sève originelle.
La publication Antaios [1959-1971] scelle la fructueuse rencontre de deux hommes : l’un, Ernst Jünger, auteur allemand à la réputation que l’on voudrait outre-Rhin sulfureuse, l’autre, Mircea Eliade, roumain de l’exil, comparatiste et brillant historien des religions. En commun, les deux hommes se sont interrogés sur la nature du Sacré. sur la place que l’homme occupe dans l’histoire. Il ne nous revient pas ici, dans le cadre exigeant mais forcément restrictif d’un article. de retracer ce que furent les siècles qui précédèrent un tel questionnement. Cependant, nous ne saurions oublier que l’histoire, telle que nous la percevons aujourd'hui, est mouvementée, viciée, source d’éternelles inquiétudes, et qu’elle ne cesse de nous rappeler nos limites, la présomption de nos œuvres. L’homme, au sortir des embrasements européens, pris dans les rets de l’histoire au sein d’un monde nihiliste, respire la mort, celle des autres tout en étant obsédé par la sienne propre, car ce que nous appelons l’histoire est somme toute l’histoire de la mort. Or, Antaios, moyen d’expression dirigé vers un public, marque la volonté de se libérer des contraintes visibles de l’histoire et de retrouver la puissance d’un monde riche de sève originelle.L’enjeu était grand. Comme par un acte de défi métaphysique, Jünger et Eliade portèrent l’exigence d’un combat spirituel contre l’angoisse du monde moderne, amnésique et déraciné. Dans un souci pédagogique, les responsables d’Antaios procédèrent à des rappels de l’histoire spirituelle de notre planète et puisèrent leur énergie dans un passé lumineux, dans le patrimoine mythologique que partagent toutes les religions. Le recours au mythe apparaît, dans la bataille idéologique que mène Jünger, comme la clef de voûte de tout un système de pensée, le seul capable d’expliquer le rapport que l’homme entretient au Temps, à l’éternité et à la liberté. Par la connaissance des mythes donc, mais aussi par celle des beaux-arts, par la maîtrise de l’esprit sur le monde, les hommes d’Antaios devaient penser qu’il était possible de rééquilibrer la conscience humaine, de créer un nouvel humanisme, une anthropologie où microcosme et macrocosme correspondraient à nouveau. Ils témoignèrent aussi de cette certitude qu’un redressement spirituel était encore envisageable dans les années 60, et qu’il pouvait mettre fin à la décadence ou aux affres d’un temps d’Interrègne.
La revue, éditée par la maison Klett, fut imprimée pendant dix ans, de 1960 (mai 1959/mars 1960) à mars 1971. Si, au début de la création, le tirage des cahiers, chacun contenant environ une centaine de pages, s’élevait à 2.000 et jusqu’à 3.000 exemplaires bimestriellement, celui-ci tomba à 1.200 exemplaires en fin de parcours. La revue n’était donc plus rentable. Selon Klett (1), le périodique était lu principalement par des scientifiques, des lecteurs appartenant à une couche dirigeante intellectuelle constituée par tous les groupes socio-professionnels de la population.
Ernst Jünger livra 17 articles dont le contenu diffère fort de ceux qu’il avait publiés à la fin des années 20, lorsqu’il se voulait le chantre de l’héroïsme et l’annonciateur de l’ère des Titans ! Dans cette revue, Jünger fit paraître en primeur des passages de livres non encore édités (2). Eliade publia 14 articles, traductions en allemand de chapitres d’ouvrages déjà parus. Dans la grande liste des noms ayant collaboré à Antaios, nous retiendrons d’une part les signatures involontaires, témoins des orientations de Jünger ou d’Eliade : ainsi Quincey, Hamann, Eckartshausen, Schlegel, Keyserling ; d’autre part, nous avons les contemporains aux noms souvent bien connus : Michaux (1960), Corbin (1961/62/64), Kerényi (1966), Evola (1960/62/68/70), Borgès (1962), Caillois (1959/62/63/68), Jouhandeau (1960/65), Schuon (1965/66), de Vries (1960/62), Cioran, frère d’exil d’Eliade (1962/63/65/66) et l'inévitable cadet Friedrich Georg Jünger (1960/62/65). Dans cette liste de noms assurément exhaustive mais nullement innocente, nous observons le silence insolite d’un métaphysicien marquant : René Guénon. Certes, ce dernier mourut au Caire en 1951, mais l’apport guénonien n’avait-il pas sa place dans Antaios sous forme de traduction d’un chapitre, ou d’articles le présentant au public germanophone ? De plus, Schuon et Evola, dont les travaux parurent dans la revue, se reconnaissent comme disciples ou proches, intéressés par les thèses guénoniennes.
L’absence dit parfois plus que les discours mais il est délicat de tirer des conclusions quand seules des suppositions peuvent élucider les raisons d’un tel silence. Il est évident que Jünger, fort bien instruit de la culture française et des courants ésotérisants, connaissait à cette époque les travaux de Guénon ; d’ailleurs ne cite-t-il pas furtivement l’ouvrage de Guénon, paru en 1930, Orient et Occident, dans Approches, Drogues et Ivresses (3) ? Guénon, qui avait très tôt constaté la rupture de l’Occident avec sa tradition, dénonça l’invasion dévorante et néfaste du système subversif d’anti-valeurs occidental à l’échelle de la planète. En 1930, Guénon déplorait que le savoir traditionnel des peuples conquis était condamné non pas, certes, à disparaître mais bien à se cacher, forcé ainsi dans d’ultimes retranchements par une colonisation aussi idéologique, forte d’une avancée économique et d’un pseudo-progrès matériel. Sur la question de l’actuel désordre, nous pouvons trouver chez Jünger plus d’une position et d’un argument concordant avec le discours guénonien. La méfiance de Jünger à traiter directement de la politique contemporaine depuis l’arrivée au pouvoir des forces du nazisme, le rapprochent de Guénon :
« Nous n’avons pas l’habitude, dans nos travaux, de nous référer à l’actualité immédiate, car ce que nous avons constamment en vue, ce sont des principes, qui sont, pourrait-on dire, d’une actualité permanente, parce qu’ils sont en dehors du temps… Ce qui nous a frappé surtout dans les discussions dont il s’agit, c’est que, ni d’un côté ni de l’autre, on n’a paru se préoccuper tout d’abord de situer les questions sur leur véritable terrain, de distinguer d’une façon précise entre l’essentiel et l’accidentel, entre les principes nécessaires et les circonstances contingentes ; et, à vrai dire, cela n’a pas été pour nous surprendre, car nous n’y avons vu qu’un nouvel exemple, après bien d’autres, de la confusion qui règne aujourd’hui dans tous les domaines, et que nous regardons comme éminemment caractéristique du monde moderne » (4).
Jünger fut-il gêné par la conversion à l’Islam de Guénon, dont l’initiation au soufisme intervint dès 1912 ? L’ère du Travailleur que Jünger avait annoncée en 1932, l’esprit des Temps d’Interrègne si méticuleusement mis à nu dans les romans "utopiques" n’auraient-ils que faire du message d’une religion révélée, devenu inadéquat et obsolète ? Dans l’attente de nouveaux dieux, Jünger y vit-il le tribut à payer d’hommes épris d’absolu à ce que Spengler nomma une "seconde religiosité'' ? Pourtant, Jünger ne pouvait ignorer la force et l’originalité avec laquelle Guénon dénonça la contre-initiation et son fatras idéologique… Où Jünger serait-il ici plus proche des objections d’Eliade ? Ce dernier avait découvert relativement tard les livres de Guénon et, s’il les avait lus avec intérêt, il n’en était pas moins irrité par « l’aspect outrancièrement polémique de Guénon », « son rejet brutal de toute la civilisation occidentale », « ce mépris opaque envers certaines œuvres de l’art et de la littérature moderne », « ce complexe de supériorité qui le poussait à croire… qu’on ne peut comprendre Dante que dans la perspective de la ''tradition'', plus exactement celle de René Guénon » (5).
Antaios marque une entreprise d’hommes, décidés à agir dans l’histoire, dans un monde où la spiritualité en est de plus en plus exclue et se trouve en réaction contre le culte de la pensée abstraite, telle qu’elle fut honorée au siècle dernier. Les armes dont ils se servirent furent la force du mot et leur connaissance du monde traditionnel, historique, littéraire. Les buts que s’assignèrent Mircea Eliade et Ernst Jünger en éditant la revue Antaios, Zeitschrift für eine neue Welt (Antaios, périodique pour un monde nouveau) sont exposés dans un programme écrit par Jünger, composé de sept petits paragraphes. Les thèmes abordés dans la revue tournent principalement autour d’un thème spécifiquement humain, le rapport de l’homme au sacré en Europe païenne ou chrétienne ou dans d’autres civilisations, sur d’autres continents. L’un des points essentiels de ces directives, c’est qu’Antaios doit nourrir l’ambition de connaître, de comprendre les racines de sa culture et de son passé, d’être à la recherche de significations des diverses expressions religieuses ou artistiques.
Le titre de la revue ouvre le combat : Antaios (7), le géant issu de l’union de Poséidon et de Gaïa, entretenait une relation exceptionnelle à sa mère, la Terre. C’est de Gaïa qu’il tirait sa vie et sa force sans cesse renouvelée, toujours identique. Le respect antique pour la Terre-Mère évoque Nietzsche pour qui l’homme doit obéir à ce que veut la Terre. Certes, et Jünger insiste sur ce point, l’homme moderne appréhende la terre d’une manière différente que ne le fit l’homme traditionnel, qu’il s’agisse du point de vue économique, technique ou politique ; de plus, le mythe comme il exista à une époque donnée ne saurait être restauré.
L’affaiblissement du monde mythique est irrévocable depuis que Hérodote, quittant la nuit mythique pour se diriger vers la luminosité du savoir historique de Thucydide, conféra un nouveau caractère à l’esprit (8). Cependant, pour Jünger, l’homme après avoir déblayé les ruines de l’ancien ordre, se dirige vers un monde métahistorique, vers de nouveaux mythes ; l’homme, fils de la Terre, pourra supporter la croissance monstrueuse en pouvoir et espace lorsqu’il lui aura trouvé un pendant, puisé dans les profondeurs archaïques et sacrées. En ceci, la désignation de la revue est donc révélatrice d’un système de pensée.
Une place forte est nécessaire pour appréhender le temps, idée que nous trouvons formulée par Jünger dès 1938 dans Les Falaises de marbre : des hauteurs d’un ermitage aux buissons blancs où se sont retirés deux « anciens polytechniciens subalternes du pouvoir », les deux frères, devenus savants herboristes, voient leur sens, leur perception des choses s’affiner (9). « La position doit en même temps être élevée : cela signifie qu’elle doit présenter au regard non seulement le passé définitivement révolu, mais aussi les événements du présent avec ses figures et ses problèmes et, au~delà, les possibilités de l’avenir » (10).
Du mythe, noyau inamovible, phénomène intemporel, l’homme gagne donc un aperçu sur le passé, le présent et l’avenir. Les trois dimensions du temps sont perçues comme semblables à l’instant où les forces et puissances temporelles reculent. C’est à partir de cette identité des différents aspects de ce triptyque que Jünger se concentre sur ce qu’il y a de plus typique : « Le mythe, au-delà de la signification plus étroite du mot, est compris comme puissance qui fonde l’histoire et, revenant sans cesse, brise le flux des événements » (11).
La volonté de Jünger et d’Eliade, telle qu’elle apparaît dans la perspective commune, est de servir la cause de la liberté dans le monde. « Un monde libre ne peut être qu’un monde spirituel » (12) et, pour expliquer la démarche d’Antaios, Jünger précise que « La liberté croît avec la vue d’ensemble spirituelle, avec l’acquisition de lieux, solides et élevés, où l’on peut se tenir » (13). Et ces postes fortifiés et élevés dont Jünger nous parle et qui ne sont pas sans éveiller le souvenir des lointains et dangereux "postes perdus", nous les trouvons sur de nombreux chemins : ceux de la théologie, de la philosophie, de l'art.
Idéologies et disciplines, des "béquilles" sont certes là pour aider l’homme ; mais on les abandonne, une fois la guérison achevée, tout comme on relègue les béquilles dans les lieux saints et sanctuaires, une fois le miracle accompli. Ainsi, les deux hommes dans ce programme, se proposèrent-ils ni plus ni moins d’œuvrer à un renouveau psychique, à une "guérison" du lecteur, à lui permettre de supporter les pressions de l’histoire contemporaine, à lui faire oublier ce qu’Eliade a nommé "la terreur de l’histoire" : « La terreur de l’histoire, c'est pour moi l’expérience d’un homme qui n'est plus religieux, qui n’a donc aucun espoir de trouver une signification ultime au drame historique, et qui doit subir les crimes de l’histoire sans en comprendre le sens… Mais les événements historiques sont vidés de toute signification transhistorique et, s’ils ne sont plus ce qu’ils étaient pour le monde traditionnel — des épreuves pour un peuple ou pour un individu —, nous avons affaire à ce que j’ai appelé la "terreur de l’histoire" » (14). C’est dans une perspective assez proche que Jünger formule dans son Traité du Rebelle : « C’est aussi la question qui de nos jours se dissimule derrière toute peur du temps. L’homme se demande comment il pourra échapper à la destruction » (15).
Jünger rend compte d’une terreur propre au monde moderne : l’homme peut en utilisant notamment les moyens techniques qu’il a lui-même créés, détruire les principes de la vie. La technique, symbole de l’orgueil humain et de l’œuvre des Titans, se mesure à des mystères qui, de loin, devraient la dépasser ; une raison pour laquelle Jünger, sans doute, demeure d’un scepticisme méfiant quand il songe aux recherches génétiques. La mort ne cesse-t-elle d’endeuiller nos plus belles victoires techniques ? Jadis, la fin du monde était conçue comme la conséquence directe d’un châtiment divin, ainsi le déluge ou la destruction de Sodome. Aujourd’hui, et c’est en cela que réside la nouveauté, cette peur est dépourvue de tout aspect transcendant et métaphysique car la fin du monde peut être le fruit de l’hybris humaine.
Pour Jünger tout comme pour Eliade, la crise que connaît l’homme moderne est en grande partie de nature religieuse car elle marque la prise de conscience d’une totale absence de sens. Jünger comprend l’histoire de l’homme comme le lieu d’affrontement dialectique de la liberté. Cet affrontement, il le projette à l’intérieur de chaque être : en chacun de nous se disputent âprement la liberté et la tyrannie, les mythiques représentations de l’Est et de l’Ouest jüngerien. Cette liberté, l’homme la trouve en lui-même quand s’harmonisent les exigences déterminantes du mythe et du présent historique, bref, entre rêve et conscience, car le monde onirique relève du monde des archétypes. Pour Jünger, l’homme gagne la liberté en acquiesçant à la nécessité de l’ordre cosmique, en acceptant le "Meurs et le deviens !", en ayant conscience d’une unité supratemporelle.
Les dix années d’Antaios ont ainsi tenté de rétablir un ordre entre profane et sacré comme s’il était certain que « Le mythe est le socle anthropologique sur lequel s’élève la signification historique » (16).
► Isabelle Rozet, Antaïos n°2, 1993.
Notes :
(1) Se reporter à l’article mordant de Hornung, paru dans Die Horen, Jg. 16, 197, « Ernst Jünger freie Welt - Antaios », pp. 108-109.
(2) Ainsi :- — Antaios 1, 1960, p. 113 sq. : "Sgraffiti" / Ibid., p. 209 sq. : "An der Zeitmauer" / Ibid., pp. 525-526 : "Vierblätter"
- — Id. 2, 1961, pp. 93-122 : "Ein Vormittag in Antibes"
- — Id. 3, 1962, pp. 1-17 : "Sardische Heimat"
- — Id. 4, 1963, pp. 209-260 : "Das spanische Mondhorn" / Ibid., pp. 309-312 : "November"
- — Id. 5, 1964, pp. 1-27 : "Yon der Gestalt" / Ibid., pp.493-518 : "Maxima / Minima"
- — Id. 7, 1966, pp. 1-11 : "Grenzgange" / Ibid., pp. 310-318 : "Alfred Kubin"
- — Id. 9, 1968, pp. 21-35, "Tage auf Fonnosa"
- — Id. 10, 1969, pp. 1-17 : "Drogen und Rausch" / ibid., pp. 313-336 : "Ceylan"
- — Id. 11, 1970 : "lm Granit"
- — Id. 12, 1971, pp. 1-29 : "Lettern und Ideogramme" / lbid., pp. 193-215 : "Annaherungen".
(3) Annäherungen, Drogen und Rausch, Klett, Stuttgart, 1970, 1980, Ullstein Taschenbuch, p.50.
(4) R. Guénon, Autorité spirituelle et pouvoir temporel, 1929, p. 3.
(5) M. Eliade, L’Épreuve du Labyrinthe : Entretiens avec Claude-Henri Roquet, 1978, 1985, p. 170.
(6) Cf. in Sämtliche Werke : Essays VIII : "Ad hoc", p.167-168.
(7) Friedrich Georg Jünger nous rappelle dans le premier numéro de la revue quelles étaient les vertus et les caractéristiques du géant : in Antaios n°1, 1960, pp. 81-86.
(8) Voir à ce propos l’essai An der Zeitmauer (Le Mur du Temps), première parution dans Antaios n°1, pp. 209-226, Stuttgart, 1959.
(9) Auf den Marmorklippen (Sur les Falaises de marbre), Hamburg, 1939, p. 26.
(10) "Antaios" in Sämtliche Werke, p.167.
(11) Ibid.
(12) Ibid.
(13) Ibid.
(14) M. Eliade, L’Épreuve du Labyrinthe…, 1978, 1985, p. 146-147.
(15) Der Waldgang, Werke, Essays I, "Betrachtungen zur Zeit", p. 320 (traduit en Traité du Rebelle).
(16) G. Durand, Science de l’homme et tradition : Le nouvel esprit anthropologique, L'île verte, Berg international, 1979, p. 86.
 Faut-il brûler Mircea Eliade ?
Faut-il brûler Mircea Eliade ?Deux ouvrages récents comportent de longs développements sur la riche personnalité du mythologue roumain Mircea Eliade. Il s’agit tout d’abord des Plumes de l’Archange, de Claudio Mutti. Traditionaliste italien converti, comme Guénon, à l’Islam, Mutti est un fin connaisseur de l’histoire et de la culture roumaines. Il a consacré son essai, luxueusement édité pat les éditions Hérode, aux rapports qu’entretinrent avec la Légion de l’Archange Michel quatre membres de l’intelligentsia roumaine d’avant-guerre : Nae lonescu, Mircea Eliade, Emil Cioran et Constantin Noica.
Cette Légion, fondée en 1927 par, entre autres, Corneliu Zelea Codreanu (1899-1938), fut un mouvement mystique, une sorte d’Ordre religieux et militaire davantage qu’un simple parti. Les légionnaires se considéraient d’ailleurs comme membres d’une “milice de Dieu”, d’une école et d’une armée plutôt que d’un mouvement strictement politique. Enracinée dans la plus ancienne histoire roumaine, la Légion — souvent appelée Garde de Fer d’après le nom d’un de ses composants plus tardifs (1930) —, ne peut se réduire comme le font tant de publicistes et de polémistes à une imitation du fascisme ou du nazisme. Codreanu et les siens rejetaient en effet autant la capitalisme que le communisme, autant le primat de l’économie que celui de la race ou de l’État. Leur but était la rédemption du peuple roumain. Pour ce faire, 800.000 légionnaires s’imposaient 3 jours par semaine jeûnes et privations. La mystique légionnaire fait référence au Christianisme, mais il s’agit du Christianisme cosmique propre à la Roumanie, dans lequel on retrouve quantité de thèmes pré-chrétiens : construction spirituelle, sacrifice, éthique du service, culte des héros, présence aux côtés des vivants de toute la lignée des ancêtres, prière considérée non sous l’angle d’une demande (do ut des) mais d’une pratique magique à même d’agir sur le monde… On y décèle sans peine des éléments mithriaques ainsi que d’autres qui rappellent la chevalerie médiévale. Eliade, qui eut de fortes sympathies pour la Légion, la décrivait ainsi en mars 1934 : « Il faut dire que le roumanisme ne signifie ni fascisme ni chauvinisme mais désigne simplement l’exigence d’un État organique, unitaire, ethnique et juste ».
Mutti prétend qu’Eliade aurait même été élu député sur les listes du parti créé par la Légion, aux élections de décembre 1937, qui en firent le troisième parti du pays. Le roi Carol II, soutenu par les milieux d’affaires et une partie de l’armée, annula les élections, instaura une dictature ultraconservatrice et fit procéder à d’immenses rafles d’une brutalité inouïe. Codreanu fut jugé au cours d’une parodie de procès dont ce pays a le secret et emprisonné, avant d’être étranglé à la sauvette.
Voilà en quelques mots retracé le contexte troublé de l’époque, d’une rare violence, et qui fut tout sauf simple. Le problème est que certains entendent discréditer Eliade et le fruit d’une vie de travail acharné en utilisant, à tort et à travers, certains éléments de sa biographie. Il est vrai qu’Eliade, comme des milliers d’autres, crut que Codreanu pouvait rendre à son pays une dignité, une liberté qu’il n’avait plus sous la coupe de la clique corrompue de Carol II, le plus grand capitaliste de Roumanie. Toutefois, il faut rappeler que la Garde de Fer, certes antisémite (comme à peu près toute la classe politique de toute l’Europe centrale), fut l’objet d’une répression terrible, y compris sous l’occupation allemande. Ses chefs furent internés dans les camps de concentration, libérés par les Alliés et blanchis par le tribunal de Nuremberg : la Légion bénéficia d’un non-lieu qui la lavait de l’accusation de nazisme.
Si Mutti est manifestement rempli de sympathie pour la Légion qu’il idéalise sans aucun doute, et voudrait bien faire d’Eliade un partisan inconditionnel du mouvement alors qu’il ne fut qu’un compagnon de route fidèle dans la tourmente — ce qui est tout à son honneur —, d’autres, pour des motifs différents, tentent de salir la mémoire de l’historien des religions.
C’est le cas de Daniel Dubuisson, indianiste et disciple de Dumézil, auteur d’une thèse remarquée sur La légende royale dans l’Inde ancienne (Economica, 1986) et qui signe un essai d’épistémologie comparée intitulé Mythologies du XXe siècle. Les deux premières parties sont intéressantes et nous avons particulièrement apprécié celle consacrée à Dumézil, le découvreur de la trifonctionnalité indo-européenne. La seconde traite de Lévi-Strauss : l’auteur y joue, nous semble-t-il, au jeu un peu facile d’épingler des contradictions dans l’œuvre gigantesque de toute une vie. Facile mais après tout nécessaire et intellectuellement très sain. Mais dans la troisième partie, il abandonne le ton serein du savant pour se livrer à un véritable assassinat en règle sur la personne de feu Mircea Eliade. Il commence par reconnaître que ce dernier « mérite de figurer aux côtés de Frazer, de Dumézil, de Lévi-Strauss parmi les 5 ou 6 mythologues qui auront compté en ce siècle » (p. 218). Mais tout de suite, D. Dubuisson dérape : il nous parle de la période 1932-1945 comme d’une époque « troublante », alors qu’elle n’est que troublée. On ne voit d’ailleurs pas ce qu’Eliade fit de troublant, lui qui fut nommé diplomate à Londres puis à Lisbonne par le gouvernement Tătărescu, notoirement hostile à l’Allemagne et partisan d’une alliance avec l’Angleterre… Passons encore sur les allusions biographiques qui démontrent une ignorance quasi totale du contexte historique et politique : juger, 50 ans après des faits que l’on n’a pas connus, des gens a posteriori en fonction de critères bien manichéens, ne nous semble pas un exercice très constructif.
Plus graves sont les reproches à peine voilés d’un chercheur qui, au fil des pages, se mue en commissaire politique. Tout y passe : l’anti-modernisme d’Eliade, son peu de confiance en la démocratie roumaine des années 30, qui aurait influencé l’œuvre ultérieure et suffirait donc à jeter le discrédit sur les quelques 70 ouvrages qui la composent. Car notre procureur parle ouvertement de « jugement scientifique ET MORAL qu’il conviendrait de porter sur cette œuvre » (p. 222), ce en quoi il outrepasse son rôle d’universitaire. Il impose à son lecteur une interprétation policière de l’œuvre éliadienne devant laquelle nous devrions balancer entre « un profond malaise ou une adhésion suspecte » (p. 223). Après nous avoir mis en garde contre « les affirmations nébuleuses de Jung » (p. 20), Dubuisson fustige « la face nocturne, irrationnelle, instinctive ou prophétique » de la démarche d’Eliade, accusé de proposer « une esthétique subjective et irrationnelle de l’émotion religieuse ». Compliment que nous retournerons tout à l’heure à son auteur. Car Eliade a commis le crime de développer une ontologie qualifiée de « primitive », terme tout aussi incongru que “indigène” sous la plume d’un historien des religions !
Dubuisson reproche à Eliade d’être nietzschéen et ajoute même fielleusement : « On conviendra aussi qu’Eliade n’avait pas non plus d’objections majeures à opposer aux sentiments anti-chrétiens et ami-démocratiques du père du Surhomme » (p. 239). Plus loin, c’est la volonté éliadienne de renouer avec les religions “primitives” pour retrouver le contact avec le sacré, qui est démonisée par notre censeur, qui, horrifié, épingle cette phrase terrible : « découvrir l’importance et la valeur spirituelle de ce qu’on appelle paganisme » ! Nous y voilà : le crime par essence est ce recours au paganisme : « la conception éliadienne du sacré, et bien qu’elle plagie la rhétorique religieuse ordinaire, est, vis-à-vis du judéo-christianisme, hérétique. Sans doute peut-on même aller plus loin et affirmer que le sacré éliadien se situe au fond en deçà du religieux » (p. 250).
Le Judéo-Christianisme est donc pour ce chercheur la seule référence possible, la seule échelle de valeurs permise sous peine d’anathème. Qu’un scientifique utilise d’ailleurs le terme “hérétique” pour qualifier les conceptions d’un confrère en dit long sur sa conception du libre-examen ! Si ce n’est pas là une « esthétique subjective et irrationnelle de l’émotion religieuse », à quoi diable avons-nous affaire ? Plus loin, Dubuisson semble déplorer que l’« on ne trouvera dans son œuvre aucun développement important consacré à la foi, au salut de l’âme, à la purification, à la responsabilité, à la charité, à la communion des croyants, au péché et à la contrition, à l’étude et à la médication, en un mot à la vie morale et spirituelle. Seul semble le (= Eliade !) fasciner le sourd grondement des forces tumultueuses qui traversent l’homme et le cosmos ». Nous sommes ici en plein catéchisme ! Plus loin, le père Dubuisson va jusqu’à qualifier le fameux “christianisme cosmique” du paysan roumain de « sorte de naturalisme païen » (p. 253). Plus grave : « dans l’œuvre d’Eliade, le paysan du Danube se retrouve, bien involontairement sans doute, élevé au statut d’interlocuteur privilégié de l’Être » (p. 253) ! Ce statut serait-il donc réservé aux seuls démocrates-chrétiens bon teint ?
Ce reproche est récurrent dans sa thèse : la conception éliadienne de l’Être est « païenne et hérétique à l’égard du christianisme » (p. 254). Dans « Le néo-paganisme de l’homo religiosus», Dubuisson reproche à Eliade, décidément coupable de tous les crimes, de « placer le pôle positif du côté de l’origine et d’inverser le sens que nous (qui donc ?) attribuons au progrès historique », d’exalter les « forces barbares et païennes ». Il parle même de gangue nauséabonde, de germanomanie, de « mystique naturiste, de fascination morbide pour le sexe et le sang, d’apologie de la force et de la puissance, de célébration de l’élite, d’amoralisme, de techniques et d’expériences paroxystiques » (p. 288). Pour un peu, il ferait d’Eliade le défenseur des sacrifices humains, antique tarte à la crème de la polémique chrétienne contre les Païens. Nous infligerons à nos lecteurs une dernière citation, longue mais qui nous éclaire sur ce qui anime le professeur Dubuisson dans sa démarche : « … le néo-paganisme qui la (= la figure de l’homo religiosus) caractérise a pour très exacte antithèse l’éthique judéo-chrétienne et l’humanisme contemporain. Ni les idéaux démocratiques de justice, d’égalité, de tolérance et de progrès social, ni les droits fondamentaux de l’homme (santé, éducation, instruction, …), ni la charité, ni le dévouement à une cause humanitaire n’appartiennent d’une manière ou d’une autre à l’univers inhumain et brutal de l’homo religiosus éliadien. Le héros de La Peste, Simone Weil, Jean Jaurès, Léon Blum, l’abbé Pierre ou le docteur Schweitzer ne présentent, par leurs engagements respectifs autant que par les valeurs au nom desquelles ils les choisirent, aucun des caractères qui permettraient de faire de l’un d’eux un homo religiosus éliadien. À bien des égards, c’est aussi contre la tradition judéo-chrétienne, contre le double principe de la foi et de la loi, contre le rôle libérateur de la réflexion et de l’étude, et contre l’impératif de l’amour du prochain qu’Eliade dresse cette figure païenne » (p. 289). Hors de la nouvelle Église, point de salut !
Il est temps de conclure. La partie consacrée à Eliade n’a pas sa place dans une publication scientifique qui se respecte. Elle est l’exemple parfait d’un phénomène naguère limité aux campus américains : la “political correctness”. Bel exemple de vision dualiste et policière du monde avec son manichéisme primaire, son hypocrisie foncière, l’utilisation systématique du procès d’intention, sa bonne conscience en béton armé, sans oublier l’inélégance foncière du procédé consistant à vilipender un mort. Instrument de répression de toute pensée non soumise aux dogmes (catholiques ou autres), limitant la libre discussion des idées et leur confrontation pacifique qui sont le propre de l’Université, cette political correctness a trouvé en Monsieur Dubuisson un parfait illustrateur.
► Marc Cels, Antaïos n°5, 1994.
C. Mutti, Les Plumes de l’Archange, éd. Hérode, 1993..
D. Dubuisson, Mythologies du XXe siècle, PUL, 1993.
Sur la polémique autour de G, Dumézil, lire l’ouvrage remarquable de D. Éribon, Faut-il brûler Dumézil ?, Flammarion, 1992. Le Révérend Père Dubuisson ferait mieux de le relire et de méditer : il comprendrait alors qu’une lecture de Dumézil aussi partiale et malhonnête que la sienne permettrait à un quelconque zoïle de faire de Dumézil, l’ami et le protecteur d’Eliade, un auteur suspect, à l’ontologie “antisémite”. Il faudrait d’ailleurs qu’il nous explique en quoi une ontologie est ou n’est pas "antisémite” !

 Vont-ils interdire Eliade et Cioran ?
Vont-ils interdire Eliade et Cioran ?La fièvre épuratrice des sectateurs de la pensée unique n’a plus de limites. Qui n’appartient pas au clan des “purs” et des “clairs” est désormais promis au réquisitoire des nouveaux inquisiteurs, en attendant les bûchers où seront brûlés les mauvais livres. La loi des “suspects” est remise à l’ordre du jour. Dernières victimes, deux des plus grands intellectuels du XXe siècle, Mircea Eliade et Emil Cioran. Et, pour faire bonne mesure, on y ajoute le génial Ionesco qui, comme chacun sait, était un écrivain fasciste ! On en rirait si ce n’était tout simplement effrayant.
De son vivant, Emil Cioran fut admiré de tous. Ce paysan des Carpates roumaines, né en 1911 près de Sibiu, dans la zone d’influence germanique de la Transylvanie, était arrivé à Paris en 1937, grâce à une bourse de l’Institut français de Bucarest. Son premier livre en français, Syllogismes de l’amertume, fut publié en 1949. Il en fera paraître beaucoup d’autres par la suite — Précis de décomposition, La tentation d’exister, Le mauvais démiurge, Histoire et utopie, La chute dans le temps, etc. — qui lui vaudront rapidement une juste renommée. Ses aphorismes désespérés, ses pensées sur l’exil, ses réflexions de moraliste solitaire, pour ne rien dire de ses contributions de premier plan à la langue française, furent appréciés dans les milieux les plus différents. Cioran ne retourna jamais en Roumanie, et ne chercha jamais à acquérir la nationalité française. En 1989, il fut nommé membre d’honneur de l’Union des écrivains roumains. Il mourut à Paris le 20 juin 1995.
Dans sa jeunesse, à partir de 1934, Cioran avait déjà publié cinq livres, dont le plus connu, La transfiguration de la Roumanie, sorti en 1936, a lorsqu’il enseignait la philosophie au lycée de Brasov. Dans ces ouvrages, comme dans les articles qu’il publia entre 1934 et 1940, pour la plupart dans le journal Vremea, le jeune Cioran, comme nombre d’autres intellectuels roumains de sa génération, exprimait des idées qu’on pourrait aujourd’hui qualifier de “nationales-révolutionnaires”. C’est à partir de ces écrits de jeunesse qu’un “scandale” a été monté de toutes pièces dans certains milieux.
À peine Cioran était-il mort que paraissait un article signé Jean-Yves Boissau, professeur à l’Université de Toulouse, qui présentait toute l’œuvre de l’écrivain comme un camouflage, tous ses livres publiés en France comme des « biffures masquant un péché (presque) originel » (sic). Cet article fut évidemment publié dans Le Monde. Des articles analogues, jugés par Alain Finkielkraut comme étant « d’une violence extrême », parurent sous la plume de Nicolas Tertulian, tant dans Le Monde que dans Les Temps modemes, revue fondée par Jean-Paul Sartre et aujourd’hui dirigée par Claude Lanzmann. Ce Tertulian, qui n’hésitait pas à s’ériger ainsi en procureur, est arrivé en France dans les années 80, avec derrière lui une carrière déjà chargée. Architecte du réalisme socialiste en Roumanie, membre d’un parti totalitaire pendant 30 ans, il a en effet — au même titre que sa seconde épouse — joué un rôle de commissaire politique à l’Union des écrivains roumains à l’époque du stalinisme, publiant notamment un livre et des articles particulièrement abjects (dont il serait aujourd’hui intéressant de publier une anthologie) dans la revue communiste Viata româneascà — ce qui ne l’a pas empêché d’être ensuite plus ou moins imposé par François Mitterrand à l’École des hautes études en sciences sociales.
Ecce Alexandra Laignel-Lavastine…
Lors d’un débat avec Pierre-Yves Boissau diffusé le 18 novembre 1995 sur France-Culture, dont le texte a été publié en annexe à la nouvelle édition de l’un des livres de Cioran (1), le philosophe roumain Gabriel Liiceanu devait déclarer : « Quantité de grands auteurs de la culture roumaine moderne ont alors été mis à l’index, écartés ou simplement éliminés du circuit culturel après avoir été jugés à l’aune de l’idéologie stalinienne dont le jeune Tertulian se voulait le fidèle représentant. Je n’ai jamais entendu le moindre regret de la bouche de M. Tertulian pour cette période où il s’employait à mettre de l’ordre dans l’histoire de la culture en tant qu’idéologue au service du parti communiste ».
En 1997, Patrice Bollon publie chez Gallimard un livre intitulé Cioran l’hérétique. L’ouvrage, plutôt nuancé, invite au débat. En fait de débat, Jean-Paul Enthoven publie dans Le Point un article au vitriol (2), aussitôt relayé par son ami Bernard-Henri Lévy, dans une chronique pleine de sous-entendus fielleux. L’offensive est si grotesque qu’Angelo Rinaldi ne peut s’empêcher de qualifier BHL de « batteur d’estrade» au « talent sous assistance respiratoire », et d’ironiser sur « l’attitude de l’opulent M. Lévy, qui sonne le tocsin, relayé par sa petite bande — que dis-je, une petite bande, une grande Compagnie, de par le nombre, l’influence » (3). B.H. Lévy répliquera par un trépignement (4). Quelques mois plus tard, dans L’Infini, Marcelin Pleynet taxe Cioran de « penseur roumain ». On croit comprendre que, dans sa bouche, ce n’est pas un éloge.
Mais c’est en 2002 que les flics de la pensée font donner la grosse artillerie. “L’événement”, cette année-là, est un gros livre signé par Alexandra Laignel-Lavastine, qui paraît aux Presses universitaires de France sous le titre : Cioran, Eliade, Ionesco ou l’oubli du fascisme : Trois intellectuels roumains dans la tourmente du siècle. La couverture représente les trois écrivains photographiés à Paris, place Furstenberg, en décembre 1977. Hypocritement, l’auteur se défend d’avoir voulu donner dans la « logique du procès » (p. 30). En réalité, le lecteur « reçoit en pleine figure 533 pages d’un réquisitoire grossissant le trait ou escamotant ce qui nuit, non à une démonstration, mais à sa conviction intime préconçue. […] Pour Alexandra Laignel-Lavastine, tous les moyens sont bons pour convaincre le lecteur, y compris les moins recommandables » (5).
La thèse de l’ouvrage se laisse aisément résumer : Mircea Eliade et Emil Cioran ayant eu dans leur jeunesse des sympathies pour le « fascisme roumain », il en résulte que toute leur existence a eu pour seul objet de camoufler, tout en continuant à la propager, la même philosophie perverse. Les deux écrivains auraient passé leur vie entière à « camoufler, voire recycler » leurs origines, à « brouiller les pistes », à trafiquer leur biographie, à dissimuler une « monstrueuse filiation idéologique ». Quant à Eugène Ionesco, dont on se demande ce qu’il vient faire dans cette galère, il aurait couvert ce « double jeu » pour faire oublier sa nomination au poste d’attaché culturel à la légation de Roumanie à Vichy entre 1942 et 1944. Ce qui permet à Laignel-Lavastine de dénoncer l’« étrange pacte du silence » scellé entre les trois hommes !
Le défaut de dénonciation est toujours un crime
Le livre ne contient pas la moindre révélation. Sous des dehors académiques, il accumule, comme on le verra, erreurs et mensonges répétés. Les pages sur le pauvre Ionesco sont particulièrement grotesques. Chacun sait que cet écrivain, sans doute en partie d’origine juive, n’a occupé à Vichy qu’un poste mineur, où il a passé son temps à traduire des livres roumains en français. Il s’est en revanche opposé de toutes ses forces à la montée du fascisme en Roumanie et a dénoncé toute sa vie durant les systèmes totalitaires (le “rhinocéros”). Alexandra Laignel-Lavastine, qui est bien obligée de le reconnaître, ne l’en accuse pas moins d’« amnésie complice » et d’« oubli du fascisme de ses compatriotes », oubli qui aurait été « cimenté par l’anti-communisme ». Ionesco se voit donc reprocher de n’avoir pas trahi ses amis. On se souvient que sous Staline, le “défaut de dénonciation” était un crime.
Laignel-Lavastine ne cesse de rappeler qu’Eliade et Cioran ont été « proches » de la Garde de Fer (6), en se gardant bien de préciser qu’ils n’y ont jamais adhéré. Grâce à une malhonnêteté caractérisée, qui a été relevée à Bucarest par Mircea Iorgulescu, elle assure qu’il existe « entre les écrits enflammés du Cioran roumain et la prose tardive du moraliste vieillissant une indéniable continuité » (p. 457). Ailleurs, elle confond Romulus Vulcanescu et Romulus Vulpescu. Enfin, elle va jusqu’à mettre en doute l’amitié de Cioran pour Benjamin Fondane, alors qu’en 1942 Cioran prit, avec Jean Paulhan, les plus grands risques pour tenter de sauver Fondane de la déportation et que c’est à son initiative qu’après la guerre, les principaux écrits de ce dernier ont pu être publiés.
Le cas de Mircea Eliade (1907-1986) est différent. Le futur grand historien des religions a d’abord effectué à partir de novembre 1928 un long séjour en Inde, qui eut sur lui une influence décisive. (Mais cette influence-là n’intéresse guère Laignel-Lavastine : l’Inde, c’est évidemment beaucoup moins “rentable” que la Garde de Fer !). Rentré en Roumanie en 1931, il s’y fait connaître deux ans plus tard, avec un roman intitulé Maitreyi. Son livre sur le yoga et les origines de la mystique indienne sera publié en France dès 1936, chez Paul Geuthner. À partir de l’automne 1933, et jusqu’en 1938, Eliade donne également des cours à l’Université de Bucarest. De 1939 à 1942, il dirige la revue Zalmoxis.
Eliade a exprimé sa sympathie pour le Mouvement légionnaire dans une série d’articles publiés entre janvier 1937 et février 1938. Ces articles bien connus ont fait l’objet de plusieurs études (7), et les admirateurs de Codreanu n’ont pas été les derniers à en republier des extraits (8). Les écrits de jeunesse (Scrierile din tinerete) d’Eliade ont en outre été réédités en Roumanie à partir de 1996.
Le nom d’Eliade fut totalement proscrit en Roumanie de 1944 à 1947, sur l’ordre des autorités communistes. Mais à cette date, l’écrivain s’est déjà fait connaître dans le monde entier. Après un bref passage à Paris, où il se heurta (déjà !) à l’hostilité de l’establishment académique français, il s’est installé aux États-Unis, où il a entamé une véritable carrière internationale, créant la revue History of Religions (qui paraît toujours) et publiant, dans les domaines les plus différents (romans, récits, manuels d’histoire des religions, études de mythologie, travaux d’herméneutique, etc.) une série d’ouvrages qui font toujours autorité (9). À partir de 1991, après l’effondrement du système soviétique, l’ampleur de son œuvre sera enfin pleinement reconnue dans son pays natal et l’on verra les livres sur lui se multiplier en Roumanie (10).
La biographie d’Eliade trafiquée
Alexandra Laignel-Lavastine n’est évidemment pas la première à s’en prendre à Mircea Eliade qui, à partir des années 70, avait déjà été attaqué en Italie par des marxistes comme Alfonso M. Di Nola (11) et Furio Jesi, en France, après sa mort, par des hommes comme Edgar Reichmann et Daniel Dubuisson, et aux États-Unis par Norman Manea. Son livre, à bien des égards, se présente d’ailleurs comme une compilation de tout ce que les adversaires d’Eliade ont pu écrire avant elle.
Le point de départ de ces attaques semble résider dans les accusations lancées contre Eliade en 1971 par Miron Constantinescu, président de l’Académie des sciences sociales et politiques de Roumanie à l’époque communiste, dans un volume collectif intitulé Împotriva fascismului (12), qui réunissait les Actes d’une « session scientifique » organisée conjointement par cette Académie et par l’Institut d’études historiques et politico-sociales du comité central du parti communiste roumain.
Ces accusations furent reprises l’année suivante dans un prétendu “dossier” publié dans le numéro de janvier-mars 1972 de la revue israélienne en langue roumaine Toladot (13). Ce dossier non signé s’appuyait, non seulement sur les écrits du communiste Constantinescu, ancien stalinien de fer (non repenti) — qui fut aussi un proche ami de Lucien Goldmann —, mais aussi sur le journal alors inédit de Mihaïl Sebastian, dont il donnait des extraits tronqués et manipulés, ainsi que l’a récemment démontré Roberto Scagno (14). Les deux pages introductives du dossier annonçaient, pour paraître dans le numéro suivant, des documents sur l’activité diplomatique de Mircea Eliade aux « légations roumaines de Lisbonne, Madrid et enfin Londres ». Ces documents n’ont jamais paru. Les données biographiques étaient d’ailleurs complètement fantaisistes, puisqu’Eliade fut d’abord nommé à Londres, sur proposition du linguiste Alexandru Rosetti, où il séjourna du 15 avril 1940 au l0 février 1941, date à laquelle il fut transféré au Portugal. Il resta à Lisbonne durant toute la guerre, jusqu’à son arrivée à Paris en septembre 1945, et ne fut donc jamais en poste à Madrid. La revue dénonçait par ailleurs, avec une extraordinaire impudence, la participation du grand chercheur juif Gershom Scholem à un volume d’hommages en l’honneur d’Eliade (15).
On vient de parler du Journal de Mihaïl Sebastian. Il s’agit là d’un document que Laignel-Lavastine a également utilisé et dont l’histoire n’est pas dépourvue d’intérêt.
“Le Monde” est toujours au rendez-vous
Né en 1907 à Braila, Mihaïl Sebastian, dont la famille appartenait à la communauté juive de Roumanie, fit très tôt partie du cercle du philosophe Nae Ionescu, alors professeur de philosophie métaphysique à l’Université de Bucarest, cercle que fréquentèrent également Eliade et Cioran. C’est d’ailleurs dans le journal de Ionescu, Cuvîntul, qu’il publia ses premiers articles. Il rédigea ensuite une sorte de roman-journal sur l’antisémitisme, De doua mii de ani (Depuis 2000 ans), pour lequel il n’hésita pas à demander une préface à Ionescu, qui venait pourtant de se rallier à la Garde de Fer et allait même en devenir l’un des doctrinaires.
L’ouvrage parut à Bucarest en 1934, aux éditions Nationala-Giornei, avec une préface antisémite de Ionescu, ce qui fut par la suite beaucoup reproché à Sebastian. Ionescu mourut le 15 mars 1940, à l’âge de 50 ans. Sebastian vécut difficilement les années de guerre et trouva la mort en mai 1945 dans un accident (16).
On n’entendit plus guère parler de lui lorsque l’on apprit qu’il avait tenu, entre 1935 et 1944, un journal dont le manuscrit avait quitté la Roumanie en 1961, d’abord pour Israël, puis pour Paris où il se trouvait en possession de son frère. L’ouvrage parut en 1996, aux éditions Humanitas de Bucarest, dirigées par Gabriel Liiceanu, dans une version supervisée par le chercheur israélien d’origine roumaine Leon Volovici. Son succès fut considérable en Roumanie, mais plus mitigé en Israël, où certains reprochèrent à Sebastian sa volonté de se définir à la fois comme « Juif, Roumain et Danubien ». En France, le Journal fut traduit deux ans plus tard par Alain Paruit, avec une préface de l’inévitable Edgar Reichmann (17). Le même éditeur fit ensuite paraître Depuis deux mille ans, sans la préface de lonescu (qui a été maintenue, en revanche, dans la réédition roumaine de 1990). Cette publication donna lieu à un numéro spécial des Temps modernes (n°606, nov-déc. 1999), qui souleva à Bucarest les commentaires les plus virulents. Edgar Reichmann s’empressa d’en rendre compte dans Le Monde du 15 janvier 2000 (18).
Dans son livre, Alexandra Laignel-Lavastine se flatte d’avoir aussi dépouillé des « documents inconnus », notamment le Journal tenu par Eliade lorsqu’il se trouvait au Portugal. Or ce texte, bien connu des chercheurs, a déjà été publié en espagnol (et devrait paraître prochainement en anglais). Son traducteur, Joaquin Garrigós, le présente dans des termes rigoureusement incompatibles avec ce qu’en dit Laignel-Lavastine. « Eliade parle de valeurs, jamais de politique, précise-t-il. Eliade ne s’est pas impliqué dans les aspects politiques du mouvement légionnaire et je crois qu’il ne les a même pas vus à cette époque […] Après avoir lu son Journal du Portugal, je peux dire qu’Eliade, surtout après le meurtre de N. Iorga, a absolument renié le légionnarisme et les agissements de ce mouvement » (19).
Eliade a en effet commencé à critiquer le Mouvement légionnaire dès la fin de 1938, deux ans avant de quitter la Roumanie pour Londres, puis pour Lisbonne. Il n’a jamais accepté ni l’antisémitisme racial ni le racisme biologique, pas plus qu’il n’a porté la chemise verte, adhéré à la Garde de Fer ou prêté serment à Codreanu. Mac Linscott Ricketts, ancien titulaire de la chaire de philosophie et de religion au Louisburg College, en Caroline du Nord, réfute lui aussi, dans le livre extrêmement documenté qu’il a consacré à la jeunesse d’Eliade (dont il est l’un des traducteurs), les affirmations d’Alexandra Laignel-Lavastine relatives à son prétendu antisémitisme. Ricketts souligne qu’il n’y a pas trace dans l’œuvre d’Eliade d’une quelconque judéophobie raciale. Concernant le Journal du Portugal, il écrit qu’« on y chercherait en vain le moindre mot ou la moindre expression antisémite, et encore moins la moindre phrase ou le moindre paragraphe » (20). Indirectement, les témoignages de Joaquîn Garrigós et Mac Linscott Rickets démentent aussi les propos diffamatoires tenus par un autre proche de Laignel-Lavastine, Daniel Dubuisson. Dans un livre publié au début des années 90, Dubuisson qualifiait en effet Eliade de « militant fasciste des années trente », l’accusait d’avoir écrit durant son séjour au Portugal une apologie de l’« État chrétien et totalitaire [sic] » de Salazar, et lui prêtait des « opinions antisémites » qui auraient par la suite « nourri la pensée de l’historien des religions » (21). Pour faire bonne mesure, il dénonçait aussi son « ontologie primitive » (sic) et lui reprochait d’adhérer à une conception cosmique de la nature « radicalement païenne, amorale et pré-religieuse [sic] » (22).
Les insinuations malveillantes et les accusations sans preuves de Dubuisson ont été relevées à plusieurs reprises, notamment par Julien Ries (23) et par Bryan S. Rennie, aujourd’hui professeur au Collège de Pennsylvanie occidentale (24). Mircea Handoca a montré de son côté la parenté entre les propos de Dubuisson et les textes publiés contre Eliade dans la revue communiste Era Noua en 1936 (25).
Le bon et le mauvais totalitarisme
Quant à Cioran, on sait qu’il a explicitement renié la part la plus exaltée de ses écrits de jeunesse. Edgar Reichmann l’a lui-même reconnu dans l’article nécrologique qu’il lui a consacré dans Le Monde deux jours après sa mort, en constatant « chez le moraliste Cioran, une profonde prise de conscience face à l’immensité du désastre qui avait frappé le judaïsme européen, prise de conscience qui, non seulement modifia sa réflexion sur le peuple juif, mais devait également lui dicter un mea culpa, paru en 1956, signifiant la reconnaissance de ses égarements passés » (26). Le « mea culpa » dont parle Reichmann est le texte « Un peuple de solitaires », paru en 1956 dans La tentation d’exister (27), ouvrage dont l’édition américaine, en 1968, sera préfacée par Susan Sontag. Évoquant La transfiguration de la Roumanie, Cioran écrivait d’ailleurs encore en décembre 1988, à Dumitru Mincu : « Je renie complètement une très grande partie de ce livre, qui relève des préjugés d’alors ».
Comme à peu près la moitié des jeunes intellectuels roumains de leur génération, Eliade et Cioran eurent donc de la sympathie pour le Mouvement légionnaire. Mais ils n’y adhérèrent jamais et prirent par la suite très nettement leurs distances par rapport à son idéologie. D’autres jeunes gens s’enflammèrent à la même époque pour le communisme. Ce fut le cas de certains de ceux qui mirent par la suite en accusation Cioran et Eliade, sans avoir jamais fait eux-mêmes leur mea culpa, jugeant apparemment que leurs propres erreurs les mettaient dans une excellente position pour dénoncer celles des autres.
On voit évidemment mal en quoi il serait plus condamnable d’avoir eu de la sympathie pour la Garde de Fer que d’avoir milité pour le stalinisme. Mais Alexandra Laignel-Lavastine fait partie de ces sophistes pour qui seul le “fascisme” fut le mal absolu, en sorte qu’on ne saurait le mettre sur pied d’égalité avec le communisme stalinien, qui provoqua pourtant un bien plus grand nombre de morts. Les totalitarismes à ses yeux ne se valent pas. En témoigne éloquemment son texte intitulé « Fascisme et communisme en Roumanie : Enjeux et usages d’une comparaison » (28), tout comme sa récente recension d’un livre de Régine Robin (29), où elle se félicite de voir dénoncer, notamment chez Stéphane Courtois, Jean-François Revel ou Tzvetan Todorov, « la mise en avant des crimes du communisme pour mieux minimiser ceux du nazisme et du fascisme » (sic) (30).
Alexandra Laignel-Lavastine se défend dans son livre d’avoir fait œuvre de procureur. Comme en réalité, elle ne fait que cela, il faut en déduire qu’elle est en plus hypocrite. Les critiques ne s’y sont pas trompés. Leurs recensions ont été d’autant plus favorables qu’ils ne connaissaient strictement rien du sujet traité dans le livre, mais sympathisaient pleinement avec les intentions de son auteur.
Dès sa sortie, l’ouvrage est bien entendu couvert d’éloges par Bertrand Poirot-Delpech dans Le Monde. Peu après, dans Le Point, Jean-Paul Enthoven, vante cette « prodigieuse enquête » après laquelle « on ne pourra plus les lire [Eliade et Cioran] avec l’innocence des ignorants » (31). (Sous-entendu : on ne pourra plus les lire sans prendre soi-même le risque d’être dénoncé comme complice, c’est-à-dire qu’on ne pourra plus les lire du tout). Dans Libération, Laurent Lemire salue lui aussi cette enquête « impitoyable », qui « aligne des faits indiscutables » (sic) (32). Lire ajoute que Laignel-Lavastine est « la première à avoir scrupuleusement dépouillé la presse de Bucarest des années trente » (sic) et que les conclusions auxquelles elle parvient sont « accablantes ». Dans L’Humanité, Jacques Maran affirme froidement que Mircea Eliade fut « le penseur de la sinistre Garde de Fer », puis écrit à propos de Laignel-Lavastine : « Elle démontre que le poison [sic] a continué de circuler dans les œuvres d’Eliade et de Cioran, que les œuvres postérieures à 1945 ne furent finalement qu’une justification déguisée de pensées persistantes ». Et de conclure que ce « travail remarquable » est « salutaire parce qu’il oblige à renforcer une vigilance atténuée par le nivellement de toutes les pensées » (33) !
Procédés douteux et manichéisme délirant
Du côté de ceux qui ne se contentent pas d’une culture de surface, contrairement à la plupart des journalistes parisiens, le son de cloche est totalement différent. Relevant les citations tronquées, les traductions fautives, le procès d’intention permanent, Alain Paruit, le traducteur du Journal de Mihaïl Sebastian, n’hésite pas à parler dans la revue Esprit d’un livre aussi faux que superficiel, rédigé sous le signe « de l’irrationnel et de la paranoïa » (34). Mettant en regard les citations faites par Alexandra Laignel-Lavastine et les textes réels des auteurs qu’elle dénonce, Paruit stigmatise ses « procédés douteux », ses « commentaires tendancieux », ses « épithètes insidieuses », ses « traits de plume assassins », ses « interprétations fausses », son « manichéisme délirant ». Sa conclusion est qu’il s’agit d’une « thèse préconçue » et d’un « ouvrage écrit à la hâte », empreint d’une « roumanophobie pathologique ».
Les réseaux s’étant mis en branle, la revue Esprit fera paraître peu après une “seconde lecture” due à Pierre Pachet et Étienne Boisserie, elle-même suivie d’une réponse de Paruit (35). Boisserie y explique les critiques adressées à Laignel-Lavastine par une grande partie des élites roumaines par la « propension » de ces dernières à « graduer les deux grands totalitarismes du siècle » (36). Malheureux “gradueurs” roumains qui n’ont pas encore compris que Codreanu fut infiniment pire que Staline ! Paruit sera également confronté à Edgar Reichmann sur les ondes de RFI — Alexandra Laignel-Lavastine, pressentie, ayant préféré se dérober. Le texte de ce débat sera publié en Roumanie (37).
Tout aussi dévastateur est le long article de Constantin Zaharia paru dans la revue Critique, c’est-à-dire aux éditions de Minuit (38). Zaharia, lui aussi, se livre à un minutieux relevé de toutes les fantaisies de la comtesse Alexandra : « erreurs de chronologie » (elle fait mourir l’écrivain Titu Maiorescu en 1980, alors qu’il est décédé vingt ans plus tôt, et va jusqu’à prétendre que Cioran était « déjà très écouté dans son pays au tournant des années trente » alors qu’à cette date il n’avait encore rien publié !), « confusions », « carences », « erreurs », « procédés de dénigrement », etc. Il souligne sa « désinvolture historique », sa « manipulation des textes », sa « langue de bois ». « Plutôt que d’élucider l’engagement politique de Cioran et d’Eliade dans les années trente, conclut-il, Alexandra Laignel-Lavastine commence par décréter leur culpabilité, quitte ensuite à arranger textes et faits en faveur de sa thèse […] Au lecteur roumain que je suis, L’oubli du fascisme fait moins l’effet d’un livre d’histoire que d’un réquisitoire dressé par la Securitate » (39). La Securitate était l’équivalent roumain de la Gestapo.
Dans Balkans-Infos, Jean-Michel Bérard relève pour sa part une myriade d’exemples d’« amalgame » et d’« inexactitudes historiques », avant d’ajouter que Laignel-Lavastine « prend ses lecteurs pour des poires, en manipulant délibérément ses sources ou en utilisant des citations tronquées » (40).
Mais c’est en Roumanie même que les réactions sont les plus vives. Du 23 avril au 29 juillet 2002, la revue hebdomadaire 22, l’un des organes réputés de l’intelligentsia roumaine, publie une série d’articles où, à longueur de colonnes, s’expriment à la fois l’indignation et l’accablement. Mircea Iorgulescu, par exemple, déclare relever des « centaines d’erreurs» dans le « lamentable livre d’Alexandra Laignel-Lavastine », qu’il compare explicitement à ce qui s’écrivait sur Cioran dans la Roumanie stalinienne, entre 1948 et 1964. « Vérités, demi-vérités et mensonges, écrit-il, telle est la recette classique d’un dossier politique destiné à faire prononcer une sentence en réalité déjà connue […] Physiquement disparus, Cioran, Eliade et Ionesco ne pouvaient être “exécutés” que de manière symbolique, les deux premiers par le “feu”, comme le suggère le livre d’Alexandra Laignel-Lavastine, le dernier par la disqualification morale » (41).
“Plagiat éhonté et haut vol qualifié”
Marta Petreu, professeur de philosophie à l’Université de Cluj, publie de son côté une série de cinq articles totalisant plus de 50 pages, dans lesquels elle accuse Laignel-Lavastine, non seulement de n’être qu’une spécialiste des études de seconde main, mais encore d’avoir littéralement pillé ses propres travaux (42). N’hésitant pas à parler de « plagiat éhonté » et de « haut vol qualifié », elle cite des pages entières de textes qui lui auraient été « empruntés » et qui voisinent, dans le livre de Laignel-Lavastine, avec une multitude d’erreurs historiques, d’assertions dénuées de tout fondement et de citations déformées. Le titre de l’un de ces articles est parlant : « Luati serviti, acestea sunt cartile mele ! » (« S’il vous plaît, servez-vous, voilà mes ouvrages ! ») (43).
Alexandra Laignel-Lavastine est une femme qui, comme beaucoup de ses contemporains, a très vite compris que pour faire carrière aujourd’hui, il faut avant tout savoir dans quel sens souffle le vent. Intelligente, écrivant correctement, mais totalement dépourvue de personnalité, elle n’a pour ce faire jamais hésité à payer de son aimable personne. D’où un parcours aussi révélateur qu’“exemplaire”.
Née en 1966, d’un papa à la reconnaissance tardive (elle s’est d’abord appelée Alexandra Carreau), elle eut pour grand-père l’excellent écrivain Philippe Lavastine (44). Germaniste, mais aussi spécialiste de la pensée indienne (il passa plusieurs années en Inde, tout comme Mircea Eliade), celui-ci avait des opinions “de droite” très affirmées. Il avait épousé Artemisa Iordanescu, qu’il avait rencontrée à la Bibliothèque nationale et qui fut pendant quelque temps secrétaire générale de la faculté des lettres de l’Université de Bucarest. Lui-même fut professeur de philosophie orientale à la Sorbonne. Sous l’Occupation, on le retrouve comme critique à Comœdia. En 1943, c’est également lui qui permit à René Zuber, qui devait par la suite lui consacrer un livre, de rencontrer Gurdjieff. Passionné d’ésotérisme, on lui doit notamment la présentation du Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l’homme et l’univers de Louis-Claude de Saint-Martin, dans l’édition parue en 1946 au Griffon d’or. Il traduisit aussi les Fragments d’un enseignement inconnu, de P. D. Ouspensky (45), et collabora à la réalisation du film de Jean-Claude Lubtchansky sur Georges Gurdjieff diffusé sur TF1 le 22 septembre 1978.
Homme très raffiné et d’une vaste culture, Philippe Lavastine n’a jamais eu beaucoup d’estime pour la jeune Alexandra, qu’il tenait pour une petite personne aussi ambitieuse qu’insignifiante. (Comme il avait en revanche la plus grande admiration pour Mircea Eliade, on peut se demander si Alexandra Laignel-Lavastine n’a pas réglé dans son livre quelque conflit œdipien). Quoi qu’il en soit, son ascendance roumaine aidant, Alexandra Laignel-Lavastine s’est assez tôt tournée vers Bucarest. Elle noue ses premiers liens avec la Roumanie par l’intermédiaire de la fille d’Eugène Ionesco. Des études d’histoire et de philosophie lui donnent également l’occasion de faire la connaissance de Matei Cazacu, qui enseigne alors l’histoire des Balkans à l’Université de Paris IV. Celui-ci la présente un autre émigré roumain, maître-assistant à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Mihnnea Berindei, qui a fondé une Ligue roumaine des droits de l’homme à Paris, au moment de l’arrivée en France de Paul Goma.
Fricotages avec l’intelligenstia roumaine
Mais très vite, Berindei s’éloigne. Au début des années 80, c’est un journaliste de L’Express qui emmène Alexandra Laignel-Lavastine en Roumanie. On la retrouve à la même époque au comité de rédaction de La Nouvelle Alternative, revue où écrivent également de nombreux dissidents roumains. Elle fréquente les milieux de Radio Free Europe, où elle rencontre un jeune diplômé de philosophie de l’Université de Cluj, Emil Hurezeanu, aujourd’hui journaliste à la Deutsche Welle. Elle l’épouse, lui. donne un fils, puis divorce. Elle travaille alors sur une thèse de doctorat comparant la pensée de Jan Patocka (1907-1977) et celle de Constantin Noïca (1909-1987). Tout de suite après l’assassinat de Ceausescu, elle est dans l’avion qui emmène à Bucarest un petit groupe d’intellectuels français. Peu après, elle entame une relation intime avec le philosophe Gabriel Liiceanu, ancien chercheur à l’Institut roumain de philosophie, devenu professeur à l’Université de Bucarest et qui s’est vu confier la direction des éditions Humanitas (avec quelques subventions des services culturels français). Elle fricote avec l’intelligentsia roumaine, fait connaître Liiceanu à Paris et achève sa thèse à l’Université de Paris IV. Elle en tirera par la suite la matière de deux livres, l’un publié en roumain chez Humanitas, l’autre en français chez Michalon (46).
Gabriel Liiceanu, né en 1942, est l’auteur d’un beau livre sur Cioran, où il ne dissimule pas son admiration pour l’auteur des Syllogismes de l’amertume. Alexandra Laignel-Lavastine le traduit en français et le fait paraître chez Michalon (47). Elle ne s’est apparemment pas encore avisée que Cioran était un affreux personnage. Elle intégrera d’ailleurs le livre de Liiceanu à sa propre bibliographie, en arguant de sa traduction et de ses « recherches d’archives ». Peu après, cependant, elle opère un revirement complet, commençant à accabler celui que Liiceanu n’a cessé de défendre. En témoignent sa communication sur le « premier Cioran » faite au colloque organisé par l’Institut culturel français de Bucarest les 23 et 24 mai 1996, et surtout, l’année suivante, son article intitulé « Le jeune Cioran : De l’inconvénient d’avoir été fasciste », publié dans la revue Le Débat, chez Gallimard, où Pierre Nora se souvient encore d’elle (48). Son livre de 2002 consacrera cette évolution.
Quand Nicolas Weill entre en scène
Entre-temps, un nouveau personnage a fait irruption dans sa vie. Il s’agit de Nicolas Weill, journaliste au Monde, où il est vaguement chargé des questions de société. À lire ses articles, on constate en fait qu’il se veut surtout spécialiste en “mémoirologie”, catégorie repérage et dénonciation. Son conformisme vis-à-vis de l’idéologie dominante lui a valu de se voir décerner une « laisse d’or [de la servilité] » par le bimestriel Pour lire pas lu (49). S’ériger en procureur est l’un de ses exercices favoris. C’est ainsi qu’en 1996, il publie dans Le Monde un article dans lequel il accuse sans rire la Nouvelle Droite d’avoir « remis au goût du jour une version renouvelée du darwinisme social discrédité » (sic) (50). Quelques mois plus tard, lorsque le malheureux Maurice Blanchot, écrivant sous la dictée de Monique Anthelme, somme sous peine de rupture les éditions Fata Morgana de « rayer de leur catalogue » et de « retirer de la vente » le livre d’Alain de Benoist L’empire intérieur, qu’elles viennent de publier (51), c’est encore lui qui rend compte de l’affaire dans un article auquel il sera donné des suites judiciaires (52). Plus récemment, pour ne citer qu’un seul exemple, on l’a vu accuser le philosophe Jacques Bouveresse d’avoir fait un « silence presque complet » sur l’anti-dreyfusisme de Karl Kraus (53).
Dans un livre paru début 2003, Une histoire personnelle de l’antisémitisme, ouvrage où il ne parle guère de lui-même et qui a reçu un accueil plutôt mitigé (54), Nicolas Weill raconte qu’au cours du procès Papon, qu’il couvrait pour le compte du Monde, il préférait s’asseoir aux côtés des parties civiles plutôt qu’avec ses confrères journalistes, qu’il jugeait insuffisamment hostiles à l’accusé (sic). « Ma volonté d’inscription dans l’histoire des juifs, écrit-il, aussi bien que mon empathie de toujours pour Israël et pour le sionisme m’ont constamment servi de boussole » (55). Le socialiste Pascal Boniface commente : « Effectivement, ses papiers sont toujours plus marqués par la volonté de défendre Israël et ses amis que par un souci d’information objective. Cela pourrait se comprendre dans un journal communautaire, moins dans un journal de référence » (56).
Alexandra Laignel-Lavasüne s’est vite mise au diapason. Nicolas Weill lui a tout naturellement ouvert les colonnes du Monde et l’a mise en contact avec ses réseaux. Chargée de cours à l’EHESS, membre du laboratoire d’analyses des systèmes politiques de l’Université de Paris X, elle s’agite aujourd’hui un peu partout. Elle participe à d’innombrables colloques (Nanterre, Bucarest, Salamanque, Rennes, etc.) et collabore à de nombreux ouvrages collectifs (57). Dans Le Monde des livres — le club de Josyane Savigneau —, elle écrit surtout sur le “fascisme roumain” et la résurgence de “l’extrême droite” dans les pays de l’Est, sujet apparemment inépuisable. Son livre sur Cioran, Eliade et Ionesco lui sert désormais de carte de visite. Elle est enfin “arrivée” !
Cioran, Eliade, Ionesco ou l’oubli du fascisme est significativement dédié à Isac Chiva. Né en 1925 en Roumanie, dont il est parti fin 1947, celui-ci est arrivé à Paris en janvier 1948. Il a participé au séminaire de Claude Lévi-Strauss au Musée de l’homme, puis a travaillé jusqu’en 1959 au Musée national des arts et des traditions populaires (58). Chercheur au CNRS à partir de 1951, il entre en 1960 à l’EHESS (où il contribuera à la promotion de Pierre Bourdieu), crée la revue Études rurales et participe à la création d’un laboratoire d’anthropologie sociale dont il assurera la sous-direction jusqu’en 1982. De 1972 à 1982, il appartient également au comité de direction de la revue Ethnologie française et préside en 1978 la Société d’ethnologie française.
Où l’on retrouve les “vigilants”
Personnage à la fois cultivé et obséquieux, et surtout fort vindicatif, Isac Chiva, qui est également très actif à la Maison des sciences de l’homme, est un proche d’Alexandra Laignel-Lavastine et de Nicolas Weill. Il participe d’ailleurs à l’occasion à leurs “croisades” (59). Il a récemment été l’organisateur d’un colloque d’ethnologie (« Du folklore à l’ethnologie : Institutions, musées et idées en France et en Europe, de 1936 à 1945 », Paris, 19-21 mars 2003), ce qui a permis à Nicolas Weill d’en rendre compte dans Le Monde sous un titre suggestif (60). Il arrive même qu’Alexandra lui tienne la plume. En lisant un article paru sous son nom dans Les Temps modernes, par exemple, on découvre que le texte a en réalité été écrit par Laignel-Lavastine « à partir d’entretiens […] réalisés entre 1996 et 2003 » (61).
Parmi les bêtes noires du trio figure l’écrivain roumain Paul Goma, à qui ses adversaires ne pardonnent pas de n’avoir jamais cessé de critiquer ceux qu’il juge coupables de compromissions avec le pouvoir communiste ou post-communiste roumain. Edgar Reichmann, dans Le Monde, lui a reproché d’avoir évoqué dans un livre autobiographique un commissaire juif du NKVD qui aurait enquêté sur son père en Bessarabie occupée par les Soviets. Isac Chiva lui attribue des « écrits négationnistes » (62). Opposant à Ceausescu, Goma fut arrêté en 1977 après avoir adressé une lettre ouverte au gouvernement roumain appelant à signer la “Charte 77” de Vaclav Havel et Jan Potocka. Il émigra en France l’année suivante. Son œuvre lui a valu une renommée mondiale. En 1999, il fut (avec le poète surréaliste Gelu Naum et Mircea lvanescu) l’un des trois écrivains proposés pour le Prix Nobel de littérature par l’Association roumaine des écrivains (63).
Dans la même mouvance, on trouve également le psychosociologue d’origine roumaine Serge Moscovici, père du socialiste Pierre Moscovici, qui fut de 1997 à 2002 le très germanophobe ministre chargé des Affaires européennes du gouvernement Jospin. Lui aussi né en 1925, lui aussi arrivé à Paris en 1948, Serge Moscovici a lui aussi fait carrière à l’EHESS (64). Comme Isac Chiva, Daniel Dubuisson, Nicolas Tertulian et Patrick Kéchichian, il figure parmi les signataires de l’Appel à la vigilance (sic) lancé dans Le Monde en 1993 par Roger-Pol Droit et Maurice Olender (65). En 2002, il a publié un essai intitulé De la nature (66). Qui l’a alors recensé dans Le Monde des livres ? La charmante Alexandra, bien sûr (67). Auparavant, Alexandra Laignel-Lavastine avait déjà figuré aux côtés de Serge Moscovici et de Pierre Pachet dans un livre édité sous la direction de Michel Wieviorka, Raison et conviction : l’engagement (68). Les nuis mêmes se sont retrouvés le 25 février 2003 à la Maison des écrivains, à Paris, pour un débat animé par Maria Maïlat sur le thème : « Des intellectuels aux prises avec les totalitarismes ».
Tout récemment encore, dans Le Monde des livres du 14 mars 2003, Alexandra Laignel-Lavastine rendait compte, très élogieusement bien sûr, du livre de Radu Ioanid sur La Roumanie et la Shoah (69). Elle omettait seulement de signaler que la version française de ce livre a été, selon les termes mêmes de l’éditeur, « revue par Nicolas Weill » ! Même oubli chez Maria Maïlat, dans son compte-rendu publié par Les Temps modernes (fév-avr. 2003). Né à Bucarest, Radu Ioanid, fils d’un célèbre apparatchik stalinien des années 50, aujourd’hui directeur de programmes au Musée de l’Holocauste de Washington, a lui-même fait une partie de ses études à Paris, à l’École des hautes études en sciences sociales. Un texte de lui figurait déjà dans le numéro des Temps modernes dont on a déjà parlé (70). On lui doit aussi un livre contre la Garde de fer (71), ainsi que… l’introduction et les notes de l’édition américaine du Journal de Mihaïl Sebastian (72).
On le voit : tous ces gens-là fonctionnent en réseau.
Dans son livre sur Cioran, Eliade et Ionesco, Alexandra Laignel-Lavastine écrit textuellement : « Sur ces pensées pèse dorénavant un soupçon » (73). Cette phrase, à elle seule, éclaire le but de l’entreprise : faire en sorte que Mircea Eliade et Emil Cioran ne puissent plus être lus sans être “soupçonnés” — ou sans que leurs lecteurs ne le soient eux-mêmes. Mais ce n’est pas là le seul but. Un autre objectif de cet ouvrage, qui a toutes les allures d’un livre de commande, est de discréditer les figures les plus marquantes et les plus admirées de l’émigration roumaine au profit d’autres auteurs roumains plus médiocres, qui savent bien qu’une seule page de Cioran ou d’Eliade suffit à faire pâlir toutes leurs petites productions. Ceux-là n’en finissent pas de remâcher leur rancœur que des auteurs “suspects” aient eu plus de talent qu’ils n’en auront jamais eux-mêmes. Ils pensent se grandir en rabaissant ceux qui leur font de l’ombre. C’est pourquoi ils passent leur vie à fouiller le passé des autres en prenant bien soin de faire le silence sur le leur.
Leur point commun est de porter sur l’histoire roumaine contemporaine un regard exclusivement “antifasciste”, qui les conduit à mettre systématiquement en accusation ceux qui ne partagent pas leur point de vue. Dans une telle perspective, il n’est évidemment plus question de s’interroger sur la valeur littéraire et morale des maximes de Cioran, ou sur la valeur herméneutique de l’approche faite par Eliade des croyances et des mythes. Il s’agit seulement de discréditer en bloc toute la culture roumaine de l’entre-deux-guerres pour cause d’“imprégnation fasciste”, et de discréditer encore nombre d’intellectuels roumains de la nouvelle génération, tous coupables de ne pas assez manifester de “repentance”.
L’art et la manière de fusiller les morts
Alexandra Laignel-Lavastine a prudemment attendu que Cioran, Eliade et Ionesco soient morts pour se soulager à leurs dépens. Son livre faussement érudit, qui est avant tout d’une extraordinaire bassesse, n’en est pas moins révélateur, lui aussi, de certaines mœurs actuelles. L’érudition n’est plus ce qui permet d’analyser pour mieux comprendre, mais sert de prétexte à dresser des dossiers d’instruction, à jouer les procureurs tout en intimant le silence aux avocats, à fusiller et refusiller sans cesse des hommes qui ne sont plus là pour se défendre.
On pense au cas de Florence Hartmann, passée de la fonction de journaliste au Monde, dont elle fut la correspondante à Belgrade, à celle de porte-parole du Tribunal pénal international de La Haye !
► Jean-Claude Maurin, éléments n°109, 2003.
Notes :
- E.M. Cioran, Mon pays – Tara mea, Humanitas, Bucarest 1996, pp. 155-200.
- Le Point, 5 avril 1997.
- L’Express, 8 mai 1997.
- Le Point, 10 mai 1997, p. 122.
- Jean-Michel Bérard, « Les grands intellectuels étaient-ils fascistes ? », in Balkans-Infos, sept. 2002, p. 14.
- La Garde de Fer a succédé en 1930 à la Légion de l’Archange Michel, créée par Corneliu Codreanu en 1924. Codreanu est mort assassiné. Son mouvement fut éliminé par le gouvernement du maréchal Antonescu en janvier 1941. Sur la Garde de Fer et ses origines, cf. notamment Armin Heinen, Die Legion “Erzengel Michael” in Rumänien : Soziale Bewegung und politische Organisation – Ein Beitrag zum Problem des internationalen Faschismus, R. Oldenbourg, München, 1986.
- Cf notamment Mac Linscott Ricketts, Mircea Eliade : The Romanian Roots, 1907-1945, 2 vol., Columbia University Press, New York 1988, chap. 22 ; ainsi que l’anthologie préfacée par Mircea Handoca : Mircea Eliade, Textele “legionare” si despre “românisn”, Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
- Cf. Les ouvrages de Claudio Mutti, Mircea Eliade e la Guardia di ferro, Edizioni del Veltro, Parma, 1989 ; et Le penne dell’Arcangelo, Barbarossa, Milano, 1994 (trad. fr : Les plumes de l’archange – Quatre intellectuels roumains face à la Garde de fer : Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Hérode, 1993).
- Cf Douglas Allen et Dennis Doeing, Mircea Eliade : An Annotated Bibliography, Garland, New York, 1980 ; Mircea Handoca (ed.), Mircea Eliade : Bio-bibliografie, 3 vol., Jurnalul literar, Bucuresti, 1997-99.
- Cf. notamment Mircea Itu, Indianismul lui Eliade, Orientul Latin, Brasov, 1997 ; Mircea Handoca, Pro Mircea Eliade, Dacia, Cluj-Napoca, 2000. Dès 1980, Adrian Marino avait toutefois déjà publié Hermeneutica lui Mircea Eliade (Dacia, Cluj-Napoca 1980), qui fut traduit en français l’année suivante (L’herméneutique de Mircea Eliade, Gallimard, 1981).
- Cf. Alfonso M. Di Nola, « Mircea Eliade tra scienza delle religioni e ideologia “guardista” », in : Marxismo d’oggi, sept-nov. 1989.
- Editura politica, Bucuresti, 1971.
- « Dosarul Mircea Eliade », pp. 21-27.
- « Alcuni punti fermi sull’impegno politico di Mircea Eliade nella Romania interbellica : un commente critico al dossier “Toledot” del 1972 », in Julien Ries et Natale Spineto (éd.), Esploratori del pensiero umano : Georges Dumézil e Mircea Eliade, Jaca Book, Milano, 2000, pp. 259-289.
- Joseph M. Kitagawa et Charles H. Long (ed.), Myths and Symbols : Studies in honor of Mircea Eliade, University of Chicago Press, Chicago, 1969.
- Il fut en fait écrasé par un camion soviétique dans des circonstances qui n’ont jamais été éclaircies.
- Mihaïl Sebastian, Journal 1935-1944, Stock, 1998.
- Venu lui aussi d’une Roumanie stalinienne dans laquelle il aurait eu son mot à dire, notamment lors des épurations universitaires de 1956, Edgar Reichmann est arrivé à Paris en septembre 1957. Il a d’abord travaillé aux bureaux de l’agence United Press International, avant de devenir conseiller d’édition. En 1967, ayant acquis la nationalité française, il a été nommé fonctionnaire à l’Unesco. Il est aujourd’hui chroniqueur littéraire au Monde et à la revue du Fonds social juif unifié (FSJU), L’Arche.
- Entretien publié à Bucarest dans la revue România libera, 13 avril 2000. La version espagnole du Journal portugais d’Eliade a été publiée quelques mois plus tard : Diario portugués, 1941-1945, Kairós, Barcelona, 2001. Des extraits des versions française et anglaise ont paru dès 1993 en Roumanie : Mircea Eliade, Jurnal 1941-1969, Humanitas, Bucuresti.
- Op. cit. Laignel-Lavastine s’appuie notamment sur des propos diffamatoires proférés par Saul Bellow, propos visiblement inspirés par la jalousie. On notera encore que les archives concernant l’activité d’Eliade à la Légation roumaine de Londres ont été exploitées par Alexandra Berger (« Fascism and Religion in Romania », in : Annals of Scholarship, VI, 1989, 4, pp. 455-465) d’une façon dont l’Écossais Bryan S. Rennie a démontré l’absence totale d’objectivité (« The Diplomatic Career of Mircea Eliade : A Response to Adriana Berger », in : Religion, XXII, 1992, 4, pp. 375-392). Cf. aussi les textes de Francis I. Dworschak diffusés par la Mircea Eliade International Literary Society, fondée en mars 1998 par Octavian Sarbatoare à Sydney, en Australie.
- Mythologies du XXe siècle : Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade, Presses universitaires de Lille, Lille, 1993, pp. 215-303.
- Ibid., p. 301.
- « Orizontul iudeo-crestin in opera lui Mircea Eliade, Dumnezeu, mit si istorie », in : Cristian Badilita (éd.), Eliadana, Iasi, 1997, pp. 38-46.
- « Mircea Eliade, coupable jusqu’à preuve du contraire », in : Jurnalul literar, V, 1994, pp. 13-16.
- « La ricezione dell’opera di Mircea Eliade in Romania », in Julien Ries et Natale Spineto (éd.), Esploratori del pensiero umano, op. cit., pp. 391-406. Le même auteur avait déjà réfuté antérieurement les accusations de Dubuisson : « lgnoranta sau rea credinta în interpretarea biografiei si operei lui Mircea Eliade », in : Jurnalul literar, V, 1994, pp. 25-28.
- Le Monde, 22 juin 1995, p. 29.
- Gallimard, 1956, pp. 64-97.
- In : Henry Rousso (éd.), Stalinisme et nazisme : Histoire et mémoire comparées, Complexe, Bruxelles, 1999.
- La mémoire saturée, Stock, 2003.
- Le Monde, 9 mai 2003.
- Le Point, 29 mars 2002.
- Libération, 4 avril 2002.
- L’Humanité, 15 août 2002.
- « Comment critiquer Eliade, Cioran et Ionesco », in : Esprit, août-sept. 2002, pp. 227-239. Texte traduit en roumain dans la revue 22 (« Uitarea rigorii », 35-36, 2002).
- « La Roumanie, le travail de mémoire et la méthode historique », in Esprit, déc. 2002, pp. 209-225.
- Ibid., p. 214.
- In : 22, Bucarest, 18 juin 2002.
- « Cioran, Eliade, Ionesco : l’oubli de l’histoire », in : Critique, nov. 2002, pp. 850-868.
- Ibid., p. 867.
- Art. Cit.
- In 22, Bucarest, 28 mai 2002.
- « Laignel-Lavastine : metoda “franceza” », in : 22, Bucarest, 25 juin, 2, 9, 16 et 23 juillet 2002.
- Titre de l’article du 9 juillet.
- Elle est aussi la descendante du célèbre professeur de médecine Maxime Laignel-Lavastine (1875-1953), ancien directeur de l’École supérieure d’anthropo-biologie de Paris, auteur d’une Histoire générale de la médecine (1936-49) qui a fait date. Spécialiste de neurologie, inventeur en 1908 du terme de “psychiatrie endocrinienne”, celui-ci fut également, à partir de 1936, le président d’honneur de la Société d’histoire de la médecine hébraïque. Sous l’Occupation, il donna le 30 mars 1941, au Palais de la Découverte, une conférence sur les origines de la folie.
- Stock, 1975.
- Alexandre Laignel-Lavastine, Filozofie si nationalism : Paradoxul Noica, Humanitas, Bucarest, 1998 ; Jan Patocka : L’esprit de la dissidence, Michalon, Paris 1998. Le livre sur Noïca est pour l’essentiel une dénonciation de son « ontologie ethnique ». L’essai sur Patocka est paru dans la collection “Le bien commun”, dirigée par Antoine Garapon, membre du comité de rédaction de la revue Esprit et président du Comité Kosovo. La thèse d’origine, en deux volumes, s’intitulait La philosophie nationaliste roumaine – Une figure emblématique : Constantin Noïca, 1909-1987.
- Emil Mîhai Cioran, Itinéraires d’une vie, suivi de : Les continents de l’insomnie, Michalon, 1995. Liiceanu a publié, en collaboration avec Andrei Plesu, une belle anthologie de textes sur Eliade : Drumzul spre centru, Univers, Bucuresti 1991. Laignel-Lavastine a également traduit de lui un autre livre (au titre prémonitoire) De la limite : Petit traité à l’usage des orgueilleux, Michalon, 1997. S’y ajoute, dans un genre plus plaisant, la traduction d’un livre de Martin Schulman sur l’Astrologie karmique (Rocher, 1995). Sur Cioran, cf. aussi Mariana Sora, Cioran, jadis et naguère, L’Herne, 1988 ; Patrice Bollon, op. cit. ; Norbert Dodille et Gabriel Liiceanu (éd.), Lectures de Cioran, L’Harmattan, 1997 ; Sanda Stolojan, Au balcon de l’exil roumain à Paris : Avec Cioran, Eugène Ionesco, Mircea Eliade, Vintila Horia, L’Harmattan, 1999 ; Sylvie Jaudeau, Cioran ou le dernier homme, José Corti, 2001 ; Nicole Parfait, Cioran ou le défi de l’être, Desjonquères, Paris, 2001 ; George Balan, Emil Cioran, Josette Lyon, Paris, 2002.
- Le Débat, janv-fév. 1997, pp. 102-120.
- Pour lire pas lu, juin-août 2002.
- « Le mythe de l’inégalité des races », in : Le Monde, 13 sept. 1996.
- Cf. « Une lettre de Maurice Blanchot », in : La Quinzaine littéraire, 1er nov. 1996, p. 5.
- « Maurice Blanchot et le débat sur la Nouvelle Droite », in : Le Monde, 15 nov. 1996. Ayant refusé de publier un droit de réponse d’Alain de Benoist, Le Monde fut assigné en référé le 10 décembre 1996.
- Le Monde, 5 mai 2001.
- Dans Le Monde des livres (14 mars 2003), Marc Weitzmann y relève « une doxa moralisante un peu pénible ». Sylvain Boulouque, dans le journal socialiste L’Ours, conteste la « grille de lecture » qui lui permet de s’en prendre à Ernst Nolte et Alexandre Soljénitsyne.
- Une histoire personnelle de l’antisémitisme, Robert Laffont, 2003, p. 180.
- Est-ce permis de critiquer Israël ?, Robert Laffont, 2003, p. 46. Dans son livre, Nicolas Weill évoque aussi son arrière-grand-père, le militant socialiste Wolff Epstein, arrivé en France en 1905, qui fut notamment le gérant de la revue Combat marxiste. Arrêté sous l’Occupation, celui-ci échappa à la déportation grâce à une intervention de Georges Albertini, l’un des adjoints de Marcel Déat au très collaborationniste Rassemblement national-populaire (RNP). À la Libération, Wolff Epstein n’hésita pas à venir témoigner en faveur d’Albertini lors de son procès. Moins généreux, Nicolas Weill doute que son arrière-grand-père ait jamais « bénéficié d’une faveur particulière » (p. 186)
- Par ex. au recueil dirigé par Chantal Delsol et Michel Maslowski, Histoire des idées politiques centre-est européennes, ouvrage publié aux PUF en 1998 dans une collection dirigée par Yves Charles Zarka, adversaire déclaré de Carl Schmitt. Comme par hasard, on a depuis lors pu lire dans Le Monde un entretien avec Chantal Delsol, signé par Alexandra Laignel-Lavastine.
- Son frère cadet, le psychologue Matty Chiva, mort en avril 2003, a émigré en Israël en 1952 avant de venir s’installer à son tour à Paris six ans plus tard. Entré d’abord au CNRS, il succédera par la suite à René Zazzo à la tête du laboratoire de psychologie de l’enfant de l’Université de Paris X.
- Cf. Isac Chiva, « Un fascisme renaissant en Roumanie », in : Le Monde, 15 janvier 2000.
- « Mémoire de Vichy : le mea culpa des ethnographes », in : Le Monde, 8 mai 2003.
- Cf. Isac Chiva, « Le pogrom de Iasi », in : Les Temps modernes, fév-avr. 2003, pp. 7-20 (ici p. 8).
- Ibid., p. 20.
- Cf. l’entretien de Paul Coma avec Dan Culcer paru en mai 2000 dans la revue électronique en langue roumaine Asymetria. Adresse : 5 square Saint-Just, 78280 Guyancourt.
- Cf. Serge Moscovici, Les années égarées, Stock, 1997.
- Cf. Le Monde, 13 juillet 1994. Patrick Kéchichian, journaliste au Monde, où il s’est illustré notamment par la violence de ses attaques contre Renaud Camus (cf. Le Monde, 13 août 2002), est l’un des trois journalistes qui ont démissionné de la commission du Centre national des lettres (CNL) chargée de l’aide aux revues lorsque celle-ci a décidé, en juillet 1994, d’accorder une subvention à la revue Krisis. Trois ans plus tard, il figurait bien entendu, aux côtés de Jacques Henric, Pascale Casanova, Olivier Corpet et René Monzat, au sommaire du numéro d’avril 1997 de la revue Art Press, consacré à la dénonciation du numéro de Krisis sur l’art et le non-art.
- De la nature : Pour penser l’écologie, Anne-Marie Métailié, Paris, 2002.
- Le Monde, 25 avril 2002.
- Textuel, Paris, 1998.
- La Roumanie et la Shoah : Destruction et survie des Juifs et des Tsiganes sous le régime d’Antonescu, 1940-1944, Maison des sciences de l’homme, Paris, 2003, avant-propos de Serge Klarsfeld. L’ouvrage est d’abord paru en roumain en 1997 (Evreii sub regimul Antonescu, Hasefer, Bucuresti), aux États-Unis en l’an 2000, avec une préface d’Élie Wiesel, puis en hébreu en 2002 sous le patronage d’un organisme universitaire directement lié à la Roumanie, le Goldstein-Goren Diaspora Research Center de Tel-Aviv.
- Les Temps modernes, nov.-déc. 1999.
- The Sword of the Archangel : Fascist Ideology in Romania, East European Monographs, Boulder [Colorado], 1990. L’ouvrage est ensuite paru en Roumanie : Sabia Arhanghelului Mihail : Ideologia fascista în România, Diogene, Bucuresti, 1994.
- Journal, 1935-1944, Ivan R. Dee, Chicago, 2000.
- Op. cit., p. 519.




